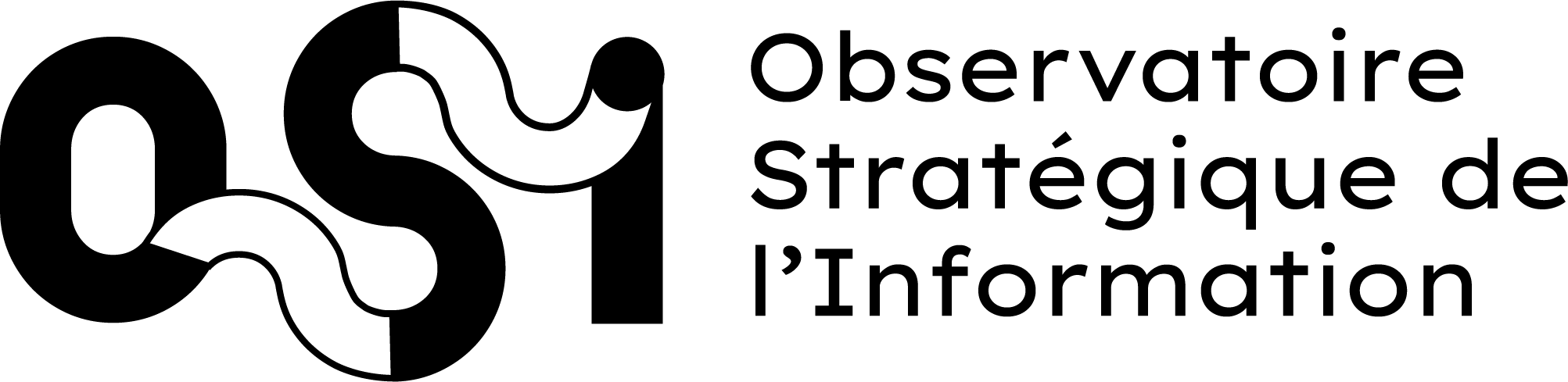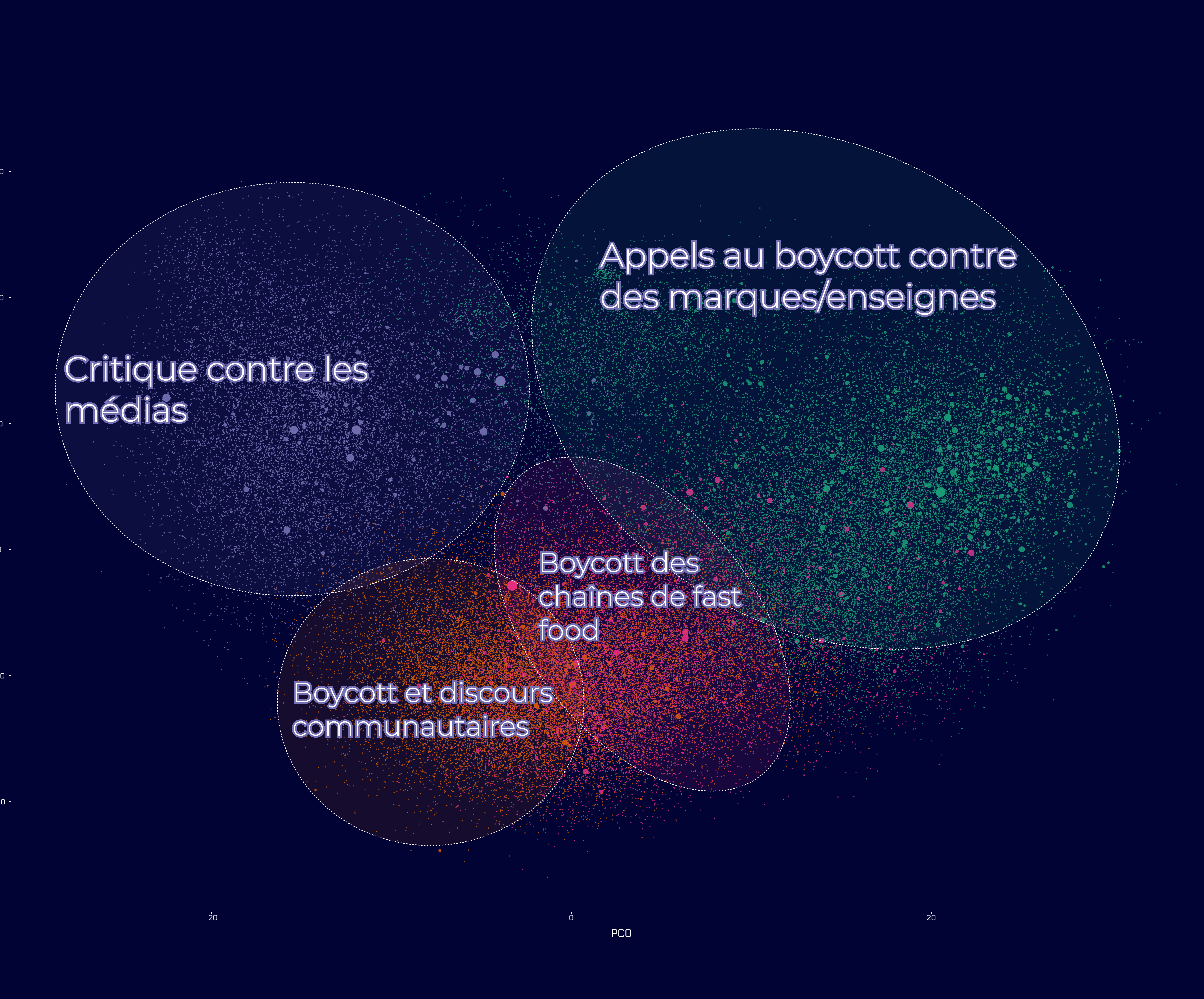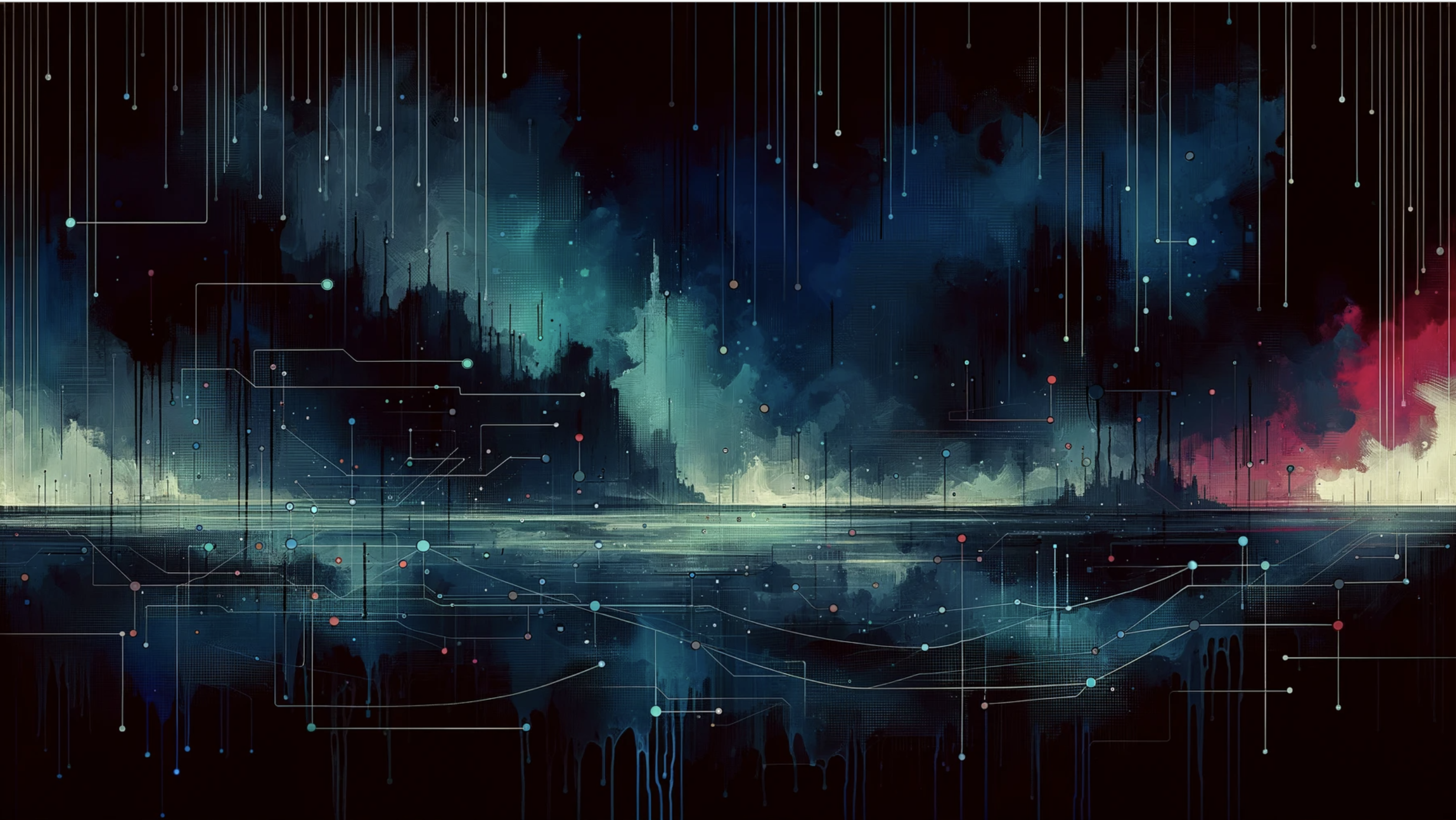Experts en « Fake News » : les nouveaux haruspices ?
Auteur(s)
Date
Partager
Résumé
Alors qu’un nombre croissant de commentateurs et d’experts se désolent de la qualité de l’information et des débats, les mêmes ont adhéré massivement au concept creux et fragile de fake news.
Auteur(s)
Date
Partager
Résumé
Alors qu’un nombre croissant de commentateurs et d’experts se désolent de la qualité de l’information et des débats, les mêmes ont adhéré massivement au concept creux et fragile de fake news.
Paradoxe d’une époque : alors qu’un nombre croissant de « commentateurs » et « d’experts » se désolent de la qualité de l’information et des débats, les mêmes ont adhéré massivement au concept creux et fragile de « fake news ». Pourtant les manipulations de l’information sont aussi anciennes que l’Homme lui-même et, pas plus aujourd’hui qu’hier, elles ne sauraient à elles-seules représenter un facteur déterminant pour comprendre l’Histoire ou l’actualité.
Les passionnés de l’histoire romaine le savent : à date, et après des siècles de réflexion aucune théorie, ne saurait à elle seule prétendre rendre raison de la chute de Rome. « Il y a toujours dans la réalité historique plus de choses que ne peut embrasser l’hypothèse la plus ingénieuse » faisait observer l’historien antiquisant Henri-Irénée Marrou. Ce qui vaut pour notre compréhension, ou tentative de compréhension de ce fait historique, vaut également pour les faits contemporains, du Brexit à l’élection de Trump, en passant par le référendum catalan, le phénomène de boycott au Maroc ou, plus proche de nous, la crise des Gilets jaunes.
Dans les deux cas, l’enseignement de l’histoire tend à accorder la primauté aux systèmes et modèles analytiques multivariés et à reléguer au second rang les approches univariées. Ces dernières sont souvent la résultante de l’air du temps, de la volonté de certains acteurs et de certains chercheurs d’appliquer à un phénomène, historique ou non, les grilles de lecture du moment. Du matérialisme historique, qui a irrigué pendant des décennies la culture scientifique jusqu’à son pendant libéral, qui de Hegel à Fukuyama, de manière souvent brillante, anachronique parfois, a reconstruit l’histoire de l’humanité comme une tension permanente en vue de la reconnaissance du sujet, ce tropisme matriciel a toujours existé. De même que les décadentistes de la fin du XIXème siècle, dont Paul Bourget apparaît comme l’un des représentants les plus notables, essayèrent, au forceps bien souvent, de dresser des ponts, des continuums entre leur époque et celle de la chute de l’empire romain, leurs successeurs, gravitant dans des franges politique similaires, cherchèrent à faire des grandes invasions l’alpha et l’oméga de la chute de l’empire.
Décadence morale, déliquescence du système politique, causes d’ordre environnemental ou sanitaire… Au fil des siècles les thèses, plus ou moins étayées, se sont succédées pour essayer de rendre raison de l’un de ses phénomènes qui ne peut que susciter questionnement, crainte et doute. Les spécialistes de l’histoire romaine recensent d’ailleurs plus de 200 théories à ce sujet, et nul doute que le flot ne saurait se tarir dans les prochaines années, tant les progrès en matière de recherche scientifique, ouvrent continuellement de nouvelles pistes à investiguer.
Partant de ce cas spécifique, on pourrait, à juste titre sûrement, en venir à douter de la pertinence de toute démarche scientifique voire considérer qu’en définitive la recherche de la vérité d’un phénomène revêt quelque chose d’intangible. Un je-ne-sais-quoi qui échappera toujours, tant aux contemporains qu’aux successeurs, fût-ce des esprits brillants et savants. Cette humilité, cette modestie et cette réserve qui découlent fort logiquement du regard que nous pouvons jeter rétrospectivement sur la somme d’œuvres universitaires, tout aussi hétéroclites que plurielles, sur un sujet tel que celui de la fin de l’empire romain n’est pas un cas atypique, une anomalie épistémologique, méthodologique et heuristique.
« Fake News » : un concept creux et fragile
Au contraire, elle peut prétendre, aux côtés d’autres du même acabit, à un statut d’étalon ou de guide pour appréhender les travaux menés par d’apprentis savants, par ces exégètes hâtifs de nos sociétés contemporaines et autres haruspices en tout genre du XXIème siècle qui, pêle-mêle, entre deux captures d’écran, un fichier Excel et des méthodologies boiteuses prétendent, de manière péremptoire, tirer des conclusions irréfragables. Il en va ainsi du concept de fake news qui, par un commensalisme des plus singuliers, va de pair avec celui de post-truth, et inversement au demeurant. Si des siècles de travaux universitaires sur la chute de Rome ne sont parvenus, in fine, qu’à ajouter du complexe au complexe, du polyphonique à du monologique, dans la société de l’accélération chère au sociologue allemand Hartmut Rosa nos divinateurs contemporains très vite ont statué, marqué des phénomènes sociaux atypiques du fer blanc de leur science et contribué, avec une capacité performative des plus singulières, à faire advenir les objets, non pas tant de leurs fantasmes, quoi que, mais de leurs succédanées de recherche scientifique.
Là où la recherche exige du temps, de la patience, de la modélisation, de la réfutation, d’abord par et avec soi-même, et par la suite, une fois cette phase liminaire achevée, des plus inconfortables certes mais non moins nécessaire, il en revient aux pairs, et aux pairs seuls, de juger de la fiabilité d’un travail, de son apport au domaine et de sa contribution aux réflexions menées par des tiers. Sur la thématique propre aux fake news tout est allé vite, très vite, trop vite. L’époque a manqué de modestie, de recul et distance critique.
Dire que cela est un trait significatif de l’air du temps serait une assertion des plus sommaires, mais le fait est qu’aucune de ces qualités ne s’est manifestée pour enrayée la spirale dans laquelle s’est engouffrée une frange des observateurs. Si des manipulations existent indubitablement, depuis le cheval de Troie des Anciens, en passant par les fausses nouvelles de guerre, et nous pensons notamment à celles qui, à des degrés divers, de Mincemeat à l’opération Fortitude, ont contribué à désinformer, déstabiliser et intoxiquer l’ennemi, et plus récemment à des phénomènes de manipulation de l’opinion en ligne comme dans le cadre du boycott marocain, il faut toutefois être prudent dans l’influence, la portée et l’impact sur le cours des événements que l’on souhaite leur accorder. Une corrélation n’est pas une causalité.
Les variables explicatives d’un phénomène sont toujours complexes et multiples
Dans un monde complexe, numérique de surcroît faut-il faire le pari de la focale réduite ou celui, plus osé, et potentiellement insoluble, de l’irréductibilité des variables explicatives ? Pour rendre raison du vote Leave d’un électeur des West et East Midlands, du North East ou encore du Yorkshire, devons-nous construire, ou a minima essayer de construire, un modèle prenant en compte l’activité seule des trolls/bots russes sur Twitter ou bien, dans un souci méthodologique poussé, devons-nous, au contraire, appréhender cette variable comme un potentiel déterminant parmi un nombre X de variables potentiellement explicatives ? Démographie, emploi, formation, situation familiale, niveau de revenu, votes précédents, nombre de commerce de proximité, distance à la ville, accès au numérique, situation de handicap, religion, autant de paramètres que la sociologie classique n’aurait aucunement passé sous le boisseau. Autant de paramètres qui ont été trop souvent mis de côté au profit de raccourcis du type Julian Assange ou les « russians trolls/bots » (d’ailleurs aussi actifs au moment du référendum Catalan en novembre 2017). S’il ne s’agit aucunement de basculer dans une approche tendant à évacuer cette variable, à lui daigner toute forme de légitimité, et nous pensons notamment ici aux différents travaux menés sur le phénomène de boycott au Maroc, au printemps 2018, et caractérisé indubitablement par des logiques de manipulation de l’opinion en ligne, d’astroturfing et autres vecteurs relevant du registre de la fake news, il nous apparaît toutefois, et ce depuis quelques années, que leur faiblesse explicative, qui contraste malheureusement avec leur capacité d’attraction, tant auprès des observateurs avisés que des décideurs, est souvent éminemment problématique.
Éminemment problématique car ces modèles univariés sont à l’origine de nouveaux discours, de nouvelles idéologies, de nouvelles attitudes, de nouvelles réglementations, de nouvelles lois, alors même qu’un statisticien, qu’un chercheur, qu’un analyste aurait dû, très vite, alerter sur la dimension ubuesque de l’approche et statistiquement problématique.
Pour renouer avec l’exemple cité dans notre propos introductif, il nous parait plus rigoureux méthodologiquement de tester tout à la fois l’influence des pandémies mortelles nées sur le terreau urbanistique et structurel romain, comme la peste antonine notamment, les changements climatiques et la fin de l’OCR par exemple, la prétendue décadence morale, l’impact des flux migratoires, les inconvénients de la taille de son empire ou encore l’hypothétique désorganisation militaire pour essayer de mettre au jour des déterminants.
Une approche rigoureuse qui néanmoins a un corolaire des plus fâcheux en cette deuxième décennie déclinante du XXIème siècle : le risque, devrions-nous dire la certitude, que les travaux ainsi conduits soient achevés alors même que l’encre d’imprimerie des quotidiens est sèche, que le trending topic sur Twitter ne soit guère plus porteur, et qu’un lol cat ait remplacé, dans les cerveaux de nos contemporains, dont d’aucuns déplorent quotidiennement une écologie de l’attention des plus aliénée, des considérations plus sérieuses.
Paradoxe d’une époque : alors qu’un nombre croissant de « commentateurs » et « d’experts » se désolent de la qualité de l’information et des débats, les mêmes ont adhéré massivement au concept creux et fragile de « fake news ». Pourtant les manipulations de l’information sont aussi anciennes que l’Homme lui-même et, pas plus aujourd’hui qu’hier, elles ne sauraient à elles-seules représenter un facteur déterminant pour comprendre l’Histoire ou l’actualité.
Les passionnés de l’histoire romaine le savent : à date, et après des siècles de réflexion aucune théorie, ne saurait à elle seule prétendre rendre raison de la chute de Rome. « Il y a toujours dans la réalité historique plus de choses que ne peut embrasser l’hypothèse la plus ingénieuse » faisait observer l’historien antiquisant Henri-Irénée Marrou. Ce qui vaut pour notre compréhension, ou tentative de compréhension de ce fait historique, vaut également pour les faits contemporains, du Brexit à l’élection de Trump, en passant par le référendum catalan, le phénomène de boycott au Maroc ou, plus proche de nous, la crise des Gilets jaunes.
Dans les deux cas, l’enseignement de l’histoire tend à accorder la primauté aux systèmes et modèles analytiques multivariés et à reléguer au second rang les approches univariées. Ces dernières sont souvent la résultante de l’air du temps, de la volonté de certains acteurs et de certains chercheurs d’appliquer à un phénomène, historique ou non, les grilles de lecture du moment. Du matérialisme historique, qui a irrigué pendant des décennies la culture scientifique jusqu’à son pendant libéral, qui de Hegel à Fukuyama, de manière souvent brillante, anachronique parfois, a reconstruit l’histoire de l’humanité comme une tension permanente en vue de la reconnaissance du sujet, ce tropisme matriciel a toujours existé. De même que les décadentistes de la fin du XIXème siècle, dont Paul Bourget apparaît comme l’un des représentants les plus notables, essayèrent, au forceps bien souvent, de dresser des ponts, des continuums entre leur époque et celle de la chute de l’empire romain, leurs successeurs, gravitant dans des franges politique similaires, cherchèrent à faire des grandes invasions l’alpha et l’oméga de la chute de l’empire.
Décadence morale, déliquescence du système politique, causes d’ordre environnemental ou sanitaire… Au fil des siècles les thèses, plus ou moins étayées, se sont succédées pour essayer de rendre raison de l’un de ses phénomènes qui ne peut que susciter questionnement, crainte et doute. Les spécialistes de l’histoire romaine recensent d’ailleurs plus de 200 théories à ce sujet, et nul doute que le flot ne saurait se tarir dans les prochaines années, tant les progrès en matière de recherche scientifique, ouvrent continuellement de nouvelles pistes à investiguer.
Partant de ce cas spécifique, on pourrait, à juste titre sûrement, en venir à douter de la pertinence de toute démarche scientifique voire considérer qu’en définitive la recherche de la vérité d’un phénomène revêt quelque chose d’intangible. Un je-ne-sais-quoi qui échappera toujours, tant aux contemporains qu’aux successeurs, fût-ce des esprits brillants et savants. Cette humilité, cette modestie et cette réserve qui découlent fort logiquement du regard que nous pouvons jeter rétrospectivement sur la somme d’œuvres universitaires, tout aussi hétéroclites que plurielles, sur un sujet tel que celui de la fin de l’empire romain n’est pas un cas atypique, une anomalie épistémologique, méthodologique et heuristique.
« Fake News » : un concept creux et fragile
Au contraire, elle peut prétendre, aux côtés d’autres du même acabit, à un statut d’étalon ou de guide pour appréhender les travaux menés par d’apprentis savants, par ces exégètes hâtifs de nos sociétés contemporaines et autres haruspices en tout genre du XXIème siècle qui, pêle-mêle, entre deux captures d’écran, un fichier Excel et des méthodologies boiteuses prétendent, de manière péremptoire, tirer des conclusions irréfragables. Il en va ainsi du concept de fake news qui, par un commensalisme des plus singuliers, va de pair avec celui de post-truth, et inversement au demeurant. Si des siècles de travaux universitaires sur la chute de Rome ne sont parvenus, in fine, qu’à ajouter du complexe au complexe, du polyphonique à du monologique, dans la société de l’accélération chère au sociologue allemand Hartmut Rosa nos divinateurs contemporains très vite ont statué, marqué des phénomènes sociaux atypiques du fer blanc de leur science et contribué, avec une capacité performative des plus singulières, à faire advenir les objets, non pas tant de leurs fantasmes, quoi que, mais de leurs succédanées de recherche scientifique.
Là où la recherche exige du temps, de la patience, de la modélisation, de la réfutation, d’abord par et avec soi-même, et par la suite, une fois cette phase liminaire achevée, des plus inconfortables certes mais non moins nécessaire, il en revient aux pairs, et aux pairs seuls, de juger de la fiabilité d’un travail, de son apport au domaine et de sa contribution aux réflexions menées par des tiers. Sur la thématique propre aux fake news tout est allé vite, très vite, trop vite. L’époque a manqué de modestie, de recul et distance critique.
Dire que cela est un trait significatif de l’air du temps serait une assertion des plus sommaires, mais le fait est qu’aucune de ces qualités ne s’est manifestée pour enrayée la spirale dans laquelle s’est engouffrée une frange des observateurs. Si des manipulations existent indubitablement, depuis le cheval de Troie des Anciens, en passant par les fausses nouvelles de guerre, et nous pensons notamment à celles qui, à des degrés divers, de Mincemeat à l’opération Fortitude, ont contribué à désinformer, déstabiliser et intoxiquer l’ennemi, et plus récemment à des phénomènes de manipulation de l’opinion en ligne comme dans le cadre du boycott marocain, il faut toutefois être prudent dans l’influence, la portée et l’impact sur le cours des événements que l’on souhaite leur accorder. Une corrélation n’est pas une causalité.
Les variables explicatives d’un phénomène sont toujours complexes et multiples
Dans un monde complexe, numérique de surcroît faut-il faire le pari de la focale réduite ou celui, plus osé, et potentiellement insoluble, de l’irréductibilité des variables explicatives ? Pour rendre raison du vote Leave d’un électeur des West et East Midlands, du North East ou encore du Yorkshire, devons-nous construire, ou a minima essayer de construire, un modèle prenant en compte l’activité seule des trolls/bots russes sur Twitter ou bien, dans un souci méthodologique poussé, devons-nous, au contraire, appréhender cette variable comme un potentiel déterminant parmi un nombre X de variables potentiellement explicatives ? Démographie, emploi, formation, situation familiale, niveau de revenu, votes précédents, nombre de commerce de proximité, distance à la ville, accès au numérique, situation de handicap, religion, autant de paramètres que la sociologie classique n’aurait aucunement passé sous le boisseau. Autant de paramètres qui ont été trop souvent mis de côté au profit de raccourcis du type Julian Assange ou les « russians trolls/bots » (d’ailleurs aussi actifs au moment du référendum Catalan en novembre 2017). S’il ne s’agit aucunement de basculer dans une approche tendant à évacuer cette variable, à lui daigner toute forme de légitimité, et nous pensons notamment ici aux différents travaux menés sur le phénomène de boycott au Maroc, au printemps 2018, et caractérisé indubitablement par des logiques de manipulation de l’opinion en ligne, d’astroturfing et autres vecteurs relevant du registre de la fake news, il nous apparaît toutefois, et ce depuis quelques années, que leur faiblesse explicative, qui contraste malheureusement avec leur capacité d’attraction, tant auprès des observateurs avisés que des décideurs, est souvent éminemment problématique.
Éminemment problématique car ces modèles univariés sont à l’origine de nouveaux discours, de nouvelles idéologies, de nouvelles attitudes, de nouvelles réglementations, de nouvelles lois, alors même qu’un statisticien, qu’un chercheur, qu’un analyste aurait dû, très vite, alerter sur la dimension ubuesque de l’approche et statistiquement problématique.
Pour renouer avec l’exemple cité dans notre propos introductif, il nous parait plus rigoureux méthodologiquement de tester tout à la fois l’influence des pandémies mortelles nées sur le terreau urbanistique et structurel romain, comme la peste antonine notamment, les changements climatiques et la fin de l’OCR par exemple, la prétendue décadence morale, l’impact des flux migratoires, les inconvénients de la taille de son empire ou encore l’hypothétique désorganisation militaire pour essayer de mettre au jour des déterminants.
Une approche rigoureuse qui néanmoins a un corolaire des plus fâcheux en cette deuxième décennie déclinante du XXIème siècle : le risque, devrions-nous dire la certitude, que les travaux ainsi conduits soient achevés alors même que l’encre d’imprimerie des quotidiens est sèche, que le trending topic sur Twitter ne soit guère plus porteur, et qu’un lol cat ait remplacé, dans les cerveaux de nos contemporains, dont d’aucuns déplorent quotidiennement une écologie de l’attention des plus aliénée, des considérations plus sérieuses.
La désinformation repose sur la fabrication d’un faux message puis sa diffusion de façon qui semble neutre et dans un but stratégique. Il s’agit toujours d’agir négativement sur l’opinion publique pour affaiblir un camp. Ce camp peut être un pays, les tenants d’une idéologie, un groupe ou une entreprise...(on imagine mal une désinformation qui ferait l’éloge de ceux qu’elle vise).
Celui qui ne maîtrisera pas la technologie, ne maîtrisera peut-être demain ni sa souveraineté, ni la simple faculté de parler de la même réalité.
Nous subissons la terrible loi dite de Brandolini « La quantité d'énergie nécessaire pour réfuter du baratin est beaucoup plus importante que celle qui a permis de le créer".
Le postulat victimaire. Il consiste à évaluer une idée ou une affirmation à l’aune de la souffrance qu’elle cause à telle communauté ou de l’affront à telle identité imaginaire. Les idées ne sont plus soumises au critère de vérification mais de réception : ça fait mal ? D’où le besoin d’en contrôler la diffusion.