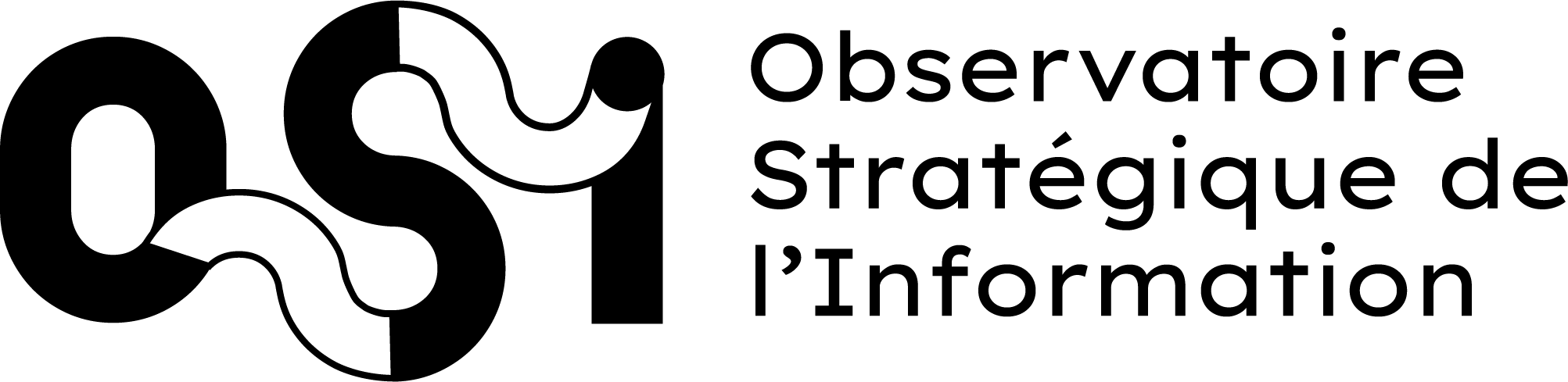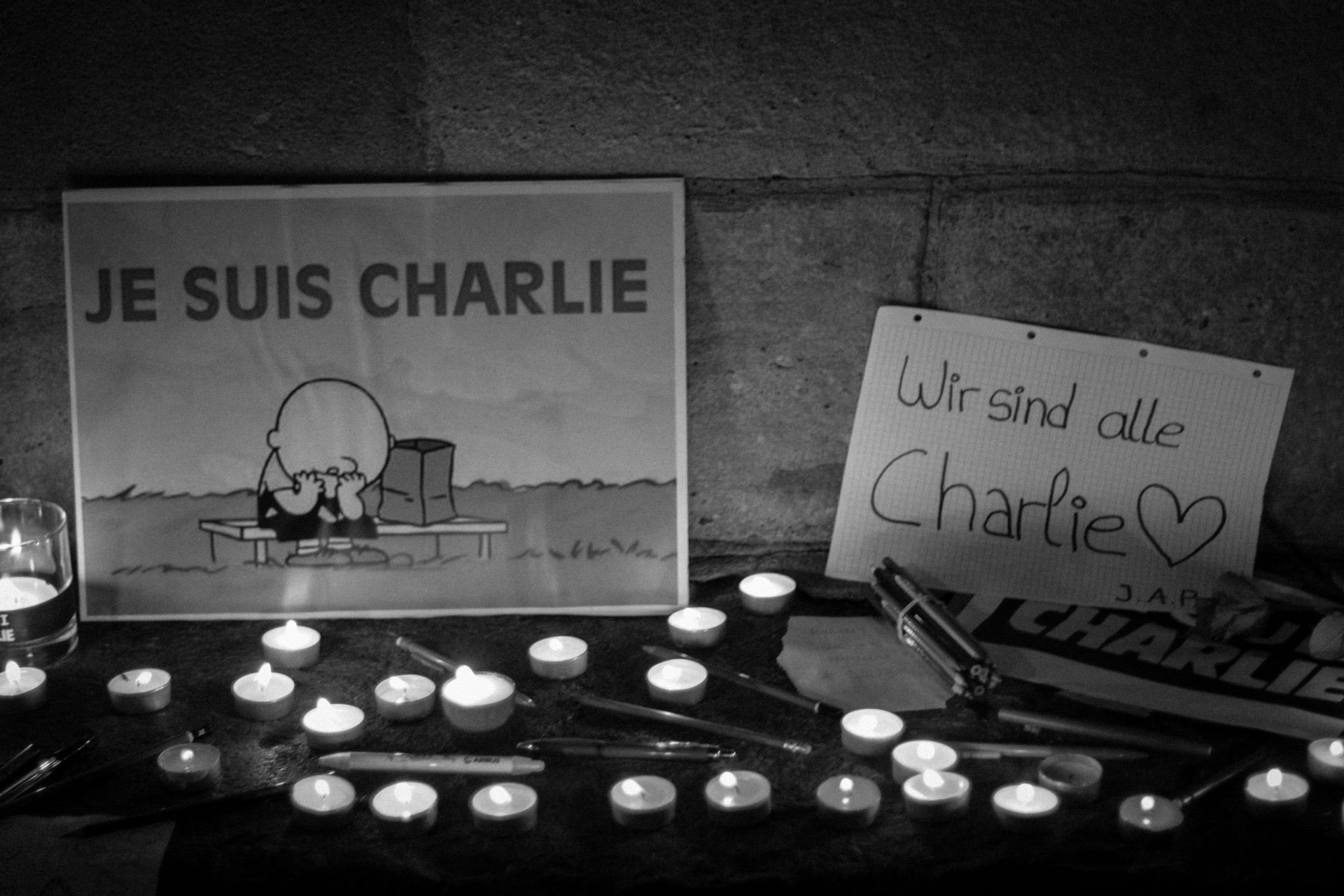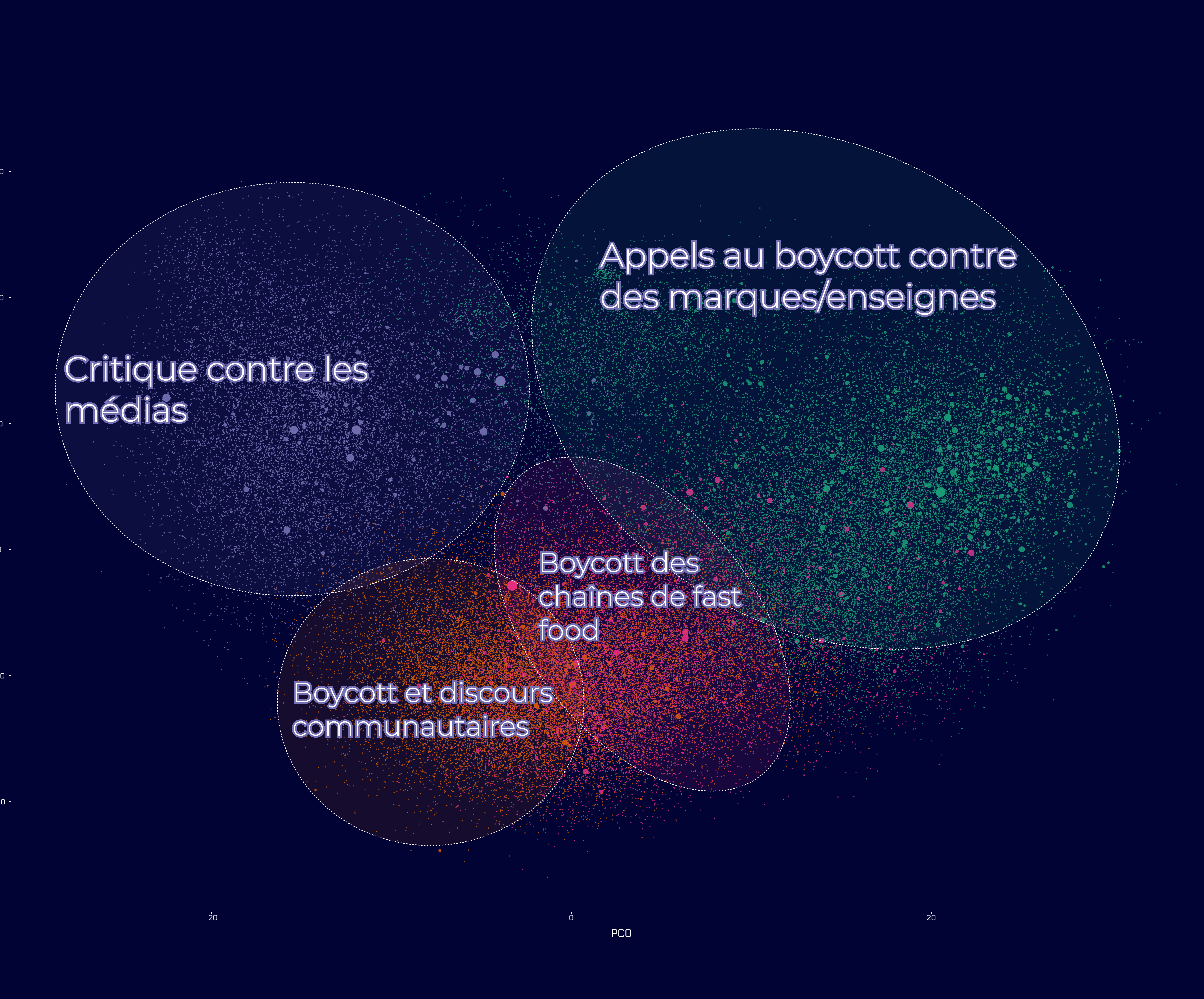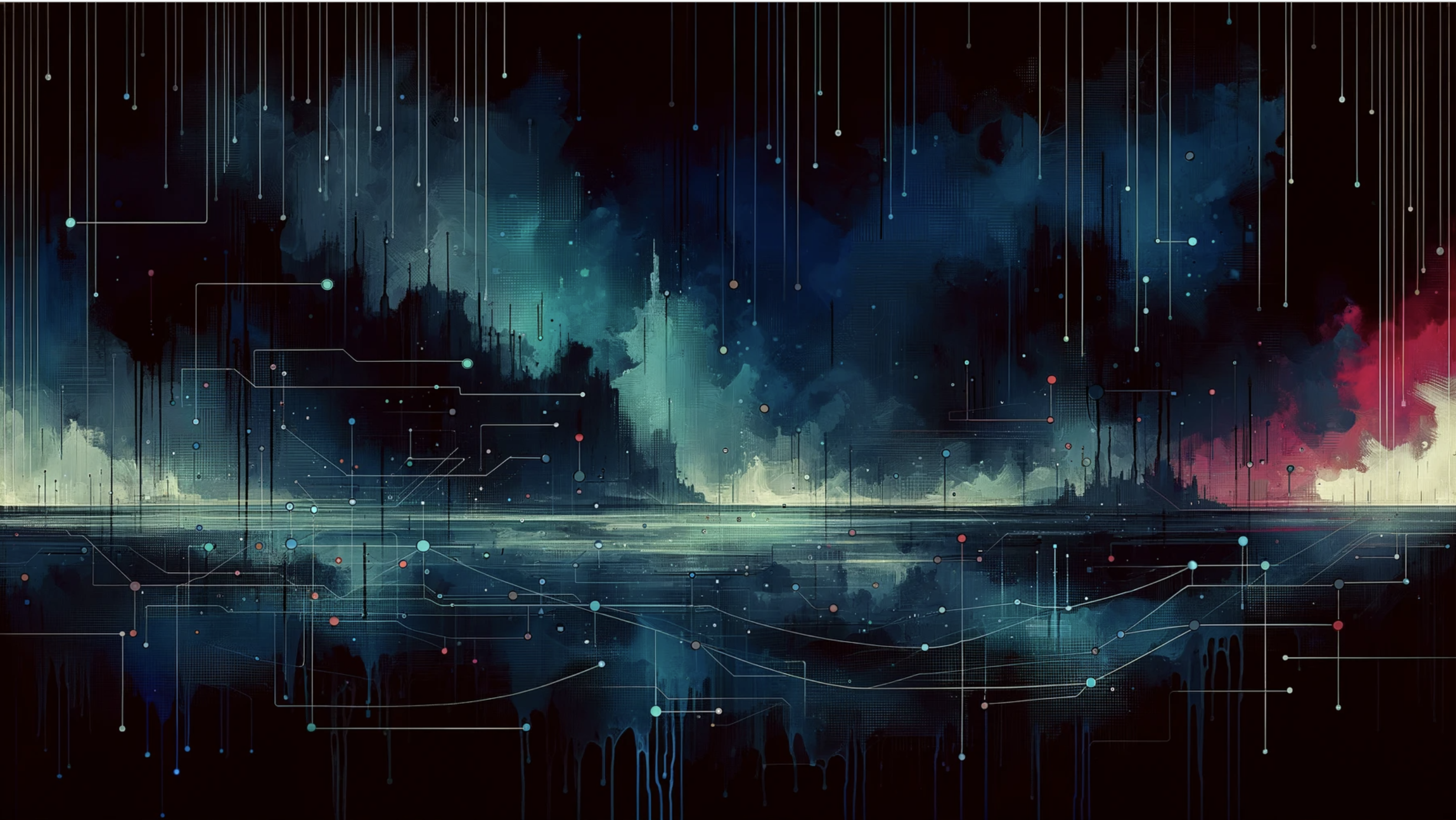« Radicalisation » : une notion impropre, qui nous conduit à penser thérapie là où nos adversaires pensent affrontement
Auteur(s)
Date
Partager
Résumé
La notion de radicalisation réduit les rapports entre violence, révolte, soumission et idéologie à une dérive psychologique, crise ou anomalie sociale. Outre qu’elle n’explique guère, elle nie deux dimensions du jihadisme. Fait religieux, il suppose une communauté qui se rassemble par le haut.
Auteur(s)
Date
Partager
Résumé
La notion de radicalisation réduit les rapports entre violence, révolte, soumission et idéologie à une dérive psychologique, crise ou anomalie sociale. Outre qu’elle n’explique guère, elle nie deux dimensions du jihadisme. Fait religieux, il suppose une communauté qui se rassemble par le haut.
La récente libération d’un jihadiste parti en Syrie dès 2012, puis d’un islamiste, chef de Forzane Aliza, leur peine purgée, rappelle que, dans un État de droit, même les gens qui le combattent, finissent en liberté. Et, comme d’autres jihadistes relâchés avant eux, ils sembleraient avoir gardé leurs convictions. Cela n’étonnera que ceux qui pensent que l’institution pénitentiaire peut sauver les âmes ou ramener les égarés.
La formule rituelle est : « ils ne se sont pas déradicalisés ». Cette terminologie devenue quasi officielle suggère un mécanisme psychique, peut-être réversible. Cela donna d’ailleurs lieu à un business de la déradicalisation maintenant plus contesté.
Là où nous pensons dysfonctionnements et thérapie, ils pensent affrontement final et jugement des âmes. Nier que l’autre pense n’a jamais aidé à le vaincre
Étymologiquement, la radicalité est le fait de retourner aux racines de sa foi. Un salafiste, par définition littéraliste et fondamentaliste, ne devrait pas se sentir offensé par le mot. Mais le problème est le suffixe : « ation » qui suppose une action subie. D’autant que les médias parlent parallèlement de radicalisation du débat d’idées (dérivant trop à droite ou à gauche), de radicalisation du mouvement social qui se durcit ou de gilets jaunes radicalisés, ceux qui imiteraient les black blocs dans les manifestations. Initialement « normal », on pourrait donc se radicaliser, voire se déradicaliser. Cette phraséologie entretient trois ambiguïtés :
- Le flou sur la différence entre une idée et un acte. Entre mauvaises pensée et actions brutales, contamination et brutalisation. Selon F. Khosrokavar auteur de Radicalisation, ce serait le « processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d’action, directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieux qui conteste l’ordre établi…». Cela suppose que le sujet soit sous influence ; la captation par l’idée pousse-au-crime pourrait se détecter, voire se corriger. L’idéologie est ce qui s’attrape (ou qui vous attrape) et change vos codes pour faire obéir et haïr. Le mystère de la violence ainsi renvoyé à l’énigme de la croyance – du moins celle qui est contraire à nos valeurs – soulève un paradoxe. Les radicalisés nous considèrent nous, les « normaux », comme les endoctrinés qui agressons. Et toute lutte idéologique suppose de proclamer que l’adversaire est un fanatique destructeur.
- La frontière se confond entre une croyance et une volonté. Les jihadistes sont hyperdogmatiques et, même si nous ne cessons de leur répéter que « ce n’est pas le vrai islam », ils ne font rien qu’ils ne justifient par une sourate ou un hadith. Le principe de soumission au commandement divin – qui les conduit à refuser toute démocratie, Dieu devant commander et non le peuple – suppose le projet de vivre leur foi dans une communauté pure. Donc de combattre tout ce qui s’oppose au triomphe de l’Oumma. Donc l’obligation de la lutte. L’horrible cohérence du raisonnement rend douteuse la comparaison avec les gens qui tombent dans la drogue, l’alcoolisme ou la délinquance.
- La tension entre une passion et un dogme. On a beaucoup débattu (Roy vs Keppel) si un désir de radicalité cherchait prétexte ou direction dans le jihadisme ou l’inverse. Ou bien une force, – certes liée à des facteurs économiques, sociologiques ou culturels -, comme un désir de mort, trouve à se décharger dans l’engagement islamiste (mais pourquoi sous cette forme-là ?). Ou bien une idéologie éveille les pulsions les plus guerrières (mais pourquoi avec une pareille efficacité rhétorique ?). Tout au long de l’Histoire les idées qui voulaient changer le monde ont rencontré des colères qui mobilisaient des gens. Entre les deux, des communautés, des groupes organisés, des outils pour convaincre et rassembler. C’est, d’ailleurs, ce dont s’occupe souvent la médiologie.
La notion de radicalisation réduit les rapports entre violence, révolte, soumission et idéologie à une dérive psychologique, crise ou anomalie sociale. Outre qu’elle n’explique guère, elle nie deux dimensions du jihadisme. Fait religieux, il suppose une communauté qui se rassemble par le haut. Fait politique, il implique une instance qui se proclame notre ennemie et nous traite comme tels. Là où nous pensons dysfonctionnements et thérapie, ils pensent affrontement final et jugement des âmes. Nier que l’autre pense n’a jamais aidé à le vaincre.
La récente libération d’un jihadiste parti en Syrie dès 2012, puis d’un islamiste, chef de Forzane Aliza, leur peine purgée, rappelle que, dans un État de droit, même les gens qui le combattent, finissent en liberté. Et, comme d’autres jihadistes relâchés avant eux, ils sembleraient avoir gardé leurs convictions. Cela n’étonnera que ceux qui pensent que l’institution pénitentiaire peut sauver les âmes ou ramener les égarés.
La formule rituelle est : « ils ne se sont pas déradicalisés ». Cette terminologie devenue quasi officielle suggère un mécanisme psychique, peut-être réversible. Cela donna d’ailleurs lieu à un business de la déradicalisation maintenant plus contesté.
Là où nous pensons dysfonctionnements et thérapie, ils pensent affrontement final et jugement des âmes. Nier que l’autre pense n’a jamais aidé à le vaincre
Étymologiquement, la radicalité est le fait de retourner aux racines de sa foi. Un salafiste, par définition littéraliste et fondamentaliste, ne devrait pas se sentir offensé par le mot. Mais le problème est le suffixe : « ation » qui suppose une action subie. D’autant que les médias parlent parallèlement de radicalisation du débat d’idées (dérivant trop à droite ou à gauche), de radicalisation du mouvement social qui se durcit ou de gilets jaunes radicalisés, ceux qui imiteraient les black blocs dans les manifestations. Initialement « normal », on pourrait donc se radicaliser, voire se déradicaliser. Cette phraséologie entretient trois ambiguïtés :
- Le flou sur la différence entre une idée et un acte. Entre mauvaises pensée et actions brutales, contamination et brutalisation. Selon F. Khosrokavar auteur de Radicalisation, ce serait le « processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d’action, directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieux qui conteste l’ordre établi…». Cela suppose que le sujet soit sous influence ; la captation par l’idée pousse-au-crime pourrait se détecter, voire se corriger. L’idéologie est ce qui s’attrape (ou qui vous attrape) et change vos codes pour faire obéir et haïr. Le mystère de la violence ainsi renvoyé à l’énigme de la croyance – du moins celle qui est contraire à nos valeurs – soulève un paradoxe. Les radicalisés nous considèrent nous, les « normaux », comme les endoctrinés qui agressons. Et toute lutte idéologique suppose de proclamer que l’adversaire est un fanatique destructeur.
- La frontière se confond entre une croyance et une volonté. Les jihadistes sont hyperdogmatiques et, même si nous ne cessons de leur répéter que « ce n’est pas le vrai islam », ils ne font rien qu’ils ne justifient par une sourate ou un hadith. Le principe de soumission au commandement divin – qui les conduit à refuser toute démocratie, Dieu devant commander et non le peuple – suppose le projet de vivre leur foi dans une communauté pure. Donc de combattre tout ce qui s’oppose au triomphe de l’Oumma. Donc l’obligation de la lutte. L’horrible cohérence du raisonnement rend douteuse la comparaison avec les gens qui tombent dans la drogue, l’alcoolisme ou la délinquance.
- La tension entre une passion et un dogme. On a beaucoup débattu (Roy vs Keppel) si un désir de radicalité cherchait prétexte ou direction dans le jihadisme ou l’inverse. Ou bien une force, – certes liée à des facteurs économiques, sociologiques ou culturels -, comme un désir de mort, trouve à se décharger dans l’engagement islamiste (mais pourquoi sous cette forme-là ?). Ou bien une idéologie éveille les pulsions les plus guerrières (mais pourquoi avec une pareille efficacité rhétorique ?). Tout au long de l’Histoire les idées qui voulaient changer le monde ont rencontré des colères qui mobilisaient des gens. Entre les deux, des communautés, des groupes organisés, des outils pour convaincre et rassembler. C’est, d’ailleurs, ce dont s’occupe souvent la médiologie.
La notion de radicalisation réduit les rapports entre violence, révolte, soumission et idéologie à une dérive psychologique, crise ou anomalie sociale. Outre qu’elle n’explique guère, elle nie deux dimensions du jihadisme. Fait religieux, il suppose une communauté qui se rassemble par le haut. Fait politique, il implique une instance qui se proclame notre ennemie et nous traite comme tels. Là où nous pensons dysfonctionnements et thérapie, ils pensent affrontement final et jugement des âmes. Nier que l’autre pense n’a jamais aidé à le vaincre.
Quand ceux qui n’ont plus rien partagent le symbole du grotesque et de la vengeance, leur défi nihiliste nous annonce un singulier retour du conflit.
Le chiffre global tétanise : 33.769 attentats «islamistes» (se réclamant d’un projet d’établissement de la charia et/ou du califat) ont couté la vie à au moins 167.096 personnes.
Les black blocs, groupe affinitaire et temporaire, excellent dans la programmation numérique de l’action physique. Nihilisme symbolique et individualisme surexcité, le tout sur fond de communautés numériques : c’est bien la troisième génération de la révolte dont parle Régis Debray : sans contre-projet, mais dans l’action comme révélation de soi.
Quand l’Iran se coupe de la Toile pour isoler ses activistes, il révèle une fracture bien plus profonde.