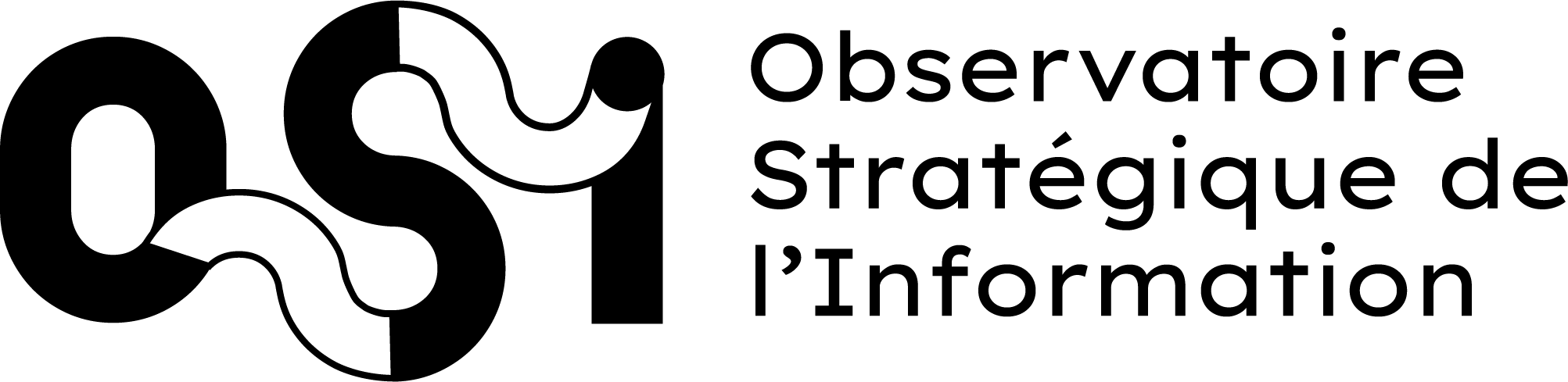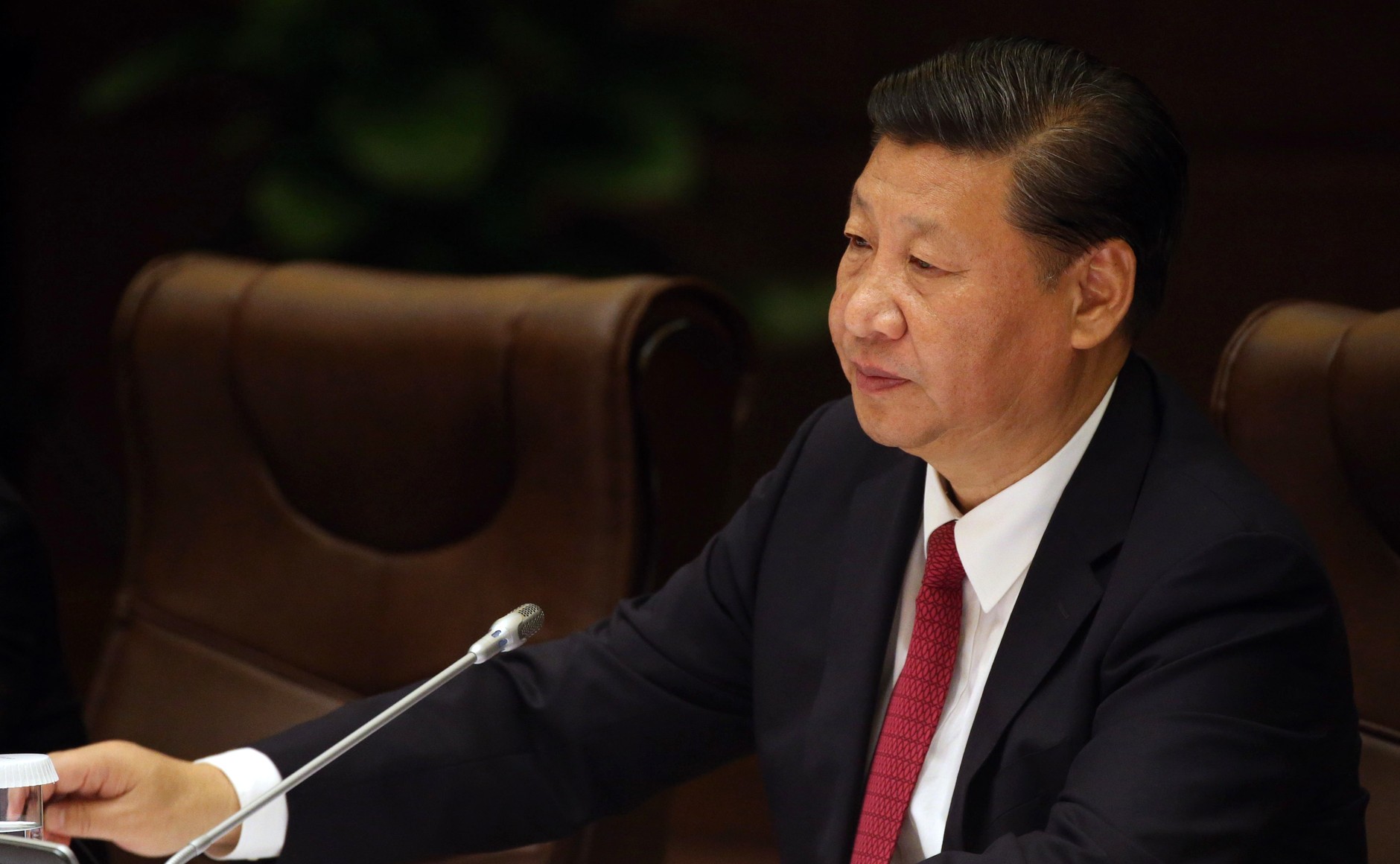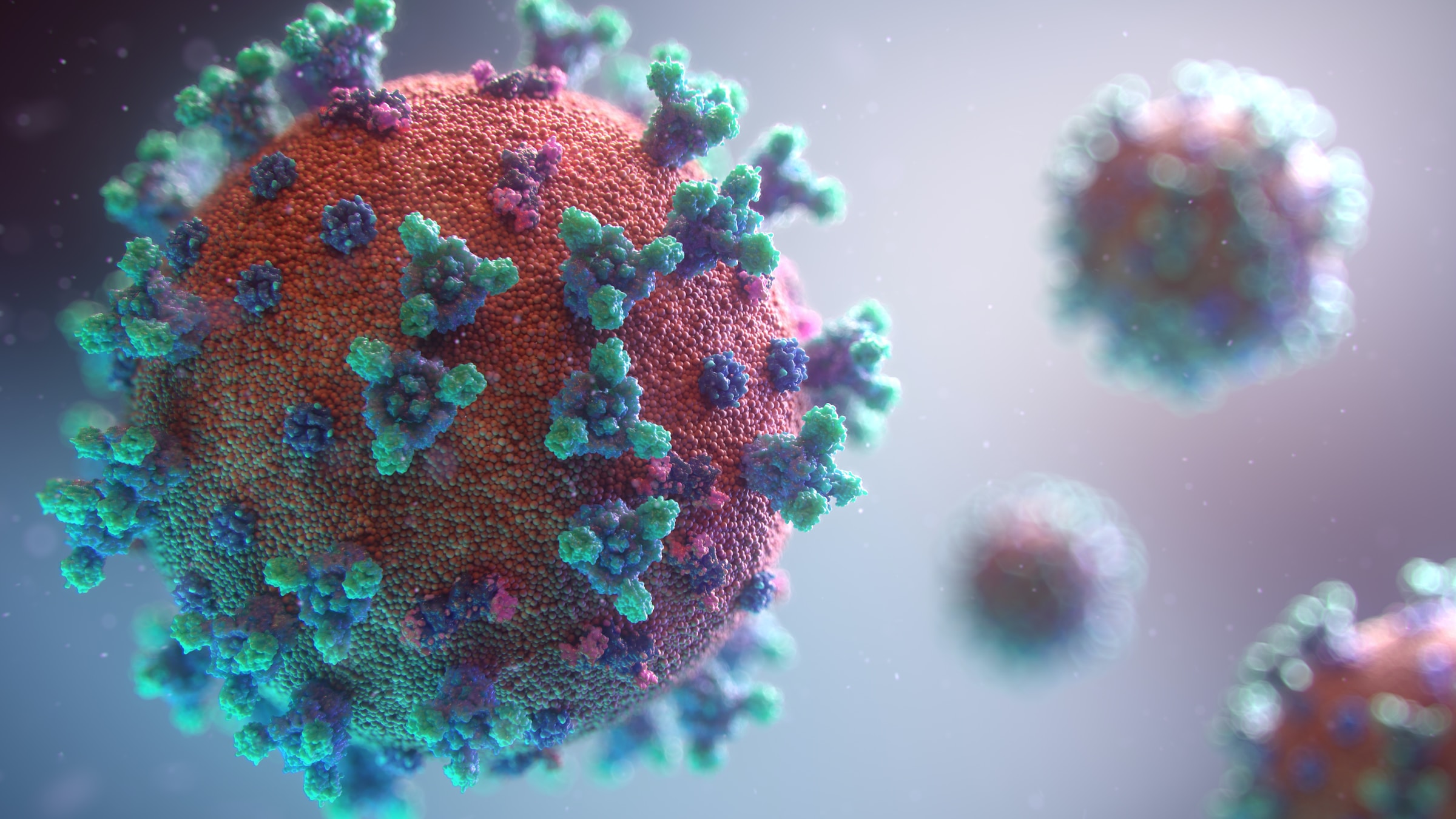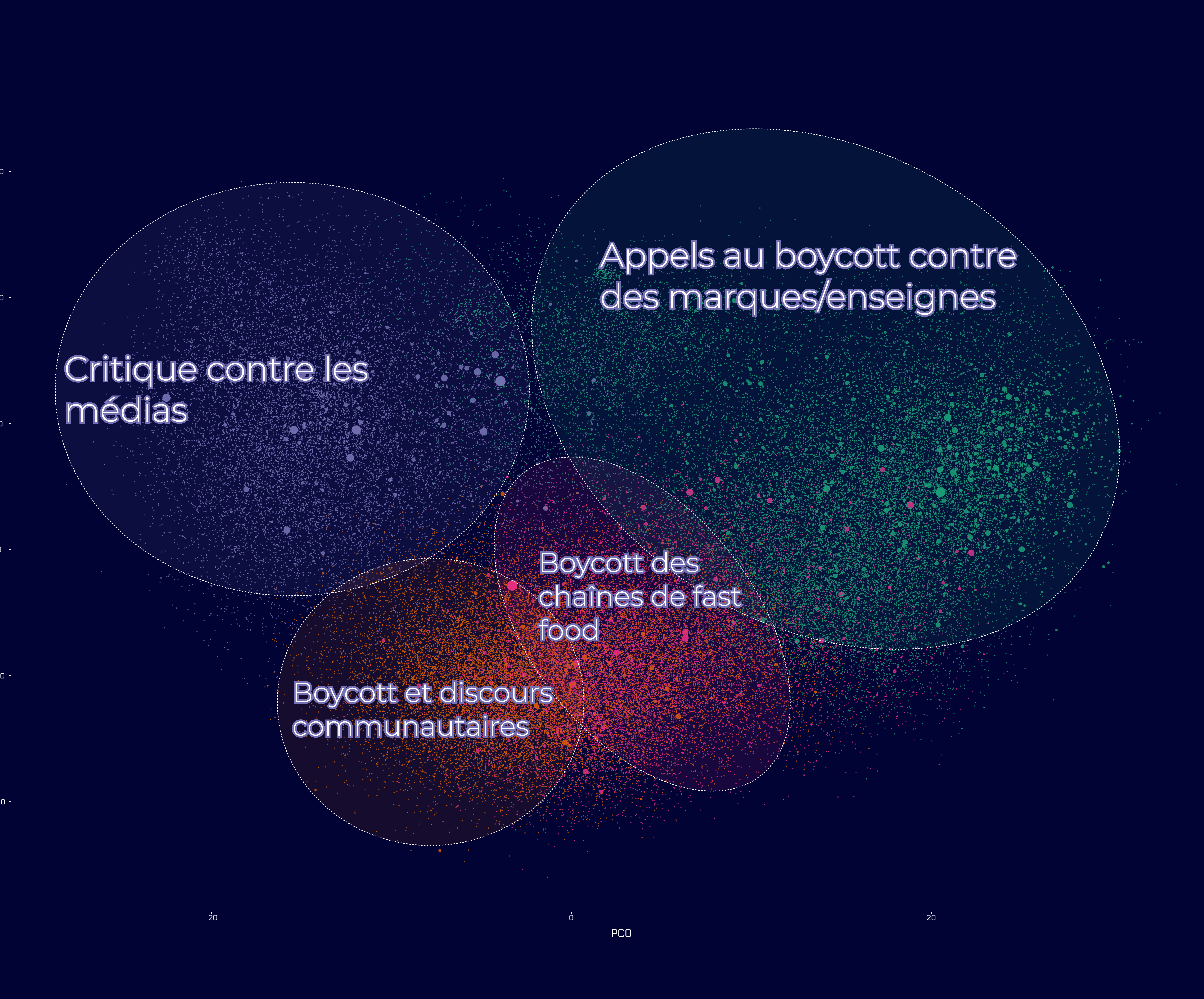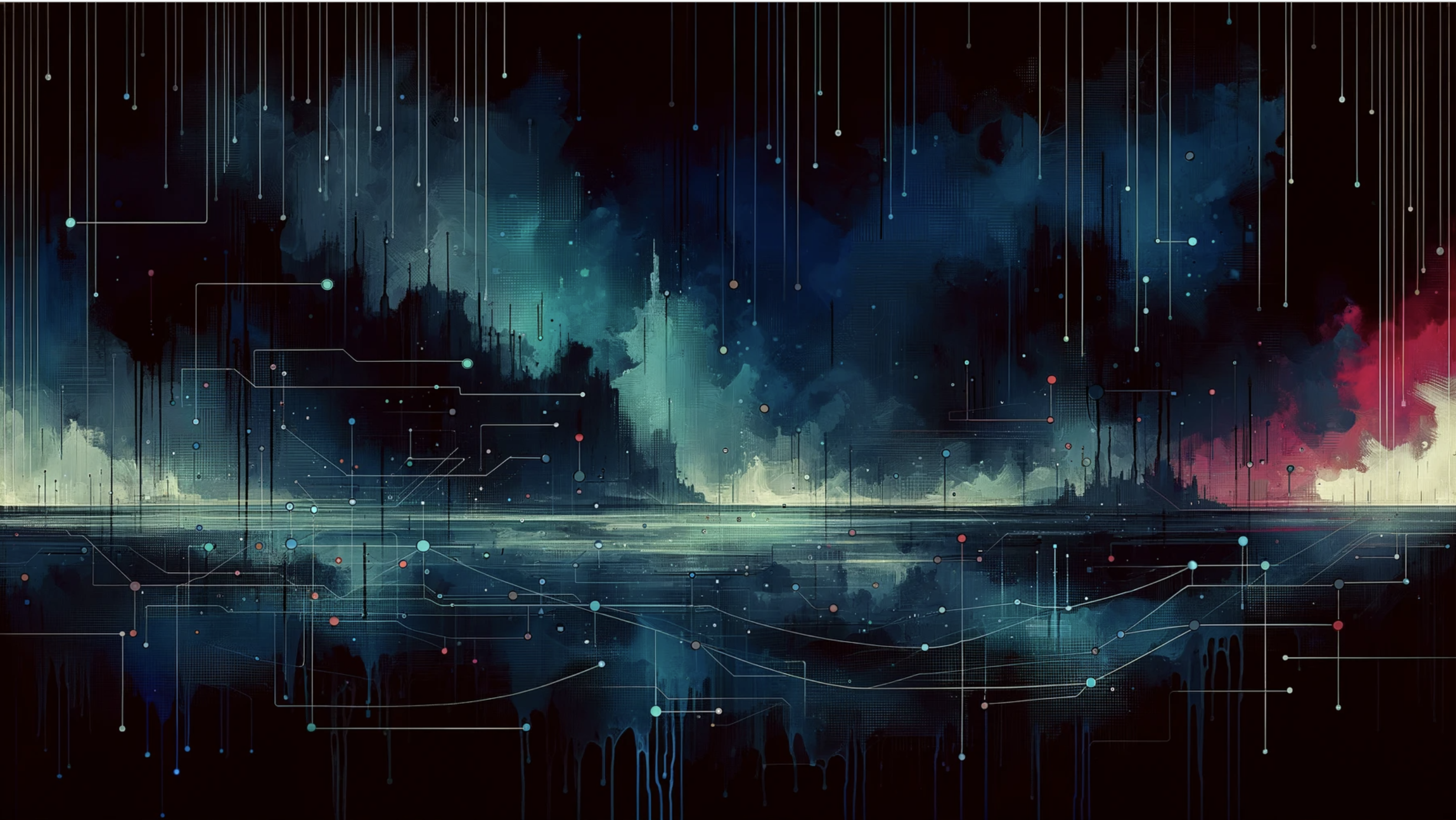Violence contre violence, peur d’en haut contre colère d’en bas : qui est démocratique et qui ne l’est pas ?
Auteur(s)
Date
Partager
Résumé
Une rhétorique se met en place avec ce syllogisme : contester le caractère démocratique du pouvoir équivaudrait à un discours extrémiste, donc ce serait anti-démocratique.
Auteur(s)
Date
Partager
Résumé
Une rhétorique se met en place avec ce syllogisme : contester le caractère démocratique du pouvoir équivaudrait à un discours extrémiste, donc ce serait anti-démocratique.
Promener des têtes en carton au bout de piques et chanter des couplets aux rimes en guillotine ? Expression d’une intolérable pulsion de mort selon Robert Badinter. Dire comme Ségolène Royal que nous vivons sous en régime autoritaire ? C’est franchir la « ligne rouge… mettre en cause notre démocratie » pour Elisabeth Borne. Parler de dictature ? Cela installe « dans notre société, et de manière séditieuse par des discours politiques extraordinairement coupables, l’idée que nous ne serions plus dans une démocratie… », or chez nous, la démocratie, c’est le débat, dixit Macron.
Une rhétorique se met en place avec ce syllogisme : contester le caractère démocratique du pouvoir équivaudrait à un discours extrémiste, donc ce serait anti-démocratique. Ce à quoi, les adversaires ripostent par des accusations de jupitérisme d’autoritarisme et de complicité avec les super riches : répression et brutalité contre égalité.
Rhétorique
Le joker de l’État de droit annule celui de la violence sociale : c’est celui qui le dit qui l’est, c’est lui qui a commencé et c’est lui qui sort du « cadre républicain ». Aux « on ne peut pas dire… » d’en haut, s’opposent les « on ne peut plus rien dire » d’en bas. Aux reproches de « haine », le sentiment d’être méprisés. À la peur, la colère.
Les historiens nous répondront que l’on est toujours le fasciste de quelqu’un, que de Gaulle fut comparé à Franco ou Hitler, et que, bien avant les gilets jaunes, on accusait des manifestants d’être des séditieux nostalgiques du 6 février 1934. Mais, il n’y a pas que les mots.
L’escalade verbale s’accompagne de gestes. Et pas seulement ceux des actions des forces de l’ordre (yeux crevés par les LDB, lynchages de manifestants filmés et montrés sur les réseaux sociaux), ni les violences des casseurs, black blocs (et plus si affinités). Il y a aussi des gestes symboliques: décrochages de portraits du président, invasion de locaux, jets de robes d’avocats, de livres ou de savates, dos tournés, etc. Chahut au théâtre ou dans des cérémonies de vœux, pompiers mimant leur immolation. Et autres façons de manquer délibérément de respect à ceux qui vous commandent et dont on estime, précisément, qu’il ne vous témoignent pas. Toujours l’effet de symétrie.
Spectacle des tensions
S’ajoute le facteur durée. Personne ne nie les différences sociologiques, idéologiques, culturelles ou autres entre les Gilets jaunes des carrefours et des premiers jours (il y a 63 semaines), et les syndicats qui protestent contre des retraites (plus de 56 jours). Mais, au total il n’y a plus de samedi où les médias ne montrent le spectacle ritualisé des tensions. La banalisation de l’affrontement, physique ou symbolique, s’oppose à un pouvoir dont le programme était d’abolir le conflit, réputé idéologique par nature, au profit des solutions techniques et de la compétition entre « projets ».
Il y a un moment où une guerre de position doit cesser. Par épuisement d’une des parties. Ou alors une suite d’émeutes doit finir par devenir insurrection. Du moins, c’est ce que l’on croyait. Jusqu’à présent, une insurrection, cela demandait l’alliance de plusieurs classes et l’addition de plusieurs rages, un soutien de l’opinion mais aussi des organisations, des croyances partagées, des idéologies voire des utopies, des chefs, sans doute des intellectuels organiques ou médiateurs, une ébauche de projet, un minimum de positivité. Comme le notait ici Régis Debray, les explosions revendicatives de notre époque ne franchissent guère ce seuil et n’annoncent pas de vraies guillotines, ou de vrais goulags. Ni de lendemains qui gazouillent, d’ailleurs.
L’hypothèse serait alors : banalisation de la violence politique de faible intensité, théâtralisation, mini-chaos sur rendez-vous, donc système tolérant une part de chaos et chaos qui se contenterait de moments de spectacles et d’autonomie. Une fonction défoulement amplifiée par les réseaux sociaux, jugent les uns. Une accumulation de forces qui trouveront leur forme, espèrent les autres.
Promener des têtes en carton au bout de piques et chanter des couplets aux rimes en guillotine ? Expression d’une intolérable pulsion de mort selon Robert Badinter. Dire comme Ségolène Royal que nous vivons sous en régime autoritaire ? C’est franchir la « ligne rouge… mettre en cause notre démocratie » pour Elisabeth Borne. Parler de dictature ? Cela installe « dans notre société, et de manière séditieuse par des discours politiques extraordinairement coupables, l’idée que nous ne serions plus dans une démocratie… », or chez nous, la démocratie, c’est le débat, dixit Macron.
Une rhétorique se met en place avec ce syllogisme : contester le caractère démocratique du pouvoir équivaudrait à un discours extrémiste, donc ce serait anti-démocratique. Ce à quoi, les adversaires ripostent par des accusations de jupitérisme d’autoritarisme et de complicité avec les super riches : répression et brutalité contre égalité.
Rhétorique
Le joker de l’État de droit annule celui de la violence sociale : c’est celui qui le dit qui l’est, c’est lui qui a commencé et c’est lui qui sort du « cadre républicain ». Aux « on ne peut pas dire… » d’en haut, s’opposent les « on ne peut plus rien dire » d’en bas. Aux reproches de « haine », le sentiment d’être méprisés. À la peur, la colère.
Les historiens nous répondront que l’on est toujours le fasciste de quelqu’un, que de Gaulle fut comparé à Franco ou Hitler, et que, bien avant les gilets jaunes, on accusait des manifestants d’être des séditieux nostalgiques du 6 février 1934. Mais, il n’y a pas que les mots.
L’escalade verbale s’accompagne de gestes. Et pas seulement ceux des actions des forces de l’ordre (yeux crevés par les LDB, lynchages de manifestants filmés et montrés sur les réseaux sociaux), ni les violences des casseurs, black blocs (et plus si affinités). Il y a aussi des gestes symboliques: décrochages de portraits du président, invasion de locaux, jets de robes d’avocats, de livres ou de savates, dos tournés, etc. Chahut au théâtre ou dans des cérémonies de vœux, pompiers mimant leur immolation. Et autres façons de manquer délibérément de respect à ceux qui vous commandent et dont on estime, précisément, qu’il ne vous témoignent pas. Toujours l’effet de symétrie.
Spectacle des tensions
S’ajoute le facteur durée. Personne ne nie les différences sociologiques, idéologiques, culturelles ou autres entre les Gilets jaunes des carrefours et des premiers jours (il y a 63 semaines), et les syndicats qui protestent contre des retraites (plus de 56 jours). Mais, au total il n’y a plus de samedi où les médias ne montrent le spectacle ritualisé des tensions. La banalisation de l’affrontement, physique ou symbolique, s’oppose à un pouvoir dont le programme était d’abolir le conflit, réputé idéologique par nature, au profit des solutions techniques et de la compétition entre « projets ».
Il y a un moment où une guerre de position doit cesser. Par épuisement d’une des parties. Ou alors une suite d’émeutes doit finir par devenir insurrection. Du moins, c’est ce que l’on croyait. Jusqu’à présent, une insurrection, cela demandait l’alliance de plusieurs classes et l’addition de plusieurs rages, un soutien de l’opinion mais aussi des organisations, des croyances partagées, des idéologies voire des utopies, des chefs, sans doute des intellectuels organiques ou médiateurs, une ébauche de projet, un minimum de positivité. Comme le notait ici Régis Debray, les explosions revendicatives de notre époque ne franchissent guère ce seuil et n’annoncent pas de vraies guillotines, ou de vrais goulags. Ni de lendemains qui gazouillent, d’ailleurs.
L’hypothèse serait alors : banalisation de la violence politique de faible intensité, théâtralisation, mini-chaos sur rendez-vous, donc système tolérant une part de chaos et chaos qui se contenterait de moments de spectacles et d’autonomie. Une fonction défoulement amplifiée par les réseaux sociaux, jugent les uns. Une accumulation de forces qui trouveront leur forme, espèrent les autres.
Quand l’Iran se coupe de la Toile pour isoler ses activistes, il révèle une fracture bien plus profonde.
Les succès matériels de la Chine reposent sur une totale discipline idéologique. Imposera-t-elle la correction du Coran et de la Bible ?
Avec ses prises de position sur le coronavirus, Bill Gates est au coeur de la bataille culturelle qui se mène aux États-Unis.
L’« étrange défaite » du coronavirus, faillite industrielle ou intellectuelle ? par Xavier Desmaison
La « gripette » chinoise est devenue une pandémie exponentielle. L’histoire qui l’a emporté est celle de vieux modèles statistiques, dits compartimentaux, optimisés et généralisés grâce à l’informatique. A la portée de tout geek doté de Python et branché sur github, ces modèles se sont imposés aux dirigeants politiques occidentaux par le biais de l’Imperial College de Londres : tout le monde devise du R0 aujourd’hui, et le déconfinement sera adossé sur cet indicateur.