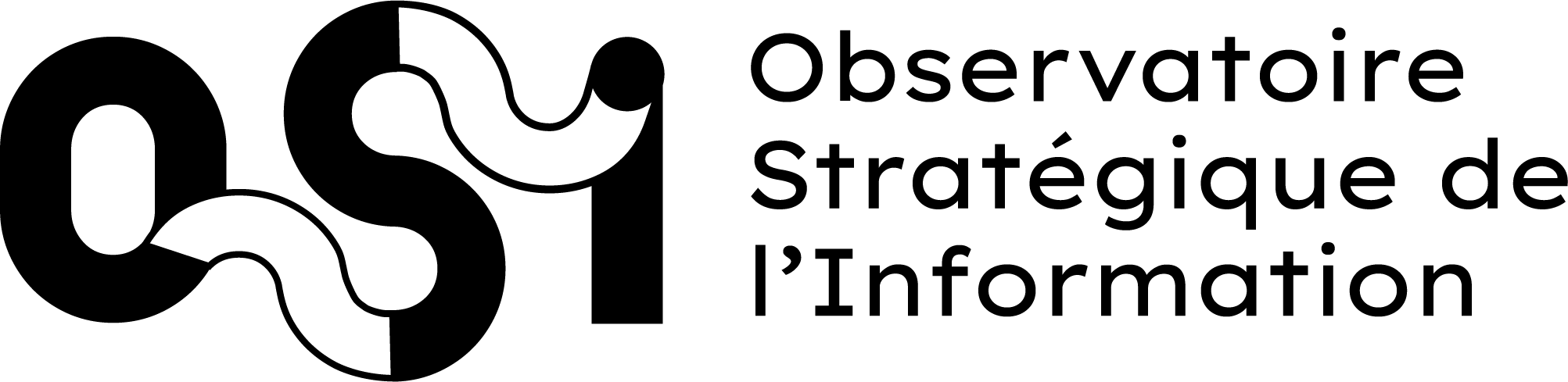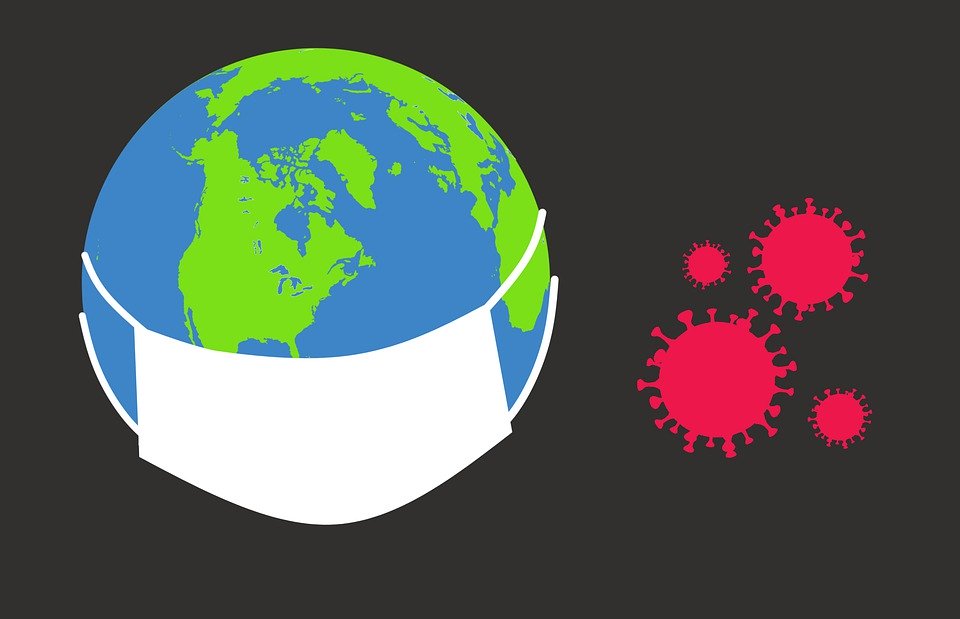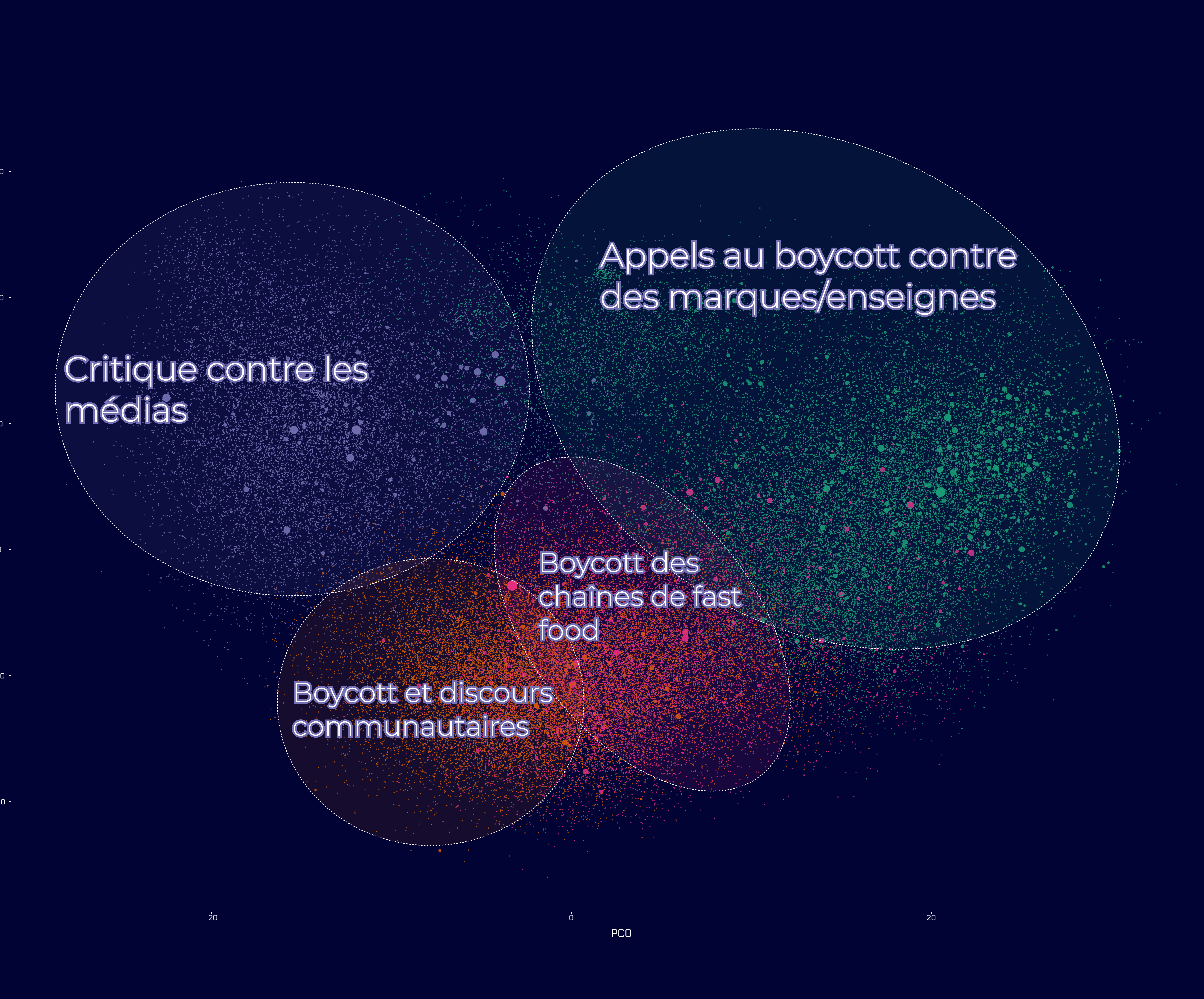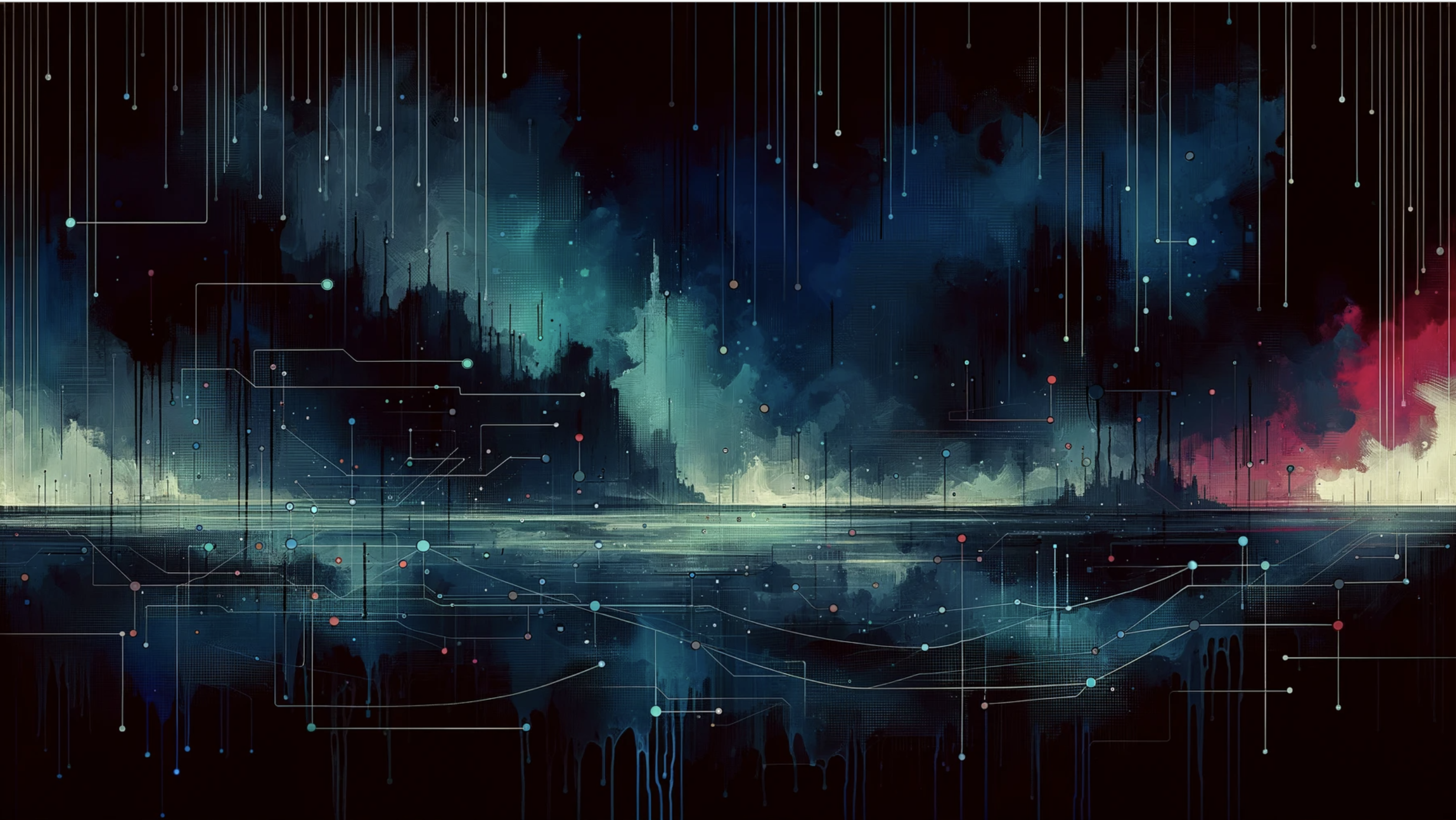Born again
Auteur(s)
Date
Partager
Résumé
On pourrait se gausser de ceux qui rêvent du « monde d’après » et pourtant nous devons penser, de façon urgente, ce qui doit être nouveau, radicalement nouveau.
Auteur(s)
Date
Partager
Résumé
On pourrait se gausser de ceux qui rêvent du « monde d’après » et pourtant nous devons penser, de façon urgente, ce qui doit être nouveau, radicalement nouveau.
On pourrait se gausser de ceux qui rêvent du « monde d’après » et pourtant nous devons penser, de façon urgente, ce qui doit être nouveau, radicalement nouveau.
De monde d’après, plus vertueux, repensé, il n’y aura pas, se dit-on dans les moments de pessimisme. La crise accélère des tendances qui étaient déjà à l’œuvre : immatérialisation des rapports sociaux (du télétravail aux conversations), démondialisation engagée par Donald Trump et le Brexit pour le meilleur et le pire, nouvelles formes de propagande et de contrôle de l’Etat basées sur la tech, « pour notre bien », auxquelles excellent les dictatures les plus habiles. La priorité aujourd’hui n’est pas le rêve, mais bien plutôt la survie. D’un point de vue sanitaire, l’incertitude domine, mais du point de vue économique, une chose est certaine : la situation est catastrophique. Chaque entreprise, chaque Etat, ne va avoir d’autre choix, pour ne pas disparaître, que d’aller au plus court, réduire les coûts, améliorer la productivité, couper dans le superflu, améliorer l’efficacité et la productivité. Le chômage est là, déjà massif aux Etats-Unis, et appelé à croître en Europe malgré les stabilisateurs mis en place par les Etats. Certaines des plus belles avancées de l’économie du partage et de la solidarité sortent fragilisée par les freins mis aux rencontres. Nul besoin de considérer que les dirigeants sont cyniques et ont vendus leur âme aux puissances de l’argent, comme nous le suggèrent certains militants politiques : ils n’auront probablement ni le temps ni les moyens pour redessiner l’économie vers davantage de durabilité et d’impact social. L’heure est à la survie, génératrice de violence. Faut-il s’attendre à ce que les commerçants soient patients avec les blocages des militants d’extinction rébellion ou des gilets jaunes ? Déjà certains s’organisent et en appellent à l’Etat, comme à Toulouse ce week-end. Le même mécanisme peut s’enclencher à l’échelle internationale : la concurrence pour les richesses et la survie pourrait devenir plus sauvage. Certains think tanks chinois commencent à documenter un risque de guerre avec les Etats-Unis. Bref, le monde d’après n’est pas un simple retour au monde d’avant : si « courbe en V » il y a, c’est le vif, le violent, le vacarme qui s’annoncent. Nous sommes au cœur du cyclone.
Et pourtant, chacun pressent bien que l’on ne peut pas faire vivre à autant d’êtres humains cette expérience du confinement, quelle que soit sa radicalité, sans conséquences mentales. Nous avons tous expérimenté, selon notre perméabilité aux informations anxiogènes, notre finitude et celle de nos proches. Nous avons tous vécu une forme d’enfermement et un mode de vie contraint. Voilà une expérience surréelle dont nous sortons, peut-être à fleur de peau, mais changés. Nous voici tous « born gain », dans la longue lignée des grands initiés et des sages : selon ses inspirations, Orphée, Saint Paul ou Georges W. Bush… Qu’estce qui a changé en nous ? Le mieux est d’écouter ce qui murmurait et murmure en nous, à la frontière de l’inconscient, dit mais non entendu, refoulé. Ecoutons ces internautes, pour la plupart de jeunes femmes, qui encombrent le réseau instagram de photographies de « cottage » (#cottagelife : 1 448 556 publications), de nature luxuriante, de pluie qui tombe, de tartes au fruit, de plantes et de nature. La course angoissante des mails et des sms, le bruit des voitures et la violence des rapports sociaux, ils espèrent les fuir.
Ecoutons nos millenals se détourner des « bullshit jobs », dans la foulée du professeur de la LSE David Graeber, et critiquer ces tâches dénuées de sens que nos métropoles mondialisées leur imposent et préfèrent les métiers du faire et du care. Ecoutons les gilets jaunes et leur quête désordonnée de ne plus être laissés pour compte par un pouvoir et une société qu’ils ressentent comme méprisant et irrespectueux. Le monde d’avant était en burn-out. Avec le coronavirus, nous avons mis sous cloche notre société en crise nerveuse. Tout le monde dans sa cabane ! On arrête tout. Sauf que le monde à la sortie est dans un état encore plus sauvage qu’il ne l’était auparavant. Nombreux étaient ceux, dans les universités, les entreprises, les administrations, les associations, qui travaillaient inventer de quoi améliorer le rapport des êtres humains à leurs conditions matérielles d’existence : raison d’être, économie solidaire, responsabilité, ESG… « Ou atterrir ? », se demandaient-ils à la suite du philosophe Bruno Latour. Il est encore plus difficile mais plus que jamais nécessaire de chercher les solutions. Nous savons que même à l’échelle de l’Etat l’incertitude ouvre la voie des possibles. Barack Obama s’amusait il y a quelques jours de ce que les Américains ont tous compris que leurs dirigeants ne savaient pas où ils allaient.
Plaisanterie à part, cela veut dire que tout est possible. La piste à emprunter est à entendre dans les premières réactions de « born gain » de ceux qui ont inspiré le monde d’avant. Les analystes et dirigeants du gestionnaire d’actifs Blackrock, la société détestée des activistes sociaux, continuent à promouvoir la durabilité (« sustainability ») dans les sociétés qu’ils ont en portefeuille. Parce que l’engagement dans des stratégies durables force à mettre en place des stratégies de résilience, cette capacité à se remettre des crises, voire à prospérer. Si le coronavirus doit inspirer les dirigeants, il est dans le fait que les risques doivent être pris au sérieux. Ils ne se gèrent pas en truquant l’outil qui mesure les émissions de gaz à effet de serre du moteur de la voiture, ni en installant un logiciel qui pallie un défaut de conception de l’avion. Le coronavirus rappelle le décideur à sa responsabilité face au collectif d’humains avec qui il interagit. Mais lisons aussi un message récent du gourou de la tech Marc Andreessen. Il était le prophète de la numérisation du monde. Pour lui, le logiciel devait manger le monde (« software is eating the world »), les « barbares » des start-ups venir à bout des vieilles industries, les dématérialiser et les disrupter. Il exprime aujourd’hui la nécessité de bâtir et de fabriquer (« build »), des logements, des universités, des hôpitaux, de réorienter les investissements vers ce qui sert concrètement la vie de chacun. Nous avons tous vu que cette tech qui nous promettait la « mort de la mort » dans la version transhumaniste chère aux patrons de Google se retrouve démunie face aux besoins prosaïques de masques, de blouses et de tests utiles pour lutter contre le Coronavirus. Les innovations des quarante dernières années n’ont pas apporté de progrès significatif en termes d’espérance de vie dans nos sociétés. Elles n’ont pas amélioré la qualité de l’information et du débat dans nos démocraties ni augmenté le QI de chaque individu, peu s’en faut. Bâtir et construire de façon plus durable, peut-être plus lente, des solutions qui améliorent fondamentalement la vie des gens, voilà la piste à suivre.
On pourrait se gausser de ceux qui rêvent du « monde d’après » et pourtant nous devons penser, de façon urgente, ce qui doit être nouveau, radicalement nouveau.
De monde d’après, plus vertueux, repensé, il n’y aura pas, se dit-on dans les moments de pessimisme. La crise accélère des tendances qui étaient déjà à l’œuvre : immatérialisation des rapports sociaux (du télétravail aux conversations), démondialisation engagée par Donald Trump et le Brexit pour le meilleur et le pire, nouvelles formes de propagande et de contrôle de l’Etat basées sur la tech, « pour notre bien », auxquelles excellent les dictatures les plus habiles. La priorité aujourd’hui n’est pas le rêve, mais bien plutôt la survie. D’un point de vue sanitaire, l’incertitude domine, mais du point de vue économique, une chose est certaine : la situation est catastrophique. Chaque entreprise, chaque Etat, ne va avoir d’autre choix, pour ne pas disparaître, que d’aller au plus court, réduire les coûts, améliorer la productivité, couper dans le superflu, améliorer l’efficacité et la productivité. Le chômage est là, déjà massif aux Etats-Unis, et appelé à croître en Europe malgré les stabilisateurs mis en place par les Etats. Certaines des plus belles avancées de l’économie du partage et de la solidarité sortent fragilisée par les freins mis aux rencontres. Nul besoin de considérer que les dirigeants sont cyniques et ont vendus leur âme aux puissances de l’argent, comme nous le suggèrent certains militants politiques : ils n’auront probablement ni le temps ni les moyens pour redessiner l’économie vers davantage de durabilité et d’impact social. L’heure est à la survie, génératrice de violence. Faut-il s’attendre à ce que les commerçants soient patients avec les blocages des militants d’extinction rébellion ou des gilets jaunes ? Déjà certains s’organisent et en appellent à l’Etat, comme à Toulouse ce week-end. Le même mécanisme peut s’enclencher à l’échelle internationale : la concurrence pour les richesses et la survie pourrait devenir plus sauvage. Certains think tanks chinois commencent à documenter un risque de guerre avec les Etats-Unis. Bref, le monde d’après n’est pas un simple retour au monde d’avant : si « courbe en V » il y a, c’est le vif, le violent, le vacarme qui s’annoncent. Nous sommes au cœur du cyclone.
Et pourtant, chacun pressent bien que l’on ne peut pas faire vivre à autant d’êtres humains cette expérience du confinement, quelle que soit sa radicalité, sans conséquences mentales. Nous avons tous expérimenté, selon notre perméabilité aux informations anxiogènes, notre finitude et celle de nos proches. Nous avons tous vécu une forme d’enfermement et un mode de vie contraint. Voilà une expérience surréelle dont nous sortons, peut-être à fleur de peau, mais changés. Nous voici tous « born gain », dans la longue lignée des grands initiés et des sages : selon ses inspirations, Orphée, Saint Paul ou Georges W. Bush… Qu’estce qui a changé en nous ? Le mieux est d’écouter ce qui murmurait et murmure en nous, à la frontière de l’inconscient, dit mais non entendu, refoulé. Ecoutons ces internautes, pour la plupart de jeunes femmes, qui encombrent le réseau instagram de photographies de « cottage » (#cottagelife : 1 448 556 publications), de nature luxuriante, de pluie qui tombe, de tartes au fruit, de plantes et de nature. La course angoissante des mails et des sms, le bruit des voitures et la violence des rapports sociaux, ils espèrent les fuir.
Ecoutons nos millenals se détourner des « bullshit jobs », dans la foulée du professeur de la LSE David Graeber, et critiquer ces tâches dénuées de sens que nos métropoles mondialisées leur imposent et préfèrent les métiers du faire et du care. Ecoutons les gilets jaunes et leur quête désordonnée de ne plus être laissés pour compte par un pouvoir et une société qu’ils ressentent comme méprisant et irrespectueux. Le monde d’avant était en burn-out. Avec le coronavirus, nous avons mis sous cloche notre société en crise nerveuse. Tout le monde dans sa cabane ! On arrête tout. Sauf que le monde à la sortie est dans un état encore plus sauvage qu’il ne l’était auparavant. Nombreux étaient ceux, dans les universités, les entreprises, les administrations, les associations, qui travaillaient inventer de quoi améliorer le rapport des êtres humains à leurs conditions matérielles d’existence : raison d’être, économie solidaire, responsabilité, ESG… « Ou atterrir ? », se demandaient-ils à la suite du philosophe Bruno Latour. Il est encore plus difficile mais plus que jamais nécessaire de chercher les solutions. Nous savons que même à l’échelle de l’Etat l’incertitude ouvre la voie des possibles. Barack Obama s’amusait il y a quelques jours de ce que les Américains ont tous compris que leurs dirigeants ne savaient pas où ils allaient.
Plaisanterie à part, cela veut dire que tout est possible. La piste à emprunter est à entendre dans les premières réactions de « born gain » de ceux qui ont inspiré le monde d’avant. Les analystes et dirigeants du gestionnaire d’actifs Blackrock, la société détestée des activistes sociaux, continuent à promouvoir la durabilité (« sustainability ») dans les sociétés qu’ils ont en portefeuille. Parce que l’engagement dans des stratégies durables force à mettre en place des stratégies de résilience, cette capacité à se remettre des crises, voire à prospérer. Si le coronavirus doit inspirer les dirigeants, il est dans le fait que les risques doivent être pris au sérieux. Ils ne se gèrent pas en truquant l’outil qui mesure les émissions de gaz à effet de serre du moteur de la voiture, ni en installant un logiciel qui pallie un défaut de conception de l’avion. Le coronavirus rappelle le décideur à sa responsabilité face au collectif d’humains avec qui il interagit. Mais lisons aussi un message récent du gourou de la tech Marc Andreessen. Il était le prophète de la numérisation du monde. Pour lui, le logiciel devait manger le monde (« software is eating the world »), les « barbares » des start-ups venir à bout des vieilles industries, les dématérialiser et les disrupter. Il exprime aujourd’hui la nécessité de bâtir et de fabriquer (« build »), des logements, des universités, des hôpitaux, de réorienter les investissements vers ce qui sert concrètement la vie de chacun. Nous avons tous vu que cette tech qui nous promettait la « mort de la mort » dans la version transhumaniste chère aux patrons de Google se retrouve démunie face aux besoins prosaïques de masques, de blouses et de tests utiles pour lutter contre le Coronavirus. Les innovations des quarante dernières années n’ont pas apporté de progrès significatif en termes d’espérance de vie dans nos sociétés. Elles n’ont pas amélioré la qualité de l’information et du débat dans nos démocraties ni augmenté le QI de chaque individu, peu s’en faut. Bâtir et construire de façon plus durable, peut-être plus lente, des solutions qui améliorent fondamentalement la vie des gens, voilà la piste à suivre.
Quand ceux qui n’ont plus rien partagent le symbole du grotesque et de la vengeance, leur défi nihiliste nous annonce un singulier retour du conflit.
Le chiffre global tétanise : 33.769 attentats «islamistes» (se réclamant d’un projet d’établissement de la charia et/ou du califat) ont couté la vie à au moins 167.096 personnes.
Les black blocs, groupe affinitaire et temporaire, excellent dans la programmation numérique de l’action physique. Nihilisme symbolique et individualisme surexcité, le tout sur fond de communautés numériques : c’est bien la troisième génération de la révolte dont parle Régis Debray : sans contre-projet, mais dans l’action comme révélation de soi.
Quand l’Iran se coupe de la Toile pour isoler ses activistes, il révèle une fracture bien plus profonde.