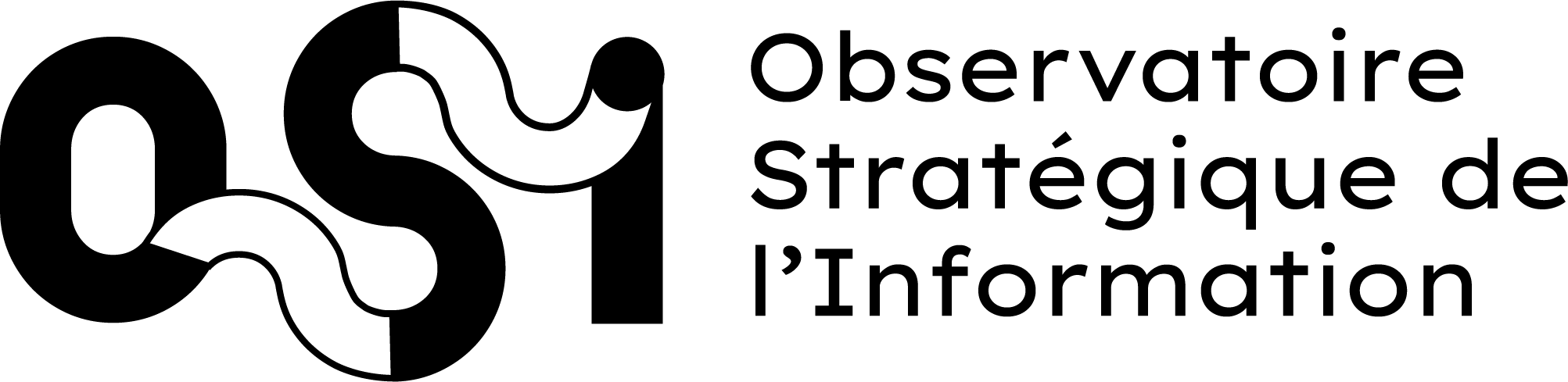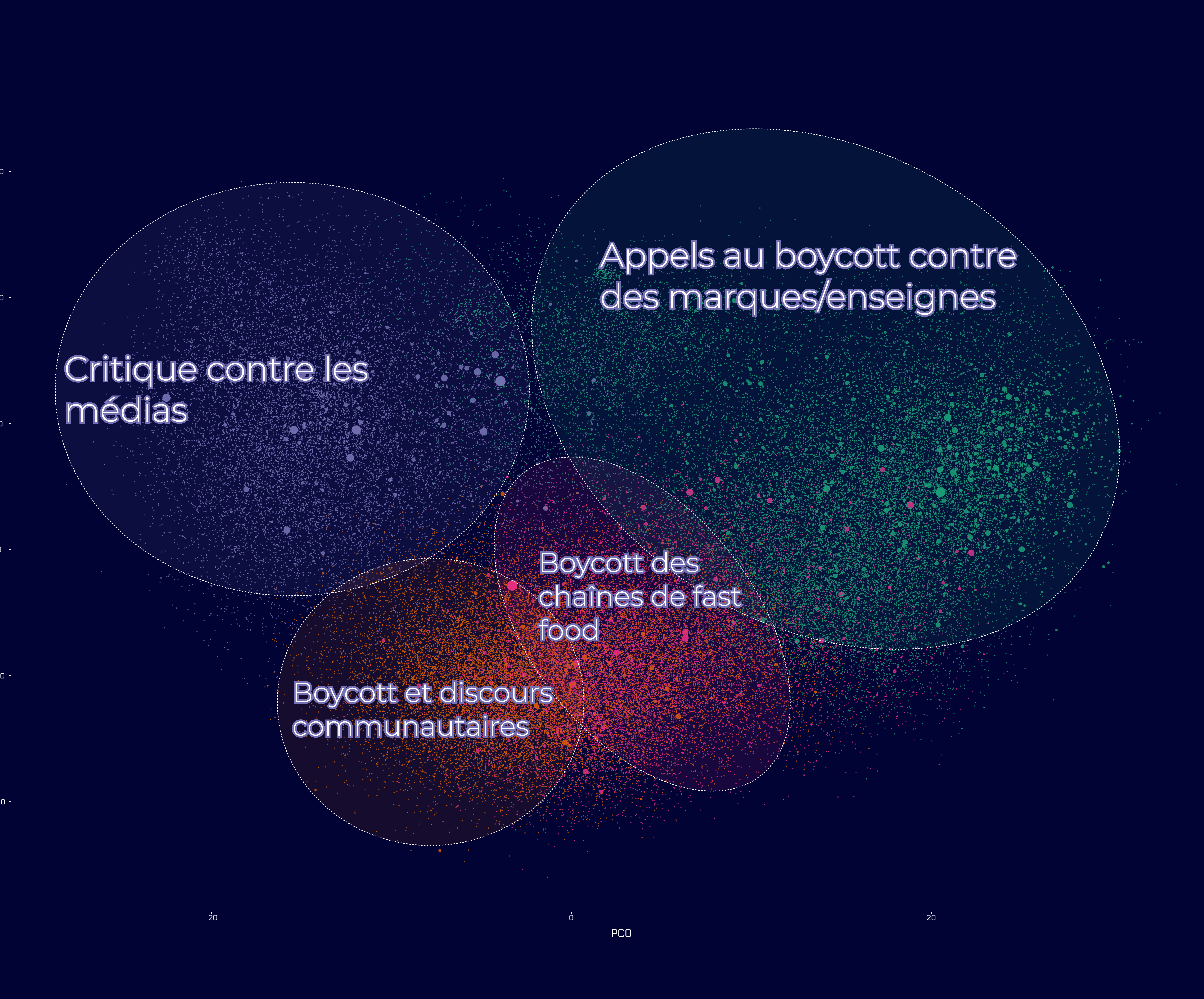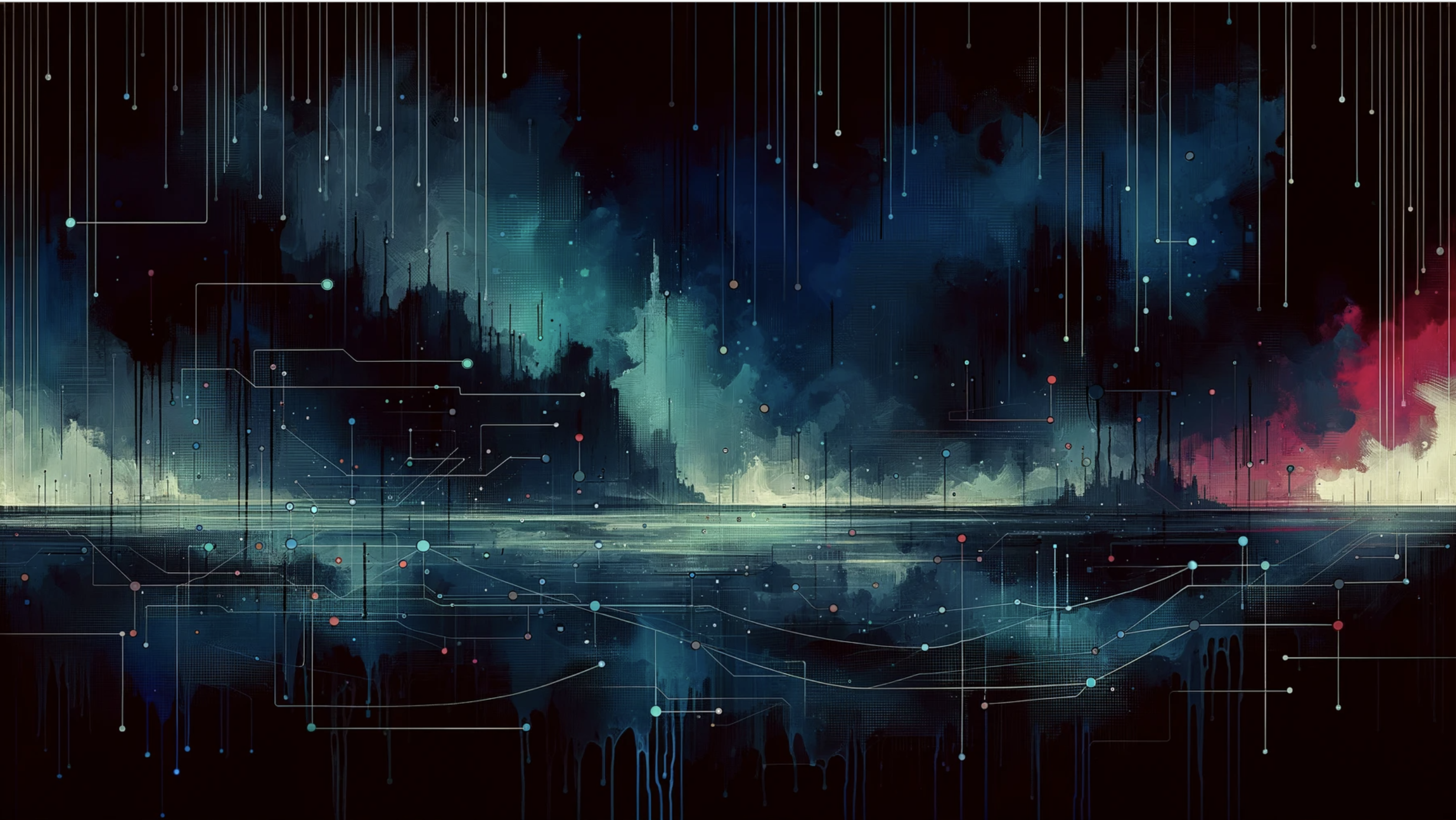Les temps sont-ils durs pour le soft power ?
Auteur(s)
Date
Partager
Résumé
Le pouvoir doux cher aux élites reste un pouvoir. Donc susceptible de rencontrer des résistances d’affronter d’autres pouvoirs.
Auteur(s)
Date
Partager
Résumé
Le pouvoir doux cher aux élites reste un pouvoir. Donc susceptible de rencontrer des résistances d’affronter d’autres pouvoirs.
L’inventeur de l’expression (1993) est Joseph S. Nye, sous-secrétaire d’État à la Défense sous Clinton. Son idée est simple : après la chute de l’URSS, les États-Unis prédominaient déjà par la puissance du dollar et de l’US Army, leur PIB et les alliances type OTAN… Nye préconise alors une stratégie complémentaire : exploiter le pouvoir « doux » de l’Amérique ; dans un monde sans compétiteur majeur, il s’agirait d’amener les autres à « vouloir ce que nous voulons ». L’idée est de « faire l’agenda de la politique mondiale et d’attirer les autres ». Attirer ? Nye recommande de jouer au maximum sur le prestige des USA et sur l’attrait de sa culture de masse, sur son mode de vie que tout le monde veut copier, sa technologie, ses réseaux, sur les élites mondiales et leur mentalité. Le soft power résulte d’un mélange d’Hollywood et de Harvard, de Mac Donald et de Microsoft, de blockbusters et de droits de l’homme. En prônant une politique étrangère « multilatérale » (signer des traités et laisser s’exprimer ses alliés), l’Amérique, nation d’exception, manifesterait plus complètement encore sa vocation universelle. Pour le dire autrement : une bonne image, de bons messages, de bons produits, de bons réseaux, de bons alliés, de la bonne volonté, une bonne formation des dirigeants… et tout le monde vous aime. Susciter l’imitation, propager ses codes et ses idées, manifester sa bienveillance, … La recette a l’air simple et on comprend que le concept ait été adopté partout.
Tous softs ?
Ce discours est typique de la décennie 1990, par sa confiance en l’élargissement (enlargment) du modèle politique, économique et culturel US. Il mêle joyeusement valeurs et richesses, formatage culturel et attitude d’ouverture, prospérité et modernité. Une mentalité plutôt démocrate, les Républicains ayant en leur temps préconisé une « diplomatie publique » contre le bloc soviétique. Cela implique : lutte idéologique par médias interposés, mobilisation de la culture, et de réseaux de jeunes dirigeants. Au fil du temps, à mesure que les démocrates s’engagent contre « l’extrémisme » (jihadisme, nationalisme, populismes), ils réinventent propagande idéologique et guerre psychologique. Du coup, la distinction entre une gauche plus cool et une droite plus offensive quand il s’agit de défendre le modèle américain perd de sa pertinence.
Le soft power tend à assimiler excellence ou séduction à fin de l’hostilité. Ce que démentiront des événements comme le onze septembre et quelques guerres des deux dernières décennies. Du coup, Nye rectifie le tir en disant qu’il faut recourir aussi au smart power. Ce pouvoir serait « intelligent » en ce qu’il recourrait à la force, aux sanctions et à la contrainte dans les cas strictement nécessaires. Carotte plus bâton. Obama semble illustrer ce programme. Il fut à la fois un séducteur, avec des millions de fans dans le monde, recevant le prix Noble et adoré par les médias, etc. et restant le président qui fut le plus de guerres et les plus longues dans l’histoire de son pays.
Notion passablement molle et se prêtant à tous les compromis (ou toutes les interprétations), le soft power s’est popularisé dans le monde entier, si bien que l’on parle désormais de soft power chinois, français, canadien. Cela ressemble à une sorte de bonne réputation de la Nation mesurée par des sondages et classements internationaux (où l’on mêle joyeusement attractivité touristique, engagement pour les causes humanitaires voire physique sexy du président pour aboutir à un indice).
Le retour du conflit
L’idée que le soft power est une sorte de panacée ou de saint Graal se heurte à deux évidences.
La première est qu’il n’y a aucun modèle universel. Nous savions déjà que l’on pouvait adorer Nike et les Ray Ban et faire le jihad. À l’échelle des nations, des milliards d’Indiens ou de Chinois désirent certes acquérir la prospérité américaine (et y parviendront sans doute) mais n’ont en aucune manière adopté les mœurs, la culture ou la mentalité. Il se pourrait même qu’ils la méprisent. L’idée que la prédominance culturelle et idéologique US, soutenue par des images et par un corpus – codes et convictions- , aille dans le sens de l’Histoire (ou qu’elle soit déterminée en dernière instance par la croissance et la technologie) est carrément naïve. Le monde est multipolaire dans les têtes aussi.
La seconde est que soft power est fragile. Né de l’image, il s’incarne souvent en un homme ou se perd avec un homme. On songe forcément à Trump dont la brutalité affichée et l’égoïsme national assumé ont certainement fait beaucoup contre ce fameux soft power américain. Trump le vociférant évoque tout sauf la sympathie ou la séduction. Certains commencent à rêver à une sorte de restauration ; il part, un gentil revient au service d’un monde réconcilié. Un peu plus cools, plus inclusifs, plus écolos, plus démocrates, en somme, nous regagnons notre influence.
Toutes ces questions prennent sens dans la perspective d’une élection de Biden en novembre prochain. Celle-ci, facilitée par l’incapacité de Donald le Hard face à l’épidémie et aux émeutes, est rendue très vraisemblable par l’écart des sondages (bien supérieur à ceux de 2016).
Si Biden le candidat démocrate est élu le 3 novembre, nous pouvons parier que l’on chantera et que l’on dansera dans les grandes métropoles du monde. Et que le lendemain, les éditorialistes et les élites internationales annonceront une ère de détente et de reconquête des populations de la planète : démocratie, marché ouverture, croissance soutenable, mutliculturalisme, individualisme libéral libertaire… On efface tout et on recommence ?
Or, outre la réticence mondiale à adopter les « valeurs occidentales », la population américaine (comme d’autres en Europe à divers degrés) est incroyablement fracturée entre les « everywhere » urbains diplômés imprégnés partisans de la mondialisation ouverte et leurs alliés d’une part, et les « somewhere » périphériques sans grand avenir et inquiets pour leur sécurité et leur identité. Bloc élitaire et bloc populaire pour simplifier. Ceux d’en bas adhèrent de moins en moins à l’hégémonie culturelle de ceux d’en haut. La lutte des classes s’intensifie et se traduit par la fracture des mentalités qu’il s’agisse des questions culturelles ou régaliennes, sociétales ou sociales. Un soft power qui ne s’impose pas à sa propre population et s’identifie aux couches supérieures perd en influence externe ce qui lui manque en cohésion interne. On peut, d’ailleurs, transposer certaines de ces hypothèses en France.
Le pouvoir doux cher aux élites reste un pouvoir. Donc susceptible de rencontrer des résistances d’affronter d’autres pouvoirs.
L’inventeur de l’expression (1993) est Joseph S. Nye, sous-secrétaire d’État à la Défense sous Clinton. Son idée est simple : après la chute de l’URSS, les États-Unis prédominaient déjà par la puissance du dollar et de l’US Army, leur PIB et les alliances type OTAN… Nye préconise alors une stratégie complémentaire : exploiter le pouvoir « doux » de l’Amérique ; dans un monde sans compétiteur majeur, il s’agirait d’amener les autres à « vouloir ce que nous voulons ». L’idée est de « faire l’agenda de la politique mondiale et d’attirer les autres ». Attirer ? Nye recommande de jouer au maximum sur le prestige des USA et sur l’attrait de sa culture de masse, sur son mode de vie que tout le monde veut copier, sa technologie, ses réseaux, sur les élites mondiales et leur mentalité. Le soft power résulte d’un mélange d’Hollywood et de Harvard, de Mac Donald et de Microsoft, de blockbusters et de droits de l’homme. En prônant une politique étrangère « multilatérale » (signer des traités et laisser s’exprimer ses alliés), l’Amérique, nation d’exception, manifesterait plus complètement encore sa vocation universelle. Pour le dire autrement : une bonne image, de bons messages, de bons produits, de bons réseaux, de bons alliés, de la bonne volonté, une bonne formation des dirigeants… et tout le monde vous aime. Susciter l’imitation, propager ses codes et ses idées, manifester sa bienveillance, … La recette a l’air simple et on comprend que le concept ait été adopté partout.
Tous softs ?
Ce discours est typique de la décennie 1990, par sa confiance en l’élargissement (enlargment) du modèle politique, économique et culturel US. Il mêle joyeusement valeurs et richesses, formatage culturel et attitude d’ouverture, prospérité et modernité. Une mentalité plutôt démocrate, les Républicains ayant en leur temps préconisé une « diplomatie publique » contre le bloc soviétique. Cela implique : lutte idéologique par médias interposés, mobilisation de la culture, et de réseaux de jeunes dirigeants. Au fil du temps, à mesure que les démocrates s’engagent contre « l’extrémisme » (jihadisme, nationalisme, populismes), ils réinventent propagande idéologique et guerre psychologique. Du coup, la distinction entre une gauche plus cool et une droite plus offensive quand il s’agit de défendre le modèle américain perd de sa pertinence.
Le soft power tend à assimiler excellence ou séduction à fin de l’hostilité. Ce que démentiront des événements comme le onze septembre et quelques guerres des deux dernières décennies. Du coup, Nye rectifie le tir en disant qu’il faut recourir aussi au smart power. Ce pouvoir serait « intelligent » en ce qu’il recourrait à la force, aux sanctions et à la contrainte dans les cas strictement nécessaires. Carotte plus bâton. Obama semble illustrer ce programme. Il fut à la fois un séducteur, avec des millions de fans dans le monde, recevant le prix Noble et adoré par les médias, etc. et restant le président qui fut le plus de guerres et les plus longues dans l’histoire de son pays.
Notion passablement molle et se prêtant à tous les compromis (ou toutes les interprétations), le soft power s’est popularisé dans le monde entier, si bien que l’on parle désormais de soft power chinois, français, canadien. Cela ressemble à une sorte de bonne réputation de la Nation mesurée par des sondages et classements internationaux (où l’on mêle joyeusement attractivité touristique, engagement pour les causes humanitaires voire physique sexy du président pour aboutir à un indice).
Le retour du conflit
L’idée que le soft power est une sorte de panacée ou de saint Graal se heurte à deux évidences.
La première est qu’il n’y a aucun modèle universel. Nous savions déjà que l’on pouvait adorer Nike et les Ray Ban et faire le jihad. À l’échelle des nations, des milliards d’Indiens ou de Chinois désirent certes acquérir la prospérité américaine (et y parviendront sans doute) mais n’ont en aucune manière adopté les mœurs, la culture ou la mentalité. Il se pourrait même qu’ils la méprisent. L’idée que la prédominance culturelle et idéologique US, soutenue par des images et par un corpus – codes et convictions- , aille dans le sens de l’Histoire (ou qu’elle soit déterminée en dernière instance par la croissance et la technologie) est carrément naïve. Le monde est multipolaire dans les têtes aussi.
La seconde est que soft power est fragile. Né de l’image, il s’incarne souvent en un homme ou se perd avec un homme. On songe forcément à Trump dont la brutalité affichée et l’égoïsme national assumé ont certainement fait beaucoup contre ce fameux soft power américain. Trump le vociférant évoque tout sauf la sympathie ou la séduction. Certains commencent à rêver à une sorte de restauration ; il part, un gentil revient au service d’un monde réconcilié. Un peu plus cools, plus inclusifs, plus écolos, plus démocrates, en somme, nous regagnons notre influence.
Toutes ces questions prennent sens dans la perspective d’une élection de Biden en novembre prochain. Celle-ci, facilitée par l’incapacité de Donald le Hard face à l’épidémie et aux émeutes, est rendue très vraisemblable par l’écart des sondages (bien supérieur à ceux de 2016).
Si Biden le candidat démocrate est élu le 3 novembre, nous pouvons parier que l’on chantera et que l’on dansera dans les grandes métropoles du monde. Et que le lendemain, les éditorialistes et les élites internationales annonceront une ère de détente et de reconquête des populations de la planète : démocratie, marché ouverture, croissance soutenable, mutliculturalisme, individualisme libéral libertaire… On efface tout et on recommence ?
Or, outre la réticence mondiale à adopter les « valeurs occidentales », la population américaine (comme d’autres en Europe à divers degrés) est incroyablement fracturée entre les « everywhere » urbains diplômés imprégnés partisans de la mondialisation ouverte et leurs alliés d’une part, et les « somewhere » périphériques sans grand avenir et inquiets pour leur sécurité et leur identité. Bloc élitaire et bloc populaire pour simplifier. Ceux d’en bas adhèrent de moins en moins à l’hégémonie culturelle de ceux d’en haut. La lutte des classes s’intensifie et se traduit par la fracture des mentalités qu’il s’agisse des questions culturelles ou régaliennes, sociétales ou sociales. Un soft power qui ne s’impose pas à sa propre population et s’identifie aux couches supérieures perd en influence externe ce qui lui manque en cohésion interne. On peut, d’ailleurs, transposer certaines de ces hypothèses en France.
Le pouvoir doux cher aux élites reste un pouvoir. Donc susceptible de rencontrer des résistances d’affronter d’autres pouvoirs.
Nous avons un quart de siècle de recul à la fois pour mesurer l’efficacité d’une intention et juger de sa cohérence. Ce qui pourrait se formuler ainsi : comment a-t-on « scientifiquement » défini la valeur universelle pour en faire une catégorie juridique ? Plus malicieusement : comment des représentants d’États ont-ils parlé au nom de l’humanité ou des générations futures et oublié leurs intérêts nationaux ou leurs revendications identitaires ? Plus médiologiquement : comment une organisation matérialisée (le Comité qui établit la liste, des ONG, des experts qui le conseillent…) a-t-elle transformé une croyance générale en fait pratique ? Comment est-on passé de l’hyperbole au règlement ? De l’idéal à la subvention ?
En venant briser la réputation et l’autorité d’un candidat, en venant saper les fondements du discours officiel et légitime d’un État, les fake news et autres logiques de désinformation, viennent mettre au jour l’idée d’un espace public souverain potentiellement sous influence d’acteurs exogènes.
Nos sociétés de l'information exaltent volontiers la transparence. En politique, elle doit favoriser la gouvernance : plus d'ententes clandestines, de manoeuvres antidémocratiques obscures, d'intérêts occultes, de crimes enfouis. En économie, on voit en elle une garantie contre les défauts cachés, les erreurs et les tricheries, donc un facteur de sécurité et de progrès. Et, moralement, la transparence semble garantir la confiance entre ceux qui n'ont rien à se reprocher. Dans ces conditions, il est difficile de plaider pour le secret. Ou au moins pour sa persistance, voire sa croissance. Et pourtant...
L’image de citadelle assiégée renvoyée par Madrid au moment de la crise catalane soulève de nombreuses questions, et interroge sur la propension que peuvent avoir certains acteurs politiques à tendre vers des logiques d’exception au nom d’une lutte contre une menace informationnelle et/ou pour défendre un système démocratique en proie à de prétendues attaques exogènes.