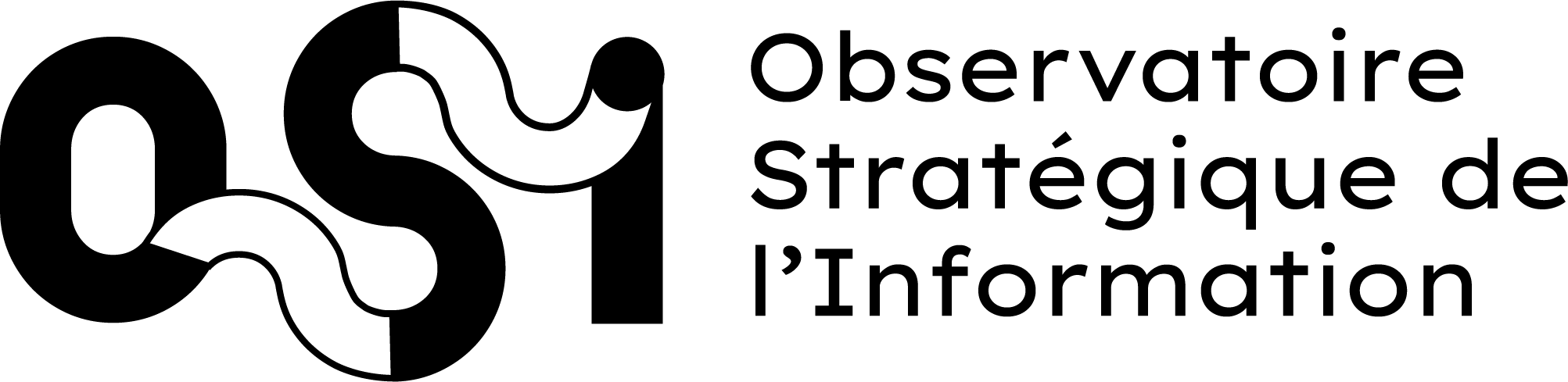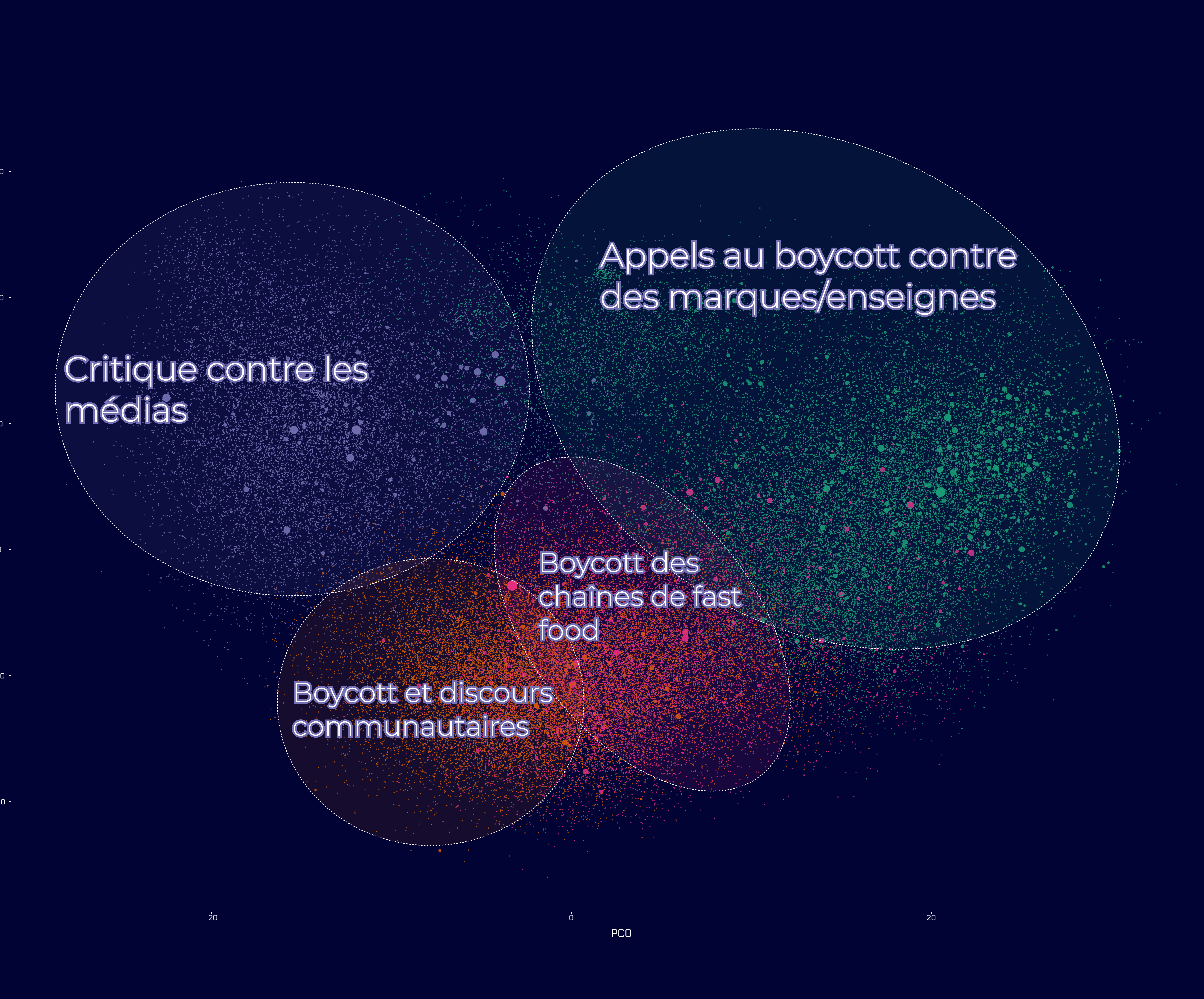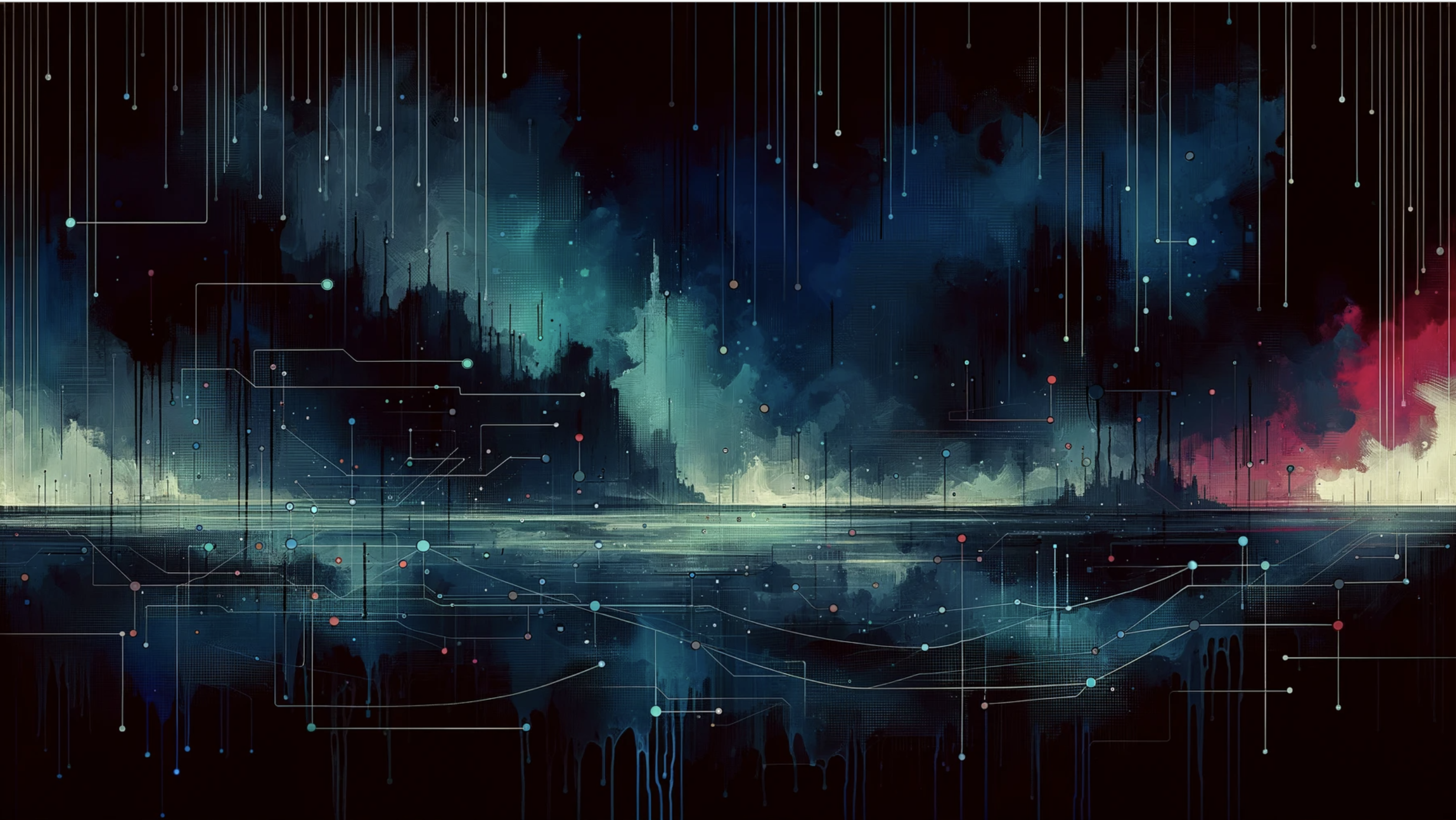Quelles leçons tirer des élections US pour la prochaine présidentielle française ?
Auteur(s)
Date
Partager
Résumé
Gestion du risque Covid-19, interventionnisme accru des réseaux sociaux, importance démultipliée de l’analyse d’opinion, des bases de données et des nouveaux vecteurs d’influence : la campagne présidentielle américaine de 2020 apparaît moins marquée par l’irruption d’innovations radicales que par l’adaptation à de nouvelles contraintes, tant sanitaires que numériques.
Auteur(s)
Date
Partager
Résumé
Gestion du risque Covid-19, interventionnisme accru des réseaux sociaux, importance démultipliée de l’analyse d’opinion, des bases de données et des nouveaux vecteurs d’influence : la campagne présidentielle américaine de 2020 apparaît moins marquée par l’irruption d’innovations radicales que par l’adaptation à de nouvelles contraintes, tant sanitaires que numériques.
Alors que les élections américaines apparaissent (enfin) toucher à leur ultime dénouement, la France s’apprête quant à elle à rentrer, à nouveau, dans une séquence électorale aux allures de marathon politique. Des régionales aux législatives en passant par les présidentielles, les départementales et les immanquables primaires de toute sorte : la succession des échéances (sauf report) devrait amener la France à renouveler une part très importante de son personnel politique en un peu plus d’un an.
Les élections américaines, qui atteignent un certain nombre de masses critiques nécessaires à l’innovation en matière de campaigning (en termes financiers, réglementaires ou de capacité d’innovation via la présence d’un écosystème tech spécifique), ont souvent fourni d’intéressants sujets d’études de ce côté-ci de l’Atlantique, infiniment plus modestes en comparaison. La campagne couramment qualifiée de data driven de Barack Obama en 2008 tout comme l’attribution de la victoire de Donald Trump en 2016 à la maîtrise du continuum entre étude d’opinion digitale et le micro ciblage publicitaire (avec le soutien, plus ou moins effectif, de Cambridge Analytica) sont apparues annonciatrices de méthodes radicalement nouvelles de faire campagne, plus ou moins transposables en France.
S’il est encore un peu tôt pour prétendre tirer toutes les leçons des élections américaines, gageons que la campagne de 2020 a été moins caractérisée par l’apport d’innovations de rupture que par l’adaptation à une nouvelle série de contraintes (sanitaires et numériques), qui, parce que celles-ci sont de nature globale, devraient peser de la même manière sur les prochains scrutins en France.
Un risque sanitaire pesant sur le déroulement de la campagne
Si les conjectures les plus rassurantes, confortées par les déclarations des laboratoires et des gouvernements, tablent sur le déploiement de vaccins efficaces dans les tous prochains mois, avec déjà de premières campagnes dans certains pays, comme au Royaume-Uni par exemple, la persistance du risque sanitaire entre le printemps 2021 et l’été 2022 paraît toujours constituer une hypothèse crédible. Sans aller jusqu’à évoquer un confinement pendant la campagne présidentielle, ou d’autres mesures restrictives similaires (qui, sans pouvoir être écartées, n’en sont qu’hypothétiques à ce stade), il y a fort à parier que celles-ci ne devraient pas se traduire par un retour au monde d’avant.
Les images de salles bondées, où les militants en rangs serrés acclament, chantent et applaudissent leur candidat, paraissent pour le moment inimaginables, sur la base des connaissances que nous avons sur le Covid-19, grâce aux travaux statistiques de modélisation du phénomène réalisés ces derniers mois. Si ces images de rallies gigantesques cadraient parfaitement bien avec la défense de la liberté individuelle chère à l’électorat républicain, et notamment ses franges issues du Tea Party converties depuis au trumpisme, contre la politique du « lockdown » défendue par les démocrates et à la stratégie de « business as usual » en matière de gestion de la pandémie du président américain défait, on image mal en France un candidat prendre le risque politique de déclencher un cluster parmi ses propres troupes – au risque de s’exposer aux critiques, à l’heure où les oppositions et le gouvernement rivalisent d’imagination en matière de contraintes sanitaires. D’autant qu’une telle situation entraînerait probablement des contaminations dans les équipes de campagne (comme ce fut le cas pour Donald Trump lui-même, une partie de son staff et pour son avocat Rudy Giuliani, dans la phase post Election Day), ou du moins l’immobilisation de ses déplacements pour cause de quarantaine.
Pour peu que des réunions physiques se maintiennent, ne serait-ce qu’à des fins symboliques ou en marge de déplacements, celles-ci pourraient plutôt s’apparenter aux meetings intimistes de Joe Biden, dont la modestie a tant fait glousser, en comparaison des shows à l’américaine de son concurrent avec musique country et arrivée sur les tarmacs d’aéroports des battlegrounds states avec Air Force One. La victoire du candidat démocrate semble du reste indiquer, en partie, qu’en période de crise sanitaire, les grand-messes militantes ne sont pas nécessairement indispensables pour gagner.
Des budgets réaffectés de l’événementiel vers le numérique
Au-delà de prédire la florescence de meetings Zoom (qui du reste, se sont déjà déroulés durant le confinement), la réelle nouveauté serait plutôt à rechercher du point de vue budgétaire. L’organisation des « réunions publiques » engloutissent habituellement des sommes conséquentes en réservation de salles, logistique, sécurité, son et éclairage. Dans un contexte de crise sanitaire, il paraît peu probable que la réservation du Parc des Expositions ou de l’AccorHotels Arena vidées de leurs foules de supporters hurlants puissent présenter le même intérêt stratégique. Bien au contraire, en termes de « démonstration de force », une telle stratégie pourrait plutôt se révéler contre-productive.
Revoir le programme de meetings à la baisse, notamment en remplaçant ceux-ci par des lives et des vidéos de mauvaise qualité, comprend naturellement de nombreux désavantages en matière d’animation des communautés de sympathisants, que les candidats devront nécessairement pallier pour mobiliser leurs troupes d’électeurs potentiels. Cette approche comprend dans le même temps un avantage décisif, puisqu’elle permet de libérer les budgets habituellement mobilisés par les besoins de l’événementiel – ces mêmes budgets qui représentaient en 2017 le premier poste de dépense des principaux candidats à la présidentielle. Une question qui n’est pas anodine dans le contexte d’un plafonnement de cette dernière à environ 23 millions d’euros par candidat.
La destination naturelle de ces budgets ainsi libérés pourrait être le numérique, dont les outils et les plateformes ne sont pas soumis au risque virologique, et dont la promesse est, depuis son origine, de se substituer en partie ou en totalité au monde dit « réel ». Un choix notamment fait par l’équipe Biden, qui a renoncé aux meetings et a cherché à produire des contenus plus qualitatifs que de simples messages vidéo, hachés par les problèmes de connexion.
Si les budgets numériques français sont de manière générale très modestes, pour ne pas dire epsilonesques, en comparaison de ceux des équipes de campagne américaines (lois sur le financement de la vie publique et interdiction des publicités en période de campagne obligent), nul doute que ceux-ci devraient en profiter pour se développer largement : que ce soit en termes d’infrastructures numériques (serveurs, support technique pour pallier les problèmes de connexion), via la mise en place d’équipes dédiées, en production de contenus ou encore à travers l’acquisition ou le développement de logiciels, et notamment de dashboards dédiés au campaigning.
Des réseaux sociaux plus restrictifs
Si les investissements sont amenés à se reporter vers le numérique, ceux-ci devront composer avec un contexte profondément bouleversé depuis la dernière élection. Non pas tant du point de vue des canaux officiels (TikTok ne pouvant pas prétendre au statut de fonctionnalité proprement révolutionnaire pour l’heure, même si ces potentialités sont réelles en termes de compréhension de certaines franges de l’opinion et de spin) qu’au niveau de l’utilisation militante des réseaux sociaux.
L’élection américaine de 2016 et l’élection française de 2017 ont pu être présentées comme l’apothéose du « faux » (faux comptes, faux blogs, fausses informations, fausses tribunes, faux documents accablants), c’est-à-dire du détournement des fonctionnalités des plateformes à des fins d’influence.
Le feuilleton de l’ingérence russe, la dénonciation de la haine en ligne et la généralisation du réflexe techno-déterministe visant à voir l’influence des algorithmes derrière chaque flambée de crispation politique et sociale (à l’instar des « Gilets jaunes » notamment ou de « Black lives matter »), ont entraîné les pouvoirs publics à faire pression sur les réseaux sociaux pour les forcer à quitter leur neutralité revendiquée d’hébergeurs pour être davantage interventionnistes (en France : loi “Fake News” et “loi Avia”, aux Etats-Unis, auditions successives des grands patrons des GAFAM devant le Sénat et le Congrès aux Etats-Unis lors des auditions sur les soupçons d’ingérence russes et, plus récemment, sur la section 230 qui encadre la responsabilité des plateformes).
Sous la menace de sanctions, ou par souci d’éviter de nouveaux dommages en matière de réputation, les acteurs de la tech ont mis en place de nombreux procédés pour « préserver l’intégrité des élection » :
- La suppression de comptes suspects ou « extrémistes » sur Twitter et Facebook (6,6 milliards de faux comptes supprimés en 2019, 8 000 pages « trompeuses » supprimées en octobre 2020 sur cette dernière plateforme selon le réseau de Mark Zuckerbeg) ;
- La vigilance accrue des plateformes à l’égard des groupes de propagande liées à des puissances étrangères, et la labellisation (sur YouTube et Twitter) des comptes liés à des États ;
- Le durcissement des conditions d’inscription sur ces réseaux afin d’éliminer les faux comptes et la plupart des possibilités de s’y inscrire anonymement ;
- Le « shadow banning » de certains utilisateurs et la limitation de la diffusion de certains contenus comme l’article du New York Post sur Hunter Biden ;
- Sur Twitter, une difficulté accrue à retweeter des contenus (mise en place fin-novembre) afin d’enrayer les spirales de viralité, en ajoutant de la friction.
L’interventionnisme des acteurs de la tech a culminé après l’élection avec la censure partielle de certains tweets du président américain et de membres de son entourage accusant le Parti démocrate de fraudes massives. De même Facebook, dont le responsable de la communication Andy Stone avait annoncé le 23 septembre que le réseau social rejetterait les « publicités politiques clamant la victoire avant que les résultats de l’élection n’aient été déclarés », a supprimé un groupe pro-Trump de 300 000 membres intitulé « Stop The Steal ».
Une balkanisation des plateformes
Face à cet interventionnisme croissant, les stratégies des militants de tous bords divergent. Si certains misent sur des changements de registres pour maintenir leur présence sur les réseaux sociaux (ironie, détournements, phrases à double sens capables de flouer la censure algorithmique), d’autres choisissent en revanche d’investir d’autres plateformes – donnant à penser que le mouvement de centralisation du web autour de quelques plateformes hégémoniques puisse se trouver aujourd’hui quelque peu relativisé.
Les militants censurés (ou anticipant la censure prochaine), à l’instar de ceux de l’alt-right, ont déjà été nombreux à investir des plateformes alternatives comme Gab, Parler, Telegram ou encore Discord. Ceux-ci peuvent y trouver une totale liberté de ton, un certain anonymat et une forme d’invisibilité, sans craindre de sanction pénale ou de limitation. Dans le même temps, ces militants doivent aussi se résoudre à ne plus parler qu’à des audiences déjà convaincues, et à renoncer à provoquer des effets de bords sur d’autres cibles – notamment les journalistes et les leaders d’opinion, plus que jamais « gate keepers » entre le monde virtuel et le monde réel.
Ces plateformes se révèlent en revanche très efficaces pour fédérer des militants prêts à s’investir et coordonner des actions en ligne (relais massifs de contenus, raids). De facto, elles s’imposent comme un levier stratégique pour agir sur d’autres espaces plus visibles, pour gonfler la diffusion d’informations ou contre-attaquer, sans recourir à l’astroturfing en ligne devenu désormais plus compliqué, si ce n’est impossible. Certains partis, qui se sont dotés de leurs propres espaces, l’ont du reste bien compris, en cherchant notamment à profiter de l’énergie des utilisateurs en ligne, à la canaliser vers des objectifs stratégiques précis et en abaissant le coût d’accès aux plateformes. En France, la plateforme Agir de la France insoumise propose ainsi des actions aux militants qui y sont inscrits. La campagne américaine de 2020 ne s’est pas non plus privée de ce type de fonctionnalités. L’équipe de campagne de Donald Trump s’est ainsi dotée de son site, « Army for Trump », et de sa propre application dont l’objectif manifeste est de faciliter le passage à l’acte militant. De même, l’équipe de Biden a segmenté ses militants par communautés (« coalitions »), afin de les inciter à mobiliser leurs entourages proches – dans une logique de « marketing électoral » décentralisée et user generated.
L’exemple des stratèges démocrates et républicains qui se sont déjà adaptés aux multiples contraintes du nouvel état de fait sanitaire et numérique, devrait inspirer les futures campagnes françaises. Mais aussi inciter à penser à nouveaux frais la place des réseaux sociaux qui, malgré l’accélération des usages durant la crise sanitaire, paraissent désormais challengés par des médias ré-établis tiers de confiance sur le marché de l’information, et par la concurrence de réseaux sociaux moins restrictifs sur le marché de l’opinion. La politique ne serait-elle, sur ce sujet, qu’un révélateur d’une grande transformation du paysage numérique ?
Alors que les élections américaines apparaissent (enfin) toucher à leur ultime dénouement, la France s’apprête quant à elle à rentrer, à nouveau, dans une séquence électorale aux allures de marathon politique. Des régionales aux législatives en passant par les présidentielles, les départementales et les immanquables primaires de toute sorte : la succession des échéances (sauf report) devrait amener la France à renouveler une part très importante de son personnel politique en un peu plus d’un an.
Les élections américaines, qui atteignent un certain nombre de masses critiques nécessaires à l’innovation en matière de campaigning (en termes financiers, réglementaires ou de capacité d’innovation via la présence d’un écosystème tech spécifique), ont souvent fourni d’intéressants sujets d’études de ce côté-ci de l’Atlantique, infiniment plus modestes en comparaison. La campagne couramment qualifiée de data driven de Barack Obama en 2008 tout comme l’attribution de la victoire de Donald Trump en 2016 à la maîtrise du continuum entre étude d’opinion digitale et le micro ciblage publicitaire (avec le soutien, plus ou moins effectif, de Cambridge Analytica) sont apparues annonciatrices de méthodes radicalement nouvelles de faire campagne, plus ou moins transposables en France.
S’il est encore un peu tôt pour prétendre tirer toutes les leçons des élections américaines, gageons que la campagne de 2020 a été moins caractérisée par l’apport d’innovations de rupture que par l’adaptation à une nouvelle série de contraintes (sanitaires et numériques), qui, parce que celles-ci sont de nature globale, devraient peser de la même manière sur les prochains scrutins en France.
Un risque sanitaire pesant sur le déroulement de la campagne
Si les conjectures les plus rassurantes, confortées par les déclarations des laboratoires et des gouvernements, tablent sur le déploiement de vaccins efficaces dans les tous prochains mois, avec déjà de premières campagnes dans certains pays, comme au Royaume-Uni par exemple, la persistance du risque sanitaire entre le printemps 2021 et l’été 2022 paraît toujours constituer une hypothèse crédible. Sans aller jusqu’à évoquer un confinement pendant la campagne présidentielle, ou d’autres mesures restrictives similaires (qui, sans pouvoir être écartées, n’en sont qu’hypothétiques à ce stade), il y a fort à parier que celles-ci ne devraient pas se traduire par un retour au monde d’avant.
Les images de salles bondées, où les militants en rangs serrés acclament, chantent et applaudissent leur candidat, paraissent pour le moment inimaginables, sur la base des connaissances que nous avons sur le Covid-19, grâce aux travaux statistiques de modélisation du phénomène réalisés ces derniers mois. Si ces images de rallies gigantesques cadraient parfaitement bien avec la défense de la liberté individuelle chère à l’électorat républicain, et notamment ses franges issues du Tea Party converties depuis au trumpisme, contre la politique du « lockdown » défendue par les démocrates et à la stratégie de « business as usual » en matière de gestion de la pandémie du président américain défait, on image mal en France un candidat prendre le risque politique de déclencher un cluster parmi ses propres troupes – au risque de s’exposer aux critiques, à l’heure où les oppositions et le gouvernement rivalisent d’imagination en matière de contraintes sanitaires. D’autant qu’une telle situation entraînerait probablement des contaminations dans les équipes de campagne (comme ce fut le cas pour Donald Trump lui-même, une partie de son staff et pour son avocat Rudy Giuliani, dans la phase post Election Day), ou du moins l’immobilisation de ses déplacements pour cause de quarantaine.
Pour peu que des réunions physiques se maintiennent, ne serait-ce qu’à des fins symboliques ou en marge de déplacements, celles-ci pourraient plutôt s’apparenter aux meetings intimistes de Joe Biden, dont la modestie a tant fait glousser, en comparaison des shows à l’américaine de son concurrent avec musique country et arrivée sur les tarmacs d’aéroports des battlegrounds states avec Air Force One. La victoire du candidat démocrate semble du reste indiquer, en partie, qu’en période de crise sanitaire, les grand-messes militantes ne sont pas nécessairement indispensables pour gagner.
Des budgets réaffectés de l’événementiel vers le numérique
Au-delà de prédire la florescence de meetings Zoom (qui du reste, se sont déjà déroulés durant le confinement), la réelle nouveauté serait plutôt à rechercher du point de vue budgétaire. L’organisation des « réunions publiques » engloutissent habituellement des sommes conséquentes en réservation de salles, logistique, sécurité, son et éclairage. Dans un contexte de crise sanitaire, il paraît peu probable que la réservation du Parc des Expositions ou de l’AccorHotels Arena vidées de leurs foules de supporters hurlants puissent présenter le même intérêt stratégique. Bien au contraire, en termes de « démonstration de force », une telle stratégie pourrait plutôt se révéler contre-productive.
Revoir le programme de meetings à la baisse, notamment en remplaçant ceux-ci par des lives et des vidéos de mauvaise qualité, comprend naturellement de nombreux désavantages en matière d’animation des communautés de sympathisants, que les candidats devront nécessairement pallier pour mobiliser leurs troupes d’électeurs potentiels. Cette approche comprend dans le même temps un avantage décisif, puisqu’elle permet de libérer les budgets habituellement mobilisés par les besoins de l’événementiel – ces mêmes budgets qui représentaient en 2017 le premier poste de dépense des principaux candidats à la présidentielle. Une question qui n’est pas anodine dans le contexte d’un plafonnement de cette dernière à environ 23 millions d’euros par candidat.
La destination naturelle de ces budgets ainsi libérés pourrait être le numérique, dont les outils et les plateformes ne sont pas soumis au risque virologique, et dont la promesse est, depuis son origine, de se substituer en partie ou en totalité au monde dit « réel ». Un choix notamment fait par l’équipe Biden, qui a renoncé aux meetings et a cherché à produire des contenus plus qualitatifs que de simples messages vidéo, hachés par les problèmes de connexion.
Si les budgets numériques français sont de manière générale très modestes, pour ne pas dire epsilonesques, en comparaison de ceux des équipes de campagne américaines (lois sur le financement de la vie publique et interdiction des publicités en période de campagne obligent), nul doute que ceux-ci devraient en profiter pour se développer largement : que ce soit en termes d’infrastructures numériques (serveurs, support technique pour pallier les problèmes de connexion), via la mise en place d’équipes dédiées, en production de contenus ou encore à travers l’acquisition ou le développement de logiciels, et notamment de dashboards dédiés au campaigning.
Des réseaux sociaux plus restrictifs
Si les investissements sont amenés à se reporter vers le numérique, ceux-ci devront composer avec un contexte profondément bouleversé depuis la dernière élection. Non pas tant du point de vue des canaux officiels (TikTok ne pouvant pas prétendre au statut de fonctionnalité proprement révolutionnaire pour l’heure, même si ces potentialités sont réelles en termes de compréhension de certaines franges de l’opinion et de spin) qu’au niveau de l’utilisation militante des réseaux sociaux.
L’élection américaine de 2016 et l’élection française de 2017 ont pu être présentées comme l’apothéose du « faux » (faux comptes, faux blogs, fausses informations, fausses tribunes, faux documents accablants), c’est-à-dire du détournement des fonctionnalités des plateformes à des fins d’influence.
Le feuilleton de l’ingérence russe, la dénonciation de la haine en ligne et la généralisation du réflexe techno-déterministe visant à voir l’influence des algorithmes derrière chaque flambée de crispation politique et sociale (à l’instar des « Gilets jaunes » notamment ou de « Black lives matter »), ont entraîné les pouvoirs publics à faire pression sur les réseaux sociaux pour les forcer à quitter leur neutralité revendiquée d’hébergeurs pour être davantage interventionnistes (en France : loi “Fake News” et “loi Avia”, aux Etats-Unis, auditions successives des grands patrons des GAFAM devant le Sénat et le Congrès aux Etats-Unis lors des auditions sur les soupçons d’ingérence russes et, plus récemment, sur la section 230 qui encadre la responsabilité des plateformes).
Sous la menace de sanctions, ou par souci d’éviter de nouveaux dommages en matière de réputation, les acteurs de la tech ont mis en place de nombreux procédés pour « préserver l’intégrité des élection » :
- La suppression de comptes suspects ou « extrémistes » sur Twitter et Facebook (6,6 milliards de faux comptes supprimés en 2019, 8 000 pages « trompeuses » supprimées en octobre 2020 sur cette dernière plateforme selon le réseau de Mark Zuckerbeg) ;
- La vigilance accrue des plateformes à l’égard des groupes de propagande liées à des puissances étrangères, et la labellisation (sur YouTube et Twitter) des comptes liés à des États ;
- Le durcissement des conditions d’inscription sur ces réseaux afin d’éliminer les faux comptes et la plupart des possibilités de s’y inscrire anonymement ;
- Le « shadow banning » de certains utilisateurs et la limitation de la diffusion de certains contenus comme l’article du New York Post sur Hunter Biden ;
- Sur Twitter, une difficulté accrue à retweeter des contenus (mise en place fin-novembre) afin d’enrayer les spirales de viralité, en ajoutant de la friction.
L’interventionnisme des acteurs de la tech a culminé après l’élection avec la censure partielle de certains tweets du président américain et de membres de son entourage accusant le Parti démocrate de fraudes massives. De même Facebook, dont le responsable de la communication Andy Stone avait annoncé le 23 septembre que le réseau social rejetterait les « publicités politiques clamant la victoire avant que les résultats de l’élection n’aient été déclarés », a supprimé un groupe pro-Trump de 300 000 membres intitulé « Stop The Steal ».
Une balkanisation des plateformes
Face à cet interventionnisme croissant, les stratégies des militants de tous bords divergent. Si certains misent sur des changements de registres pour maintenir leur présence sur les réseaux sociaux (ironie, détournements, phrases à double sens capables de flouer la censure algorithmique), d’autres choisissent en revanche d’investir d’autres plateformes – donnant à penser que le mouvement de centralisation du web autour de quelques plateformes hégémoniques puisse se trouver aujourd’hui quelque peu relativisé.
Les militants censurés (ou anticipant la censure prochaine), à l’instar de ceux de l’alt-right, ont déjà été nombreux à investir des plateformes alternatives comme Gab, Parler, Telegram ou encore Discord. Ceux-ci peuvent y trouver une totale liberté de ton, un certain anonymat et une forme d’invisibilité, sans craindre de sanction pénale ou de limitation. Dans le même temps, ces militants doivent aussi se résoudre à ne plus parler qu’à des audiences déjà convaincues, et à renoncer à provoquer des effets de bords sur d’autres cibles – notamment les journalistes et les leaders d’opinion, plus que jamais « gate keepers » entre le monde virtuel et le monde réel.
Ces plateformes se révèlent en revanche très efficaces pour fédérer des militants prêts à s’investir et coordonner des actions en ligne (relais massifs de contenus, raids). De facto, elles s’imposent comme un levier stratégique pour agir sur d’autres espaces plus visibles, pour gonfler la diffusion d’informations ou contre-attaquer, sans recourir à l’astroturfing en ligne devenu désormais plus compliqué, si ce n’est impossible. Certains partis, qui se sont dotés de leurs propres espaces, l’ont du reste bien compris, en cherchant notamment à profiter de l’énergie des utilisateurs en ligne, à la canaliser vers des objectifs stratégiques précis et en abaissant le coût d’accès aux plateformes. En France, la plateforme Agir de la France insoumise propose ainsi des actions aux militants qui y sont inscrits. La campagne américaine de 2020 ne s’est pas non plus privée de ce type de fonctionnalités. L’équipe de campagne de Donald Trump s’est ainsi dotée de son site, « Army for Trump », et de sa propre application dont l’objectif manifeste est de faciliter le passage à l’acte militant. De même, l’équipe de Biden a segmenté ses militants par communautés (« coalitions »), afin de les inciter à mobiliser leurs entourages proches – dans une logique de « marketing électoral » décentralisée et user generated.
L’exemple des stratèges démocrates et républicains qui se sont déjà adaptés aux multiples contraintes du nouvel état de fait sanitaire et numérique, devrait inspirer les futures campagnes françaises. Mais aussi inciter à penser à nouveaux frais la place des réseaux sociaux qui, malgré l’accélération des usages durant la crise sanitaire, paraissent désormais challengés par des médias ré-établis tiers de confiance sur le marché de l’information, et par la concurrence de réseaux sociaux moins restrictifs sur le marché de l’opinion. La politique ne serait-elle, sur ce sujet, qu’un révélateur d’une grande transformation du paysage numérique ?
Nous avons un quart de siècle de recul à la fois pour mesurer l’efficacité d’une intention et juger de sa cohérence. Ce qui pourrait se formuler ainsi : comment a-t-on « scientifiquement » défini la valeur universelle pour en faire une catégorie juridique ? Plus malicieusement : comment des représentants d’États ont-ils parlé au nom de l’humanité ou des générations futures et oublié leurs intérêts nationaux ou leurs revendications identitaires ? Plus médiologiquement : comment une organisation matérialisée (le Comité qui établit la liste, des ONG, des experts qui le conseillent…) a-t-elle transformé une croyance générale en fait pratique ? Comment est-on passé de l’hyperbole au règlement ? De l’idéal à la subvention ?
En venant briser la réputation et l’autorité d’un candidat, en venant saper les fondements du discours officiel et légitime d’un État, les fake news et autres logiques de désinformation, viennent mettre au jour l’idée d’un espace public souverain potentiellement sous influence d’acteurs exogènes.
Nos sociétés de l'information exaltent volontiers la transparence. En politique, elle doit favoriser la gouvernance : plus d'ententes clandestines, de manoeuvres antidémocratiques obscures, d'intérêts occultes, de crimes enfouis. En économie, on voit en elle une garantie contre les défauts cachés, les erreurs et les tricheries, donc un facteur de sécurité et de progrès. Et, moralement, la transparence semble garantir la confiance entre ceux qui n'ont rien à se reprocher. Dans ces conditions, il est difficile de plaider pour le secret. Ou au moins pour sa persistance, voire sa croissance. Et pourtant...
L’image de citadelle assiégée renvoyée par Madrid au moment de la crise catalane soulève de nombreuses questions, et interroge sur la propension que peuvent avoir certains acteurs politiques à tendre vers des logiques d’exception au nom d’une lutte contre une menace informationnelle et/ou pour défendre un système démocratique en proie à de prétendues attaques exogènes.