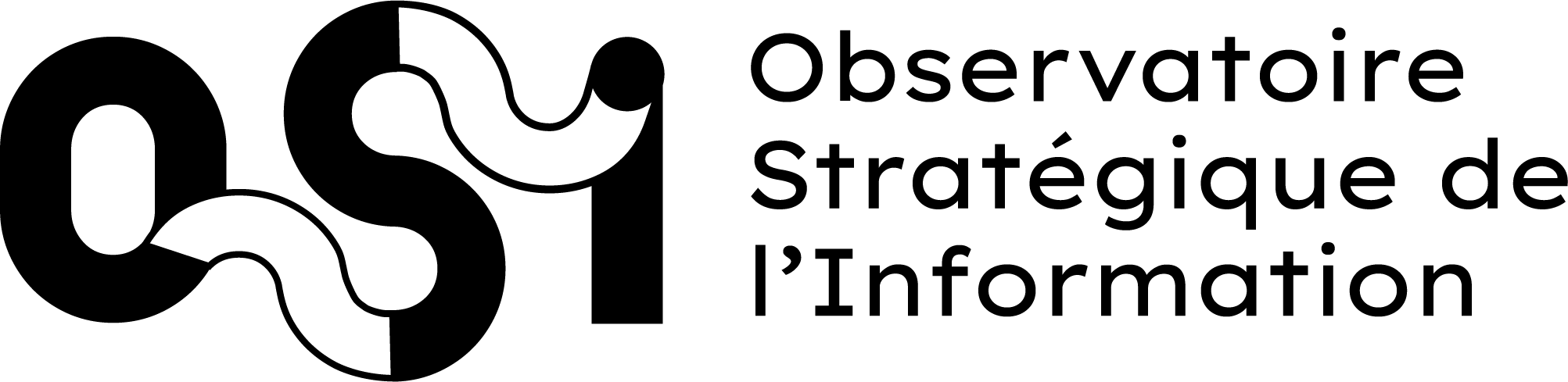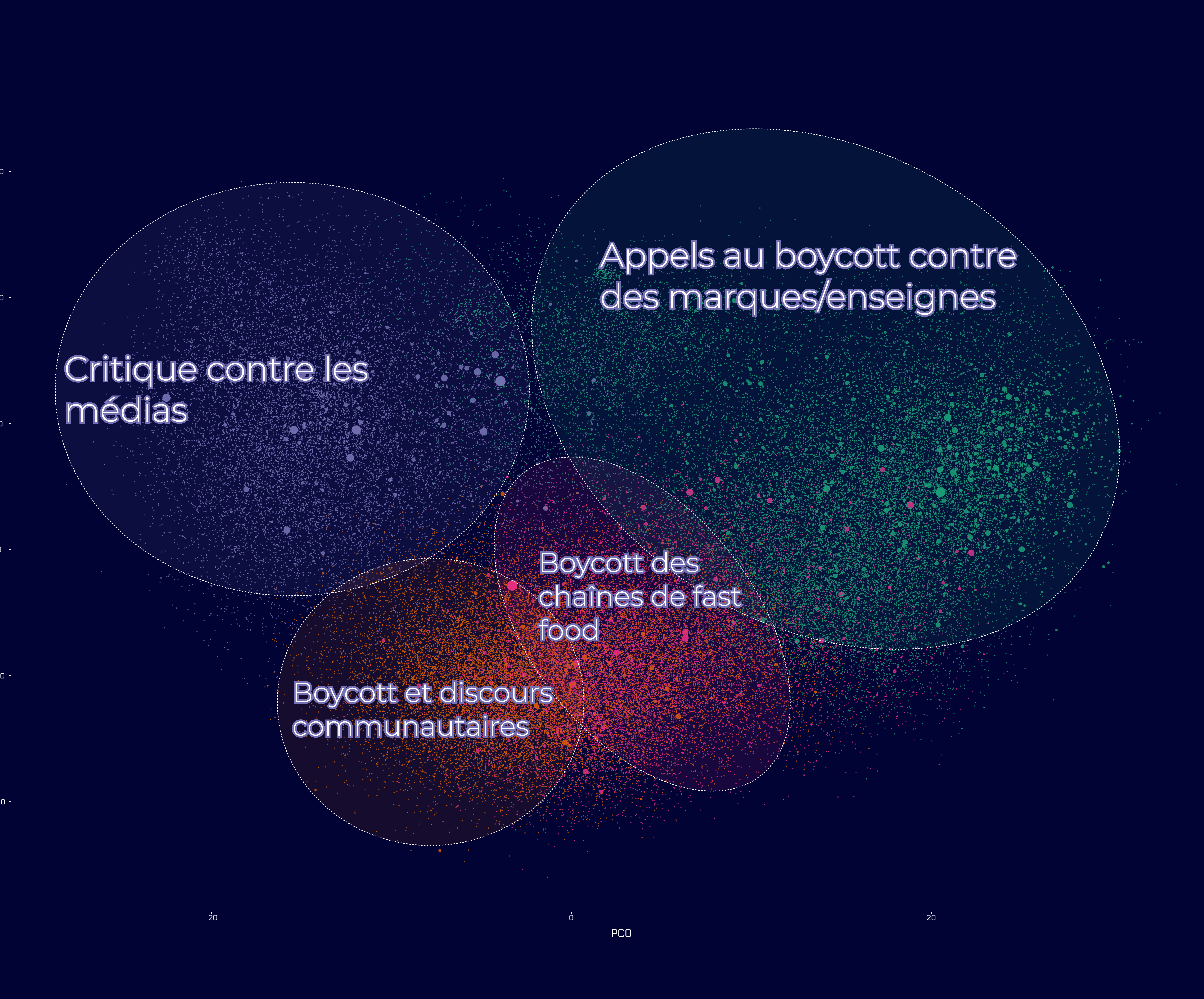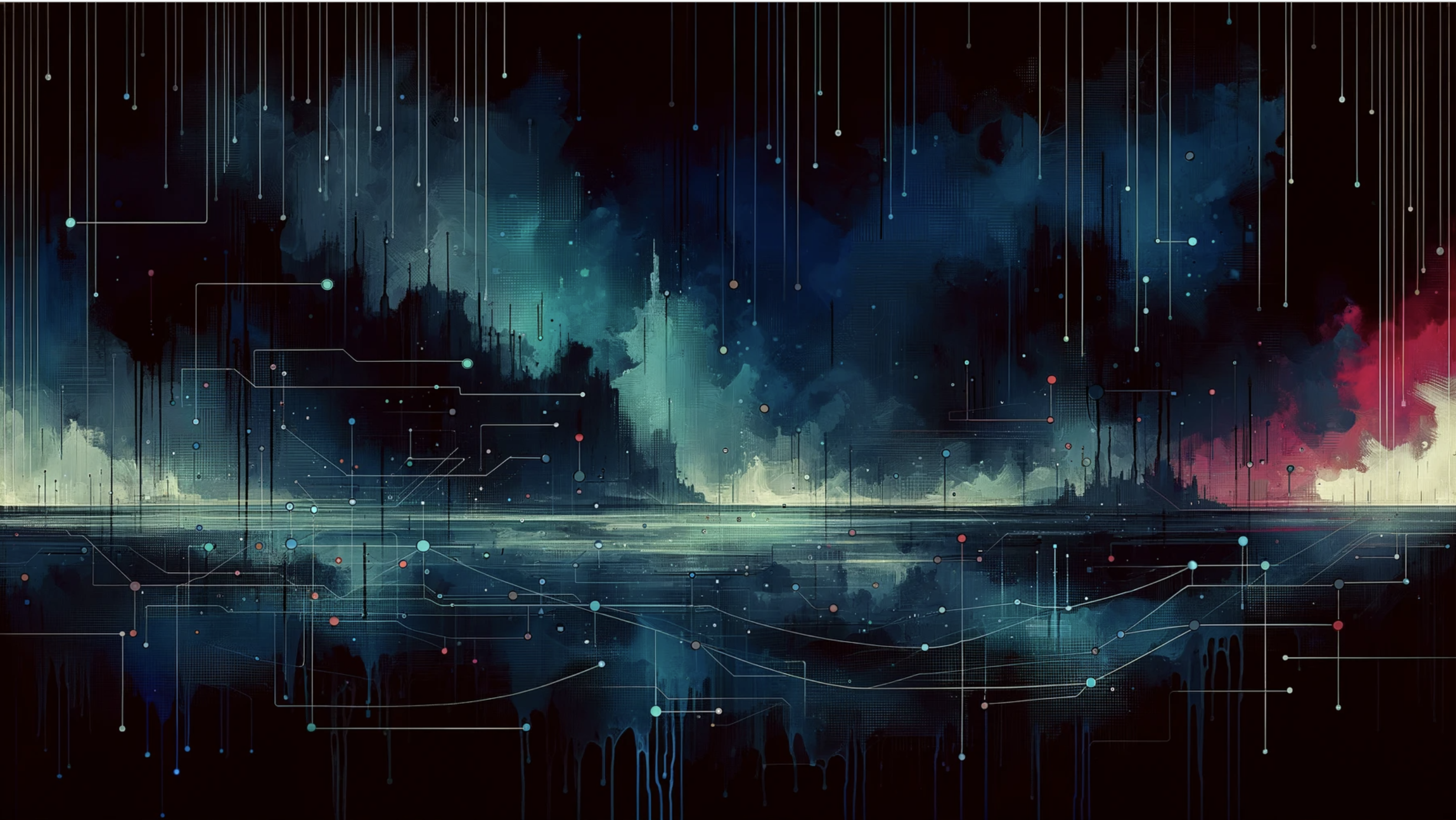Fear of the Dark
Auteur(s)
Date
Partager
Résumé
Facebook et Graphika ont révélé des opérations informationnelles attribuées à l'armée française, notamment en Afrique. Les rapports de Graphika n'apportent cependant aucune preuve directe de l'implication du gouvernement français. Ces révélations soulèvent des questions sur la légitimité et la pertinence de telles actions dans le cyberespace.
Auteur(s)
Date
Partager
Résumé
Facebook et Graphika ont révélé des opérations informationnelles attribuées à l'armée française, notamment en Afrique. Les rapports de Graphika n'apportent cependant aucune preuve directe de l'implication du gouvernement français. Ces révélations soulèvent des questions sur la légitimité et la pertinence de telles actions dans le cyberespace.
Nous avons beaucoup écrit ces dernières semaines au sujet des révélations conjointes de Facebook et de Graphika, une société américaine d’analyse de données, sur les supposées menées informationnelles attribuées à l’armée française dans plusieurs zones géographiques, et notamment en Afrique. Avec du recul, (rappelons que les premières révélations datent de la mi-décembre), il nous semble que nous sommes passés à côté de l’essentiel et de la vraie question : ce type d’opérations est-il adéquat, opportun, pertinent et légitime ?
Commensalisme informationnel
Pour rappel Graphika, une société d’analyse de données américaine spécialisée dans la détection de campagnes d’influence et de désinformation, a publié une étude à la mi-décembre visant à décrire les opérations informationnelles françaises et russes sur différentes zones géographiques, notamment en Afrique et plus spécifiquement au Mali et Centrafrique. Cette étude a été publiée de manière concomitante aux révélations de la direction de la sécurité de Facebook. Les deux entités sont d’ailleurs très proches, comme l’indique, à titre d’exemple, le recrutement récent de Ben Nimmo, ancien chercheur de Graphika, par le réseau de Mark Zuckerberg pour travailler sur la mise en place d’une stratégie globale de renseignement contre les opérations d’influence.
Les études publiées par Graphika au cours des deux dernières années traitent de menées informationnelles russes, chinoises, iraniennes, indiennes et désormais d’actions attribuées à la France. Les États-Unis font figure de grands absents du hit-parade de la guerre informationnelle établi, mois après mois, par Graphika. Une absence qui s’explique, sûrement, par le fait que les services américains, et c’est un fait connu, répugnent à ce type de menées informationnelles que l’éthique et la morale ne manquent pas de réprouver.
Un hypothétique biais d’analyse que les Russes, dans l’édition internationale de RT (Russia Today), n’ont pas manqué, un brin moqueurs, de souligner en mettant en avant le fait que, pour la première fois, Facebook et Graphika impliquent un membre de l’OTAN, la France donc, dans des actions d’influence.
Le tir longue distance des partisans de la guerre informationnelle
La neutralité de l’émetteur n’est, au mieux, qu’une vue de l’esprit que ne sauraient dissimuler ni les artifices de présentation, ni les ébauches de méthodologies présentées par Graphika. Car si l’étude en question contribue à donner corps à l’idée selon laquelle l’armée française aurait entrepris des actions informationnelles “dark” dans le cyberespace, à aucun moment les auteurs de l’étude n’apportent la moindre preuve. Les chercheurs de Graphika soulignent ainsi dans le propos liminaire de leur étude que Facebook n’a aucunement attribué clairement et directement les opérations mises au jour dans le cadre de leur enquête au gouvernement français ou à l’armée française, dans toutes ses composantes. Une prudence que la société américaine d’analyse de données reprend à son compte, en soulignant que leur rapport « n’offre aucune preuve d’une participation du gouvernement français ou des entités militaires françaises ».
Rappelons qu’en matière de guerre informationnelle, dans laquelle les catégories sont souvent floues du fait de l’enchevêtrement d’acteurs (officines, Etats ou encore sociétés privées), des tactiques utilisées (proxy, false flags), et du relatif anonymat offert par le numérique l’attribution d’actions relève toujours d’un acte politique.
Et si l’attribution fait défaut, le jugement, lui, est présent puisque, toujours dans leur propos liminaire, les consultants-chercheurs de la société américaine soulignent que la logique de “fake anti-fake news”, supposément constitutive de l’axe stratégique du narratif déployé par des acteurs liés à l’armée française, ne saurait constituer une réponse adéquate aux enjeux informationnels posés par les rivalités de puissance dans le cyberespace. S’affranchissant des limites de la seule démarche analytique, les chercheurs de Graphika estiment ainsi que les « opérations couvertes comme celles réalisés en Centrafrique constituent un problème pour la santé et la crédibilité du débat démocratique » et, plus loin, de souligner que « le recours accru à des opérations de ce type dans une logique de contre-influence ne constitue pas une solution » aux enjeux posés ».
En somme, “laissez-passer” et “laissez faire”. Mais est-ce bien raisonnable dès lors que la thématique de la guerre informationnelle est sur toutes les lèvres, et que pas un jour ne passe sans que des déclinaisons intellectuelles autour de la thématique de la « weaponization of information” ne voient le jour ?
Quand Graphika invite l’armée française à capituler en rase campagne
Quoi qu’ait fait l’armée française, ou des organes reliés à cette dernière, sur les espaces informationnels listés par Facebook et Graphika l’erreur stratégique majeure eût été de ne rien faire, de laisser le champ libre à l’ennemi. Une fois qu’il a été dit et acté que la nature de la guerre avait évolué, et ces mutations préexistaient, de loin, aux réseaux sociaux, reste à savoir si le nouveau terrain de bataille doit être investi, ou bien si, au contraire, pour ne pas déplaire à Graphika et Facebook, il faut laisser la Russie aujourd’hui, la Chine demain, dénigrer à longueur de journées via leurs organes d’influence respectifs les opérations militaires dans lesquelles la France est engagée.

Quand Sputnik titre en novembre 2019 sur les propos d’un “étudiant diplômé sans emploi” de 24 ans qui déclare “nous demandons le départ des troupes de l’ONU et la France. Si elles ne peuvent pas intervenir contre les terroristes, elles n’ont pas leur place ici”, et d’ajouter plus loin, dans un véritable cri du coeur, “nous demandons aux Russes de venir”, quand Sputnik, toujours, décrit le Mali comme “nouvel Afghanistan pour l’armée française” ou s’interroge en se demandant “pourquoi l’armée française reste au Mali malgré son échec stratégique et les pertes humaines”, faut-il, là encore, ne rien faire ?
Si les guerres informationnelles existent, et cela ne fait guère de doute ; si, au quotidien, des rivalités de puissances ont lieu dans le cyberespace, le déshonneur serait de refuser les engagements et de laisser aux ennemis la primauté en matière d’influence des opinions publiques ciblées.
Back to Dark
“Nous savons maintenant que le moyen essentiel pour vaincre dans la guerre moderne est de s’assurer l’appui inconditionnel des populations ; il est aussi indispensable aux combattants que l’eau au poisson”. Lorsque le colonel Roger Trinquier, théoricien de la guerre subversive ou guerre révolutionnaire, écrit La Guerre Moderne, ouvrage publié en 1961 aux éditions de la Table Ronde, la guerre d’Indochine n’est terminée que depuis seulement six ans et le conflit algérien, marqué par une bataille furieuse entre la France et le FLN pour gagner les “coeurs et les esprits”, fait toujours rage. Bien que quelque peu marquées par son temps, les réflexions du colonel Trinquier font écho aux “guerres informationnelles” qui émaillent notre époque. Dans son maître-ouvrage, Trinquier souligne que “la guerre est maintenant un ensemble d’actions de toutes natures (politiques, sociales, économiques, psychologiques, armées, etc.) qui vise le renversement du pouvoir établi dans un pays et son remplacement par un autre régime”. Pour Trinquier, la guerre subversive contrairement aux guerres du passé n’est plus, comme jadis, le choc entre deux armées. Désormais l’ennemi est difficile à situer, car “aucune frontière matérielle ne sépare les deux camps”, et cependant cette dernière, qui peut-être de nature idéologique ou immatérielle, “doit être impérativement fixée, si nous voulons atteindre sûrement notre adversaire et le vaincre”.
Cette dimension vaporeuse, si ce n’est insaisissable ou supposément imperceptible, des conflits à laquelle, et toujours pour citer le colonel Trinquier vient s’ajouter la “fiction de la paix”, tranche avec les conflits passés où la rupture entre la paix et la guerre était nette et tranchée. Or, quand Sputnik et des pages Facebook s’engagent dans un travail de sape de l’opération Barkhane auprès des populations locales, est-ce du “soft power”, des escarmouches informationnelles ou bien cela ressort-il de la guerre moderne ?
Front(s)
Les guerres asymétriques de la seconde moitié du XXe siècle jusqu’aux conflits actuels ont montré combien la bataille de l’information et de l’opinion ont acquis une dimension stratégique centrale. Ce constat prolonge d’une certaine manière les réflexions de Clausewitz sur l’importance du moral dans la détermination d’une guerre – que les combattants des guérillas et autres groupes terroristes ont fait leur en cherchant à “déplacer le front des opérations du théâtre militaire vers l’opinion publique”, selon une formule de Nicolas Mazzucchi, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), dans un article sur l’arme de l’information dans les conflits, paru dans l’ouvrage collectif Les guerres de l’information à l’ère numérique (PUF, 2021).
Comme il le souligne encore, les Etats occidentaux, à l’image notamment des Etats-Unis, sont parvenus dans les années 1990 à renverser le mouvement de la guerre de l’information via l’utilisation des “info-ops” et de la stracom, parvenant ainsi à “re-symétriser” des conflits de guérilla. Cet ascendant a été rendu possible grâce notamment à un contrôle étroit des canaux de diffusion. Toutefois, ce dernier a été remis en cause par l’irruption des réseaux sociaux décentralisés au cours de la dernière décennie. Une rupture technologique que les Etats autoritaires, par savoir-faire en matière de propagande, par absence de principes moraux inhibants, ou par souci de se défendre contre des menées informationnelles réelles ou supposées, ont tôt su exploiter à leur profit. Faisant leur les armes traditionnelles des faibles contre les forts, dont l’histoire récente a montré combien celles-ci se révélaient efficaces.
Dans un contexte de compétition internationale exacerbée, notamment entre ces Etats et les démocraties libérales occidentales, qui ne se traduit pas par un état de guerre ouverte, mais par une explosion du nombre de zones de tension et de conflits de basse intensité (“guerre improbable, paix impossible” pour reprendre la formule de Raymond Aron), les Etats démocratiques respectueux des libertés civiques cherchent à reprendre la main. La réponse judiciaire et politique (RGPD, loi fake news, loi Avia), qui visent à ré-imposer de la centralité et du contrôle (parfois non sans arrière-pensées) sur ces espaces sociaux, n’apporte pour l’heure que des réponses partielles. Toute tentative de réguler ces espaces sociaux se heurte à un fait essentiel : ceux-ci sont, pour l’essentiel, des entreprises privées américaines, basées en Californie, répondant à leurs propres logiques, soumises dans les faits à la seule souveraineté des Etats-Unis d’Amérique. La passe d’arme entre Washington et Pékin autour du contrôle de Tik Tok sous l’ère Trump n’en aura été qu’une illustration parmi d’autres.
Sans la capacité de “contrôler” les canaux de diffusion, se pose dès lors la question des autres moyens disponibles pour re-symétriser le conflit et reprendre l’initiative. La réponse ne va pas de soi en démocratie, comme le résument Céline Marangé et Maud Quessard dans l’introduction de l’ouvrage qu’elles ont dirigé, Les guerres de l’information à l’ère numérique. “Les gouvernements soucieux de préserver les institutions démocratiques et la sincérité du vote se trouvent confrontés à des dilemmes cornéliens, tout autant qu’à des questions insolubles. Les démocraties peuvent-elles, en temps de paix, utiliser « les armes de l’adversaire » sans renier leurs valeurs et dévoyer leurs principes ?”.
Cette interrogation morale, qui n’est pas sans faire écho au débat casuistique éternel entre éthique finaliste et éthique procédurale, paraît relativement éthéré par rapport à une préoccupation plus prosaïque : « comment ne pas laisser la guerre hybride à nos adversaires » ? “En croisant davantage les champs matériel et immatériel, ce qui requiert un savoir-faire spécifique en matière de renseignement, d’action clandestine et de communication stratégique” comme l’énonce Thomas Gomart, Directeur de l’IFRI dans son dernier essai, Guerre invisibles, nos prochains défis géopolitiques (Tallandier 2021).
La France ne pourra du moins pas faire l’économie de cette réflexion stratégique. “C’est l’ennemi qui vous désigne” faisait observer Julien Freund à Jean Hippolyte à l’occasion de la soutenance de sa thèse en 1965. On pourrait faire observer la même chose du champ de bataille.
Nous avons beaucoup écrit ces dernières semaines au sujet des révélations conjointes de Facebook et de Graphika, une société américaine d’analyse de données, sur les supposées menées informationnelles attribuées à l’armée française dans plusieurs zones géographiques, et notamment en Afrique. Avec du recul, (rappelons que les premières révélations datent de la mi-décembre), il nous semble que nous sommes passés à côté de l’essentiel et de la vraie question : ce type d’opérations est-il adéquat, opportun, pertinent et légitime ?
Commensalisme informationnel
Pour rappel Graphika, une société d’analyse de données américaine spécialisée dans la détection de campagnes d’influence et de désinformation, a publié une étude à la mi-décembre visant à décrire les opérations informationnelles françaises et russes sur différentes zones géographiques, notamment en Afrique et plus spécifiquement au Mali et Centrafrique. Cette étude a été publiée de manière concomitante aux révélations de la direction de la sécurité de Facebook. Les deux entités sont d’ailleurs très proches, comme l’indique, à titre d’exemple, le recrutement récent de Ben Nimmo, ancien chercheur de Graphika, par le réseau de Mark Zuckerberg pour travailler sur la mise en place d’une stratégie globale de renseignement contre les opérations d’influence.
Les études publiées par Graphika au cours des deux dernières années traitent de menées informationnelles russes, chinoises, iraniennes, indiennes et désormais d’actions attribuées à la France. Les États-Unis font figure de grands absents du hit-parade de la guerre informationnelle établi, mois après mois, par Graphika. Une absence qui s’explique, sûrement, par le fait que les services américains, et c’est un fait connu, répugnent à ce type de menées informationnelles que l’éthique et la morale ne manquent pas de réprouver.
Un hypothétique biais d’analyse que les Russes, dans l’édition internationale de RT (Russia Today), n’ont pas manqué, un brin moqueurs, de souligner en mettant en avant le fait que, pour la première fois, Facebook et Graphika impliquent un membre de l’OTAN, la France donc, dans des actions d’influence.
Le tir longue distance des partisans de la guerre informationnelle
La neutralité de l’émetteur n’est, au mieux, qu’une vue de l’esprit que ne sauraient dissimuler ni les artifices de présentation, ni les ébauches de méthodologies présentées par Graphika. Car si l’étude en question contribue à donner corps à l’idée selon laquelle l’armée française aurait entrepris des actions informationnelles “dark” dans le cyberespace, à aucun moment les auteurs de l’étude n’apportent la moindre preuve. Les chercheurs de Graphika soulignent ainsi dans le propos liminaire de leur étude que Facebook n’a aucunement attribué clairement et directement les opérations mises au jour dans le cadre de leur enquête au gouvernement français ou à l’armée française, dans toutes ses composantes. Une prudence que la société américaine d’analyse de données reprend à son compte, en soulignant que leur rapport « n’offre aucune preuve d’une participation du gouvernement français ou des entités militaires françaises ».
Rappelons qu’en matière de guerre informationnelle, dans laquelle les catégories sont souvent floues du fait de l’enchevêtrement d’acteurs (officines, Etats ou encore sociétés privées), des tactiques utilisées (proxy, false flags), et du relatif anonymat offert par le numérique l’attribution d’actions relève toujours d’un acte politique.
Et si l’attribution fait défaut, le jugement, lui, est présent puisque, toujours dans leur propos liminaire, les consultants-chercheurs de la société américaine soulignent que la logique de “fake anti-fake news”, supposément constitutive de l’axe stratégique du narratif déployé par des acteurs liés à l’armée française, ne saurait constituer une réponse adéquate aux enjeux informationnels posés par les rivalités de puissance dans le cyberespace. S’affranchissant des limites de la seule démarche analytique, les chercheurs de Graphika estiment ainsi que les « opérations couvertes comme celles réalisés en Centrafrique constituent un problème pour la santé et la crédibilité du débat démocratique » et, plus loin, de souligner que « le recours accru à des opérations de ce type dans une logique de contre-influence ne constitue pas une solution » aux enjeux posés ».
En somme, “laissez-passer” et “laissez faire”. Mais est-ce bien raisonnable dès lors que la thématique de la guerre informationnelle est sur toutes les lèvres, et que pas un jour ne passe sans que des déclinaisons intellectuelles autour de la thématique de la « weaponization of information” ne voient le jour ?
Quand Graphika invite l’armée française à capituler en rase campagne
Quoi qu’ait fait l’armée française, ou des organes reliés à cette dernière, sur les espaces informationnels listés par Facebook et Graphika l’erreur stratégique majeure eût été de ne rien faire, de laisser le champ libre à l’ennemi. Une fois qu’il a été dit et acté que la nature de la guerre avait évolué, et ces mutations préexistaient, de loin, aux réseaux sociaux, reste à savoir si le nouveau terrain de bataille doit être investi, ou bien si, au contraire, pour ne pas déplaire à Graphika et Facebook, il faut laisser la Russie aujourd’hui, la Chine demain, dénigrer à longueur de journées via leurs organes d’influence respectifs les opérations militaires dans lesquelles la France est engagée.

Quand Sputnik titre en novembre 2019 sur les propos d’un “étudiant diplômé sans emploi” de 24 ans qui déclare “nous demandons le départ des troupes de l’ONU et la France. Si elles ne peuvent pas intervenir contre les terroristes, elles n’ont pas leur place ici”, et d’ajouter plus loin, dans un véritable cri du coeur, “nous demandons aux Russes de venir”, quand Sputnik, toujours, décrit le Mali comme “nouvel Afghanistan pour l’armée française” ou s’interroge en se demandant “pourquoi l’armée française reste au Mali malgré son échec stratégique et les pertes humaines”, faut-il, là encore, ne rien faire ?
Si les guerres informationnelles existent, et cela ne fait guère de doute ; si, au quotidien, des rivalités de puissances ont lieu dans le cyberespace, le déshonneur serait de refuser les engagements et de laisser aux ennemis la primauté en matière d’influence des opinions publiques ciblées.
Back to Dark
“Nous savons maintenant que le moyen essentiel pour vaincre dans la guerre moderne est de s’assurer l’appui inconditionnel des populations ; il est aussi indispensable aux combattants que l’eau au poisson”. Lorsque le colonel Roger Trinquier, théoricien de la guerre subversive ou guerre révolutionnaire, écrit La Guerre Moderne, ouvrage publié en 1961 aux éditions de la Table Ronde, la guerre d’Indochine n’est terminée que depuis seulement six ans et le conflit algérien, marqué par une bataille furieuse entre la France et le FLN pour gagner les “coeurs et les esprits”, fait toujours rage. Bien que quelque peu marquées par son temps, les réflexions du colonel Trinquier font écho aux “guerres informationnelles” qui émaillent notre époque. Dans son maître-ouvrage, Trinquier souligne que “la guerre est maintenant un ensemble d’actions de toutes natures (politiques, sociales, économiques, psychologiques, armées, etc.) qui vise le renversement du pouvoir établi dans un pays et son remplacement par un autre régime”. Pour Trinquier, la guerre subversive contrairement aux guerres du passé n’est plus, comme jadis, le choc entre deux armées. Désormais l’ennemi est difficile à situer, car “aucune frontière matérielle ne sépare les deux camps”, et cependant cette dernière, qui peut-être de nature idéologique ou immatérielle, “doit être impérativement fixée, si nous voulons atteindre sûrement notre adversaire et le vaincre”.
Cette dimension vaporeuse, si ce n’est insaisissable ou supposément imperceptible, des conflits à laquelle, et toujours pour citer le colonel Trinquier vient s’ajouter la “fiction de la paix”, tranche avec les conflits passés où la rupture entre la paix et la guerre était nette et tranchée. Or, quand Sputnik et des pages Facebook s’engagent dans un travail de sape de l’opération Barkhane auprès des populations locales, est-ce du “soft power”, des escarmouches informationnelles ou bien cela ressort-il de la guerre moderne ?
Front(s)
Les guerres asymétriques de la seconde moitié du XXe siècle jusqu’aux conflits actuels ont montré combien la bataille de l’information et de l’opinion ont acquis une dimension stratégique centrale. Ce constat prolonge d’une certaine manière les réflexions de Clausewitz sur l’importance du moral dans la détermination d’une guerre – que les combattants des guérillas et autres groupes terroristes ont fait leur en cherchant à “déplacer le front des opérations du théâtre militaire vers l’opinion publique”, selon une formule de Nicolas Mazzucchi, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), dans un article sur l’arme de l’information dans les conflits, paru dans l’ouvrage collectif Les guerres de l’information à l’ère numérique (PUF, 2021).
Comme il le souligne encore, les Etats occidentaux, à l’image notamment des Etats-Unis, sont parvenus dans les années 1990 à renverser le mouvement de la guerre de l’information via l’utilisation des “info-ops” et de la stracom, parvenant ainsi à “re-symétriser” des conflits de guérilla. Cet ascendant a été rendu possible grâce notamment à un contrôle étroit des canaux de diffusion. Toutefois, ce dernier a été remis en cause par l’irruption des réseaux sociaux décentralisés au cours de la dernière décennie. Une rupture technologique que les Etats autoritaires, par savoir-faire en matière de propagande, par absence de principes moraux inhibants, ou par souci de se défendre contre des menées informationnelles réelles ou supposées, ont tôt su exploiter à leur profit. Faisant leur les armes traditionnelles des faibles contre les forts, dont l’histoire récente a montré combien celles-ci se révélaient efficaces.
Dans un contexte de compétition internationale exacerbée, notamment entre ces Etats et les démocraties libérales occidentales, qui ne se traduit pas par un état de guerre ouverte, mais par une explosion du nombre de zones de tension et de conflits de basse intensité (“guerre improbable, paix impossible” pour reprendre la formule de Raymond Aron), les Etats démocratiques respectueux des libertés civiques cherchent à reprendre la main. La réponse judiciaire et politique (RGPD, loi fake news, loi Avia), qui visent à ré-imposer de la centralité et du contrôle (parfois non sans arrière-pensées) sur ces espaces sociaux, n’apporte pour l’heure que des réponses partielles. Toute tentative de réguler ces espaces sociaux se heurte à un fait essentiel : ceux-ci sont, pour l’essentiel, des entreprises privées américaines, basées en Californie, répondant à leurs propres logiques, soumises dans les faits à la seule souveraineté des Etats-Unis d’Amérique. La passe d’arme entre Washington et Pékin autour du contrôle de Tik Tok sous l’ère Trump n’en aura été qu’une illustration parmi d’autres.
Sans la capacité de “contrôler” les canaux de diffusion, se pose dès lors la question des autres moyens disponibles pour re-symétriser le conflit et reprendre l’initiative. La réponse ne va pas de soi en démocratie, comme le résument Céline Marangé et Maud Quessard dans l’introduction de l’ouvrage qu’elles ont dirigé, Les guerres de l’information à l’ère numérique. “Les gouvernements soucieux de préserver les institutions démocratiques et la sincérité du vote se trouvent confrontés à des dilemmes cornéliens, tout autant qu’à des questions insolubles. Les démocraties peuvent-elles, en temps de paix, utiliser « les armes de l’adversaire » sans renier leurs valeurs et dévoyer leurs principes ?”.
Cette interrogation morale, qui n’est pas sans faire écho au débat casuistique éternel entre éthique finaliste et éthique procédurale, paraît relativement éthéré par rapport à une préoccupation plus prosaïque : « comment ne pas laisser la guerre hybride à nos adversaires » ? “En croisant davantage les champs matériel et immatériel, ce qui requiert un savoir-faire spécifique en matière de renseignement, d’action clandestine et de communication stratégique” comme l’énonce Thomas Gomart, Directeur de l’IFRI dans son dernier essai, Guerre invisibles, nos prochains défis géopolitiques (Tallandier 2021).
La France ne pourra du moins pas faire l’économie de cette réflexion stratégique. “C’est l’ennemi qui vous désigne” faisait observer Julien Freund à Jean Hippolyte à l’occasion de la soutenance de sa thèse en 1965. On pourrait faire observer la même chose du champ de bataille.
Nous avons un quart de siècle de recul à la fois pour mesurer l’efficacité d’une intention et juger de sa cohérence. Ce qui pourrait se formuler ainsi : comment a-t-on « scientifiquement » défini la valeur universelle pour en faire une catégorie juridique ? Plus malicieusement : comment des représentants d’États ont-ils parlé au nom de l’humanité ou des générations futures et oublié leurs intérêts nationaux ou leurs revendications identitaires ? Plus médiologiquement : comment une organisation matérialisée (le Comité qui établit la liste, des ONG, des experts qui le conseillent…) a-t-elle transformé une croyance générale en fait pratique ? Comment est-on passé de l’hyperbole au règlement ? De l’idéal à la subvention ?
En venant briser la réputation et l’autorité d’un candidat, en venant saper les fondements du discours officiel et légitime d’un État, les fake news et autres logiques de désinformation, viennent mettre au jour l’idée d’un espace public souverain potentiellement sous influence d’acteurs exogènes.
Nos sociétés de l'information exaltent volontiers la transparence. En politique, elle doit favoriser la gouvernance : plus d'ententes clandestines, de manoeuvres antidémocratiques obscures, d'intérêts occultes, de crimes enfouis. En économie, on voit en elle une garantie contre les défauts cachés, les erreurs et les tricheries, donc un facteur de sécurité et de progrès. Et, moralement, la transparence semble garantir la confiance entre ceux qui n'ont rien à se reprocher. Dans ces conditions, il est difficile de plaider pour le secret. Ou au moins pour sa persistance, voire sa croissance. Et pourtant...
L’image de citadelle assiégée renvoyée par Madrid au moment de la crise catalane soulève de nombreuses questions, et interroge sur la propension que peuvent avoir certains acteurs politiques à tendre vers des logiques d’exception au nom d’une lutte contre une menace informationnelle et/ou pour défendre un système démocratique en proie à de prétendues attaques exogènes.