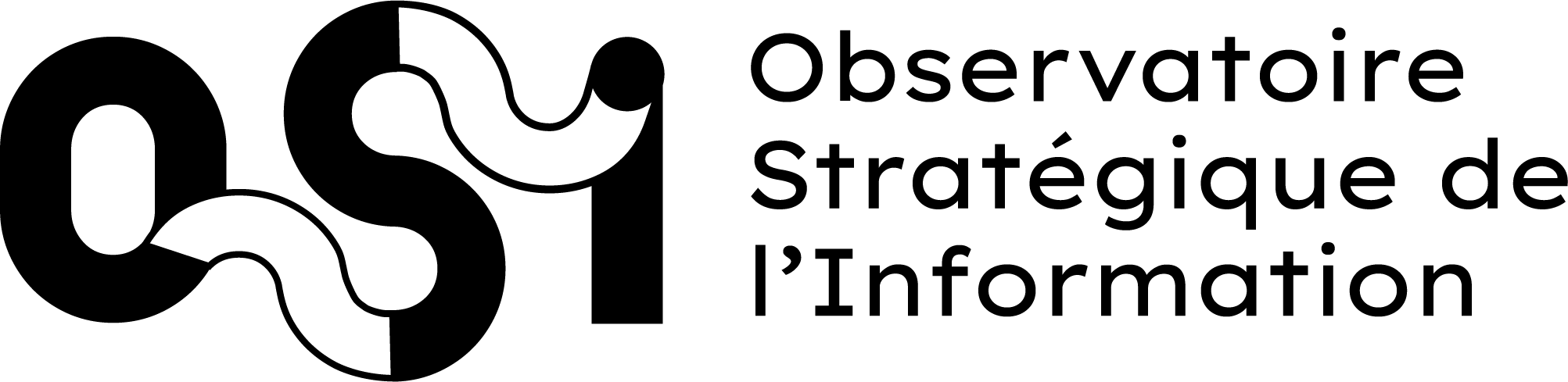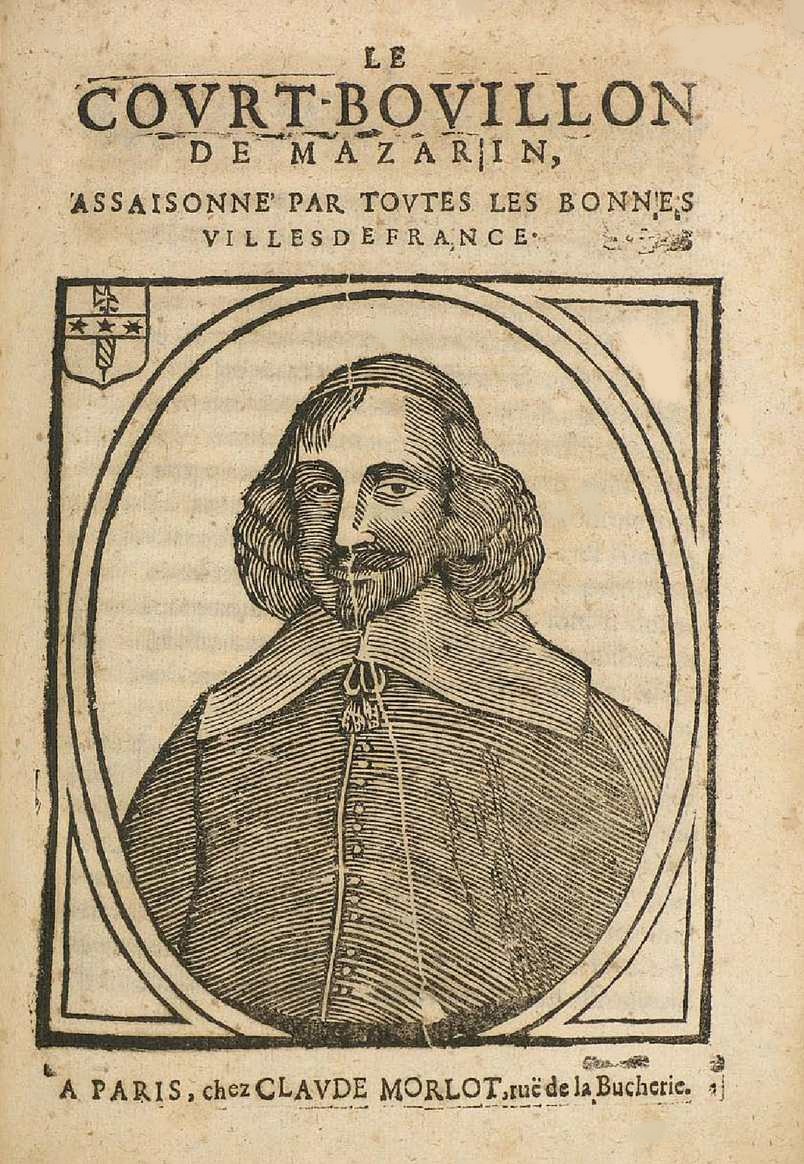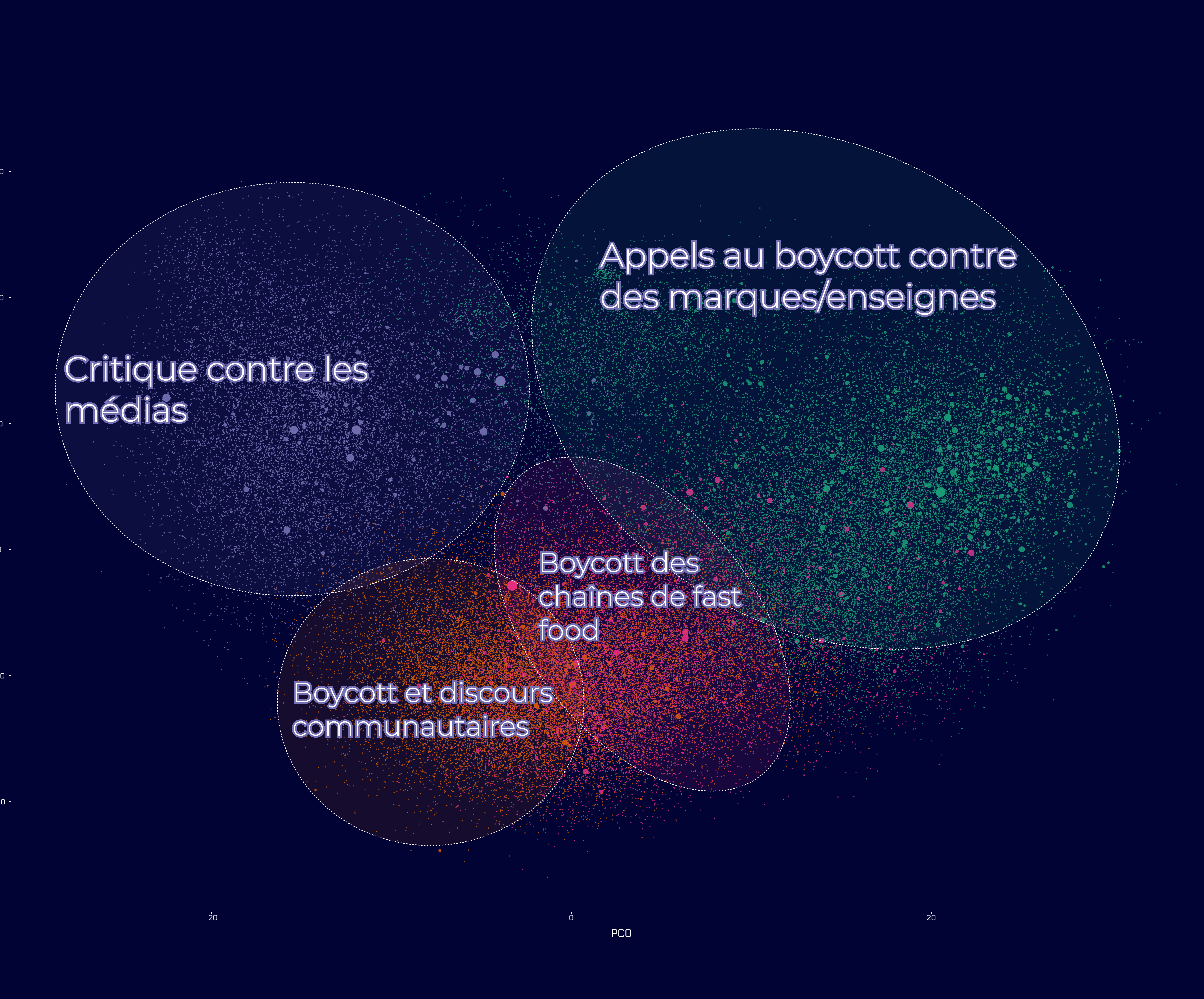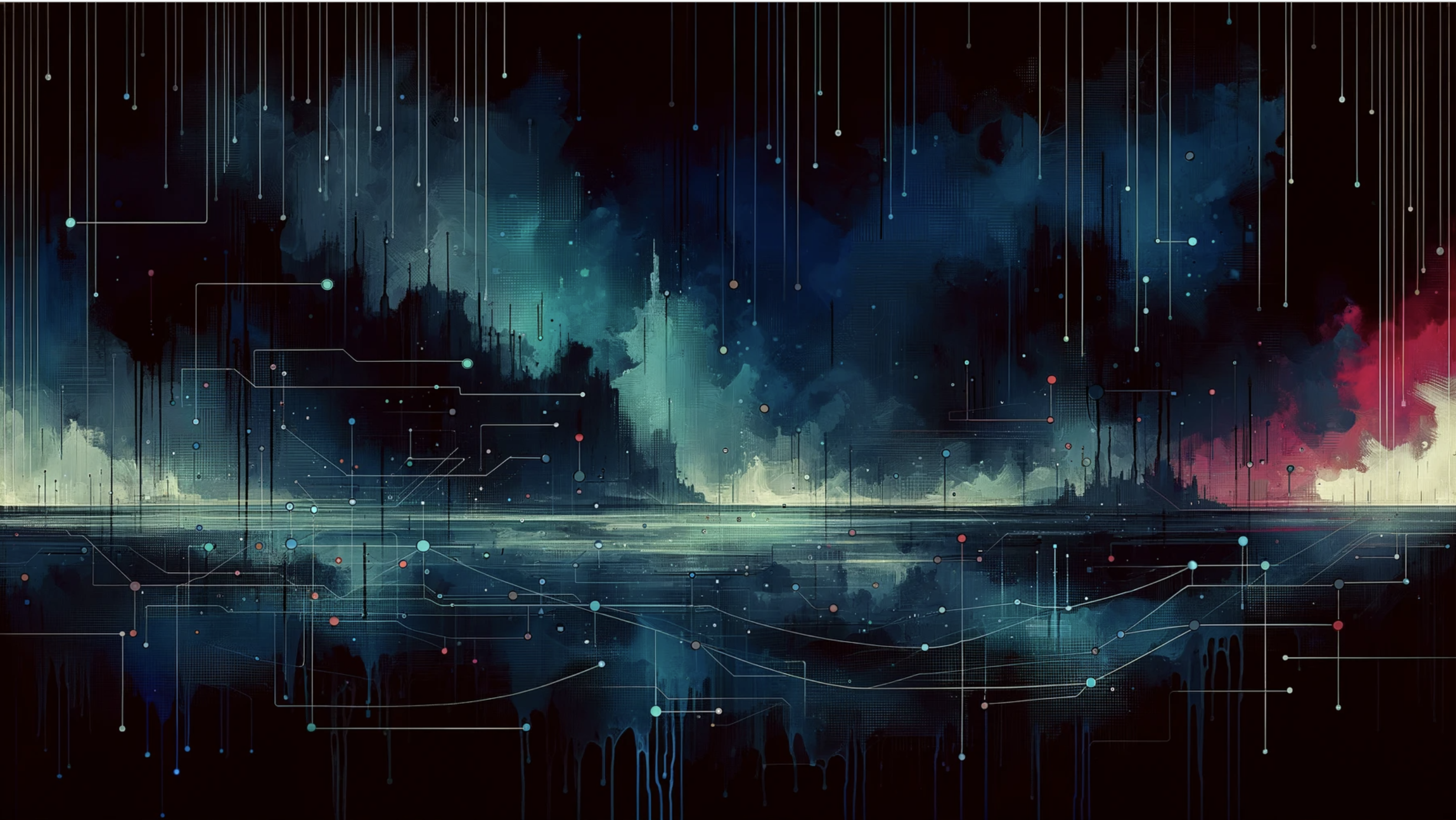Des mazarinades aux réseaux sociaux, ou l’intangibilité des ressorts de l’opinion publique
Auteur(s)
Date
Partager
Résumé
Recours à des modérateurs, exigence de responsabilité, volonté accrue de régulation, espace public numérique confronté à un supposé déferlement de rumeurs, de fake news, de désinformation et autres discours de haine : ces différentes problématiques mises à l’agenda par les pouvoirs publics ont entraîné l’avènement de nouvelles politiques publiques destinées à réguler le web.
Auteur(s)
Date
Partager
Résumé
Recours à des modérateurs, exigence de responsabilité, volonté accrue de régulation, espace public numérique confronté à un supposé déferlement de rumeurs, de fake news, de désinformation et autres discours de haine : ces différentes problématiques mises à l’agenda par les pouvoirs publics ont entraîné l’avènement de nouvelles politiques publiques destinées à réguler le web.
L’attention du politique s’alarme sans cesse à chaque actualité. Dernière en date, la peur, toute récente, d’une importation en France des “théories” QAnon succède aux craintes plus anciennes désormais d’ingérences informationnelles étrangères. Avec les inquiétudes que nourrissent les différents phénomènes qualifiés de “nouvelles radicalités”, l’espace socio-numérique s’assimile, de plus en plus, à une zone de tous les dangers. Bien que le phénomène fasse aujourd’hui la une, celui-ci n’a cependant, rien de bien nouveau dans l’histoire de l’espace public, et de son corollaire, l’opinion publique. Remis dans une perspective historique, sa mise sur le devant la scène questionne moins sur les mutations dudit espace que sur les méta-discours qui le caractérisent, notamment de la part des acteurs politiques.
L’année dernière, les éditions du CNRS ont fait paraître un ouvrage fort intéressant signé par un certain “Roy Pinker”, pseudonyme derrière lequel se cache une équipe de chercheurs spécialisés dans l’étude des archives médiatiques, s’appuyant dans ses recherches sur des outils d’analyse adaptés au big data. Dans Fake news & viralité avant internet les chercheurs établissent des sortes de parallèles, loin d’être anachroniques entre notre modernité informationnelle et la vie des idées, médiatisée pour l’essentiel, des siècles précédents (essentiellement les XVIIIe et XIXe siècles)[1]. Alors que la nouvelle configuration de l’espace public induite par les réseaux sociaux ne manque pas, à chaque haut-fait recouvrant une dimension éminemment médiatique, d’être mise sur le devant de la scène, sous le sceau de l’inédit et du jamais vu jusque-là, ce sont, pourtant, moins les ruptures que les continuités qui s’avèrent saisissantes.
Retour aux sources
À travers l’étude de la circulation de la micronouvelle, et fausse nouvelle au demeurant, des lapins du cimetière du Père-Lachaise qui pulluleraient au contact des morts, les auteurs de cet ouvrage soulignent que l’étude des “phénomènes viraux qui caractérisent l’information médiatique dès le XIXe siècle […] permet de montrer que l’analyse de la circulation accélérée de nouvelles vraies et fausses comme s’il s’agissait d’un phénomène caractéristique de notre société contemporaine, globale et connectée, est erronée, voire, au regard de l’histoire, délirante”.
En remontant le temps, et en revenant un siècle en arrière, l’étude du marché de l’opinion en voie de constitution, sous les effets conjoints d’une forme de libéralisation accrue de la société, que cette dernière soit voulue ou non, de l’émergence d’un espace public entretenant une relation dialectique avec la cour et d’une “démocratisation” des vecteurs d’information, nous permet de revenir à l’âge d’or de la société de l’information. Époque matricielle et véritable creuset du cadre informationnel dans lequel, malgré les évolutions techniques indéniables (des nouvelles à main, en passant par la presse jusqu’aux réseaux sociaux) et les postures ambivalentes et non linéaires des autorités (entre tolérance, plus ou moins tacite, volonté de contrôle et répression, se succédant sans qu’un sens de l’histoire ne s’en dégage avec certitude), nous évoluons encore de nos jours, a minima sous nos latitudes. Une époque que nous qualifions d’âge d’or, avec malice, puisque, après tout, si dans une ère de post-truth nous serions entrés, encore faut-il bien, qu’en un temps, un lieu et un espace, ait existé ce monde de concorde informationnelle parfait duquel rien de problématique n’aurait su affleurer. Après tout, évoquer quotidiennement la montée du faux, l’accélération de la diffusion des discours de haine, l’exposition sans cesse répétée à des logiques de désinformation, et sans même parler de la prolifération des discours licencieux, cela ne revient-il pas, en creux, à esquisser l’hypothèse d’un âge d’or vers lequel nous devrions revenir. Cet âge formidable où, par-delà son inéluctable devenir grégaire, la société des hommes parvenait à échapper à tous les “maux” inhérents aux “mots”. Époque naturellement fantasmée, et qui pourtant, en un sens, semble aiguillonner le législateur.
L’âge d’or (utopique) de l’espace public
Car en matière d’âge d’or, nous avons surtout affaire à du bruit, de la fureur, de la rumeur et du faux, et ce de manière indistincte. Dans Dire et mal dire : l’opinion publique au XVIIIe siècle, l’historienne Arlette Farge, parmi les principales spécialistes de l’histoire sociale de ce siècle, souligne que dans le Paris de ce temps “l’important est le bruit, la rumeur, la déambulation agitée de la nouvelle, transformée puis contredite”, et d’ajouter que même “l’homme le plus sensé perd la tête avec plaisir”, puisque “jamais il ne sait si ce qui circule est mensonge ou erreur, fait avéré ou produit de l’extravagance”[2]. On souhaiterait décrire Twitter de nos jours, qu’on pourrait aisément transposer de tels propos, sans risquer de créer un artefact travesti et erroné.
S’intéressant au mode de circulation des idées et des récits, et notamment ceux qui proviennent du monde populaire, par antagonisme avec la cour, l’historienne revient sur la circulation des nouvelles à la main, du nom de ces gazetins qui circulaient avant que les journaux en bonne et due forme ne viennent les remplacer. Les qualifiant de “maquis qui échappe aussi bien aux contemporains qu’aux historiens”, elle insiste notamment sur leurs dimensions “anonymes, lacunaires, éphémères” et souligne que “répandues à vive allure, écrites à la hâte, transmises entre ombre et lumière, elles inondent les grands et petits et sont par essence invérifiables”. Autant d’éléments qui mis bout à bout en viennent à constituer non pas tant l’esprit du siècle que l’atmosphère de l’époque, qui se caractérise par l’idée que “la légitimité de penser sur l’emporte sur son interdiction”, tandis que la transgression “génère, dans les circonstances culturelles et politiques du temps, une audace et une assurance qui sont un des faits politiques majeurs du siècle”.
Rumeurs, mensonges et violences créatrices (de l’opinion publique)
Autant d’éléments déjà en germe au siècle précédent, du temps de la Fronde et des mazarinades, du nom de cette littérature destinée à décrédibiliser le cardinal Mazarin. Dans un article publié en 2010, et intitulé quand l’imprimé devient une arme dans le combat politique : la France du XVIe au XXe siècle, l’historien Jean-Yves Mollier, spécialiste de l’histoire de l’édition, estime que les vers, pamphlets et autres libelles publiés à cette époque participent à la structuration d’une opinion publique en France[3]. Se référant aux travaux de l’historien dix-septièmiste Christian Jouhaud[4], ayant étudié pas moins de 5 000 mazarinades conservées dans les bibliothèques, Jean-Yves Mollier souligne qu’ “à partir du moment où la contestation de la personne du cardinal Mazarin dépasse le cercle des courtisans ou des familiers de la politique pour devenir une question nationale, la capacité de l’écrit, du texte imprimé, de la caricature, du placard, de la gravure à mobiliser les consciences se vérifie. Alors même que la majorité de la population demeure analphabète, une opinion publique semble voir le jour, prête à propager les nouvelles de Paris aux frontières, de la ville à la campagne et à transcender ainsi les conditions et les différences de statut”.
Pour l’historien, les mazarinades, dont plus de 1 000 exemplaires ont été comptabilisés pour les années 1649 et 1652, “contribuèrent à faire descendre la politique dans la rue”. Dans un article intitulé Déjà-vu et publié en 2017 dans la revue Médium, l’historienne, sociologue et médiologue Catherine Bertho-Lavenir souligne que les mazarinades, qui “saturent l’espace public en France à un moment où le pouvoir royal est en grand danger […] nourrissent des polémiques de toutes sortes, assaisonnées d’insultes et de propos diffamatoires”. Établissant un parallèle avec nos vecteurs de communication contemporains, elle souligne que les mazarinades “partagent bien des traits avec les polémiques entretenues par les médias sociaux contemporains et avec les informations mensongères qui ont émaillé les récentes élections américaines et françaises”[5]. Il est ainsi fort cocasse de constater que cette phase supposément embryonnaire de l’espace public, marquée en France, par la prolifération des mazarinades est celle qui, comme le souligne Catherine Bertho-Lavenir, à la suite de Michel de Certeau, se caractérise par la viralité, certes relative par rapport à notre époque mais considérable pour le XVIIe siècle, de contenus imprimés qui “ne développent pas une pensée dans un espace intellectuel mais visent à faire tomber, discréditer, disparaître leur cible”. Par ailleurs, ces textes qui sont, la plupart du temps de commande, dans une optique de brouiller les pistes, du moins autant que faire se peut, nous renseignent également sur la dimension proto-industrielle de la fabrication du faux. À croire qu’au berceau de l’opinion publique le faux et le vrai n’ont pas été apportés de manière harmonieuse et équilibrée, mais que le premier s’est chargé de baptiser cette opinion publique naissante du feu du faux, de la violence, de la haine et de la fureur.
[1] Pinker, Roy. Fake news & viralité avant Internet: les lapins du Père-Lachaise et autres légendes médiatiques. CNRS éditions, 2020.
[2] Farge, Arlette. Dire et mal dire: l’opinion publique au XVIIIe siècle. Seuil, 1992.
[3] Presse, nations et mondialisation au xixe siècle, sous la direction de Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant, Paris, Nouveau Monde éditions, 2010, 512 pp.
[4] Christian Jouhaud, Mazarinades : la Fronde des mots, Paris, Aubier, 1985
[5] Lavenir, C. (2017). Déjà-vu. Médium, 52-53(3-4), 85-100. https://doi-org.accesdistant.sorbonne-universite.fr/10.3917/mediu.052.0085
L’attention du politique s’alarme sans cesse à chaque actualité. Dernière en date, la peur, toute récente, d’une importation en France des “théories” QAnon succède aux craintes plus anciennes désormais d’ingérences informationnelles étrangères. Avec les inquiétudes que nourrissent les différents phénomènes qualifiés de “nouvelles radicalités”, l’espace socio-numérique s’assimile, de plus en plus, à une zone de tous les dangers. Bien que le phénomène fasse aujourd’hui la une, celui-ci n’a cependant, rien de bien nouveau dans l’histoire de l’espace public, et de son corollaire, l’opinion publique. Remis dans une perspective historique, sa mise sur le devant la scène questionne moins sur les mutations dudit espace que sur les méta-discours qui le caractérisent, notamment de la part des acteurs politiques.
L’année dernière, les éditions du CNRS ont fait paraître un ouvrage fort intéressant signé par un certain “Roy Pinker”, pseudonyme derrière lequel se cache une équipe de chercheurs spécialisés dans l’étude des archives médiatiques, s’appuyant dans ses recherches sur des outils d’analyse adaptés au big data. Dans Fake news & viralité avant internet les chercheurs établissent des sortes de parallèles, loin d’être anachroniques entre notre modernité informationnelle et la vie des idées, médiatisée pour l’essentiel, des siècles précédents (essentiellement les XVIIIe et XIXe siècles)[1]. Alors que la nouvelle configuration de l’espace public induite par les réseaux sociaux ne manque pas, à chaque haut-fait recouvrant une dimension éminemment médiatique, d’être mise sur le devant de la scène, sous le sceau de l’inédit et du jamais vu jusque-là, ce sont, pourtant, moins les ruptures que les continuités qui s’avèrent saisissantes.
Retour aux sources
À travers l’étude de la circulation de la micronouvelle, et fausse nouvelle au demeurant, des lapins du cimetière du Père-Lachaise qui pulluleraient au contact des morts, les auteurs de cet ouvrage soulignent que l’étude des “phénomènes viraux qui caractérisent l’information médiatique dès le XIXe siècle […] permet de montrer que l’analyse de la circulation accélérée de nouvelles vraies et fausses comme s’il s’agissait d’un phénomène caractéristique de notre société contemporaine, globale et connectée, est erronée, voire, au regard de l’histoire, délirante”.
En remontant le temps, et en revenant un siècle en arrière, l’étude du marché de l’opinion en voie de constitution, sous les effets conjoints d’une forme de libéralisation accrue de la société, que cette dernière soit voulue ou non, de l’émergence d’un espace public entretenant une relation dialectique avec la cour et d’une “démocratisation” des vecteurs d’information, nous permet de revenir à l’âge d’or de la société de l’information. Époque matricielle et véritable creuset du cadre informationnel dans lequel, malgré les évolutions techniques indéniables (des nouvelles à main, en passant par la presse jusqu’aux réseaux sociaux) et les postures ambivalentes et non linéaires des autorités (entre tolérance, plus ou moins tacite, volonté de contrôle et répression, se succédant sans qu’un sens de l’histoire ne s’en dégage avec certitude), nous évoluons encore de nos jours, a minima sous nos latitudes. Une époque que nous qualifions d’âge d’or, avec malice, puisque, après tout, si dans une ère de post-truth nous serions entrés, encore faut-il bien, qu’en un temps, un lieu et un espace, ait existé ce monde de concorde informationnelle parfait duquel rien de problématique n’aurait su affleurer. Après tout, évoquer quotidiennement la montée du faux, l’accélération de la diffusion des discours de haine, l’exposition sans cesse répétée à des logiques de désinformation, et sans même parler de la prolifération des discours licencieux, cela ne revient-il pas, en creux, à esquisser l’hypothèse d’un âge d’or vers lequel nous devrions revenir. Cet âge formidable où, par-delà son inéluctable devenir grégaire, la société des hommes parvenait à échapper à tous les “maux” inhérents aux “mots”. Époque naturellement fantasmée, et qui pourtant, en un sens, semble aiguillonner le législateur.
L’âge d’or (utopique) de l’espace public
Car en matière d’âge d’or, nous avons surtout affaire à du bruit, de la fureur, de la rumeur et du faux, et ce de manière indistincte. Dans Dire et mal dire : l’opinion publique au XVIIIe siècle, l’historienne Arlette Farge, parmi les principales spécialistes de l’histoire sociale de ce siècle, souligne que dans le Paris de ce temps “l’important est le bruit, la rumeur, la déambulation agitée de la nouvelle, transformée puis contredite”, et d’ajouter que même “l’homme le plus sensé perd la tête avec plaisir”, puisque “jamais il ne sait si ce qui circule est mensonge ou erreur, fait avéré ou produit de l’extravagance”[2]. On souhaiterait décrire Twitter de nos jours, qu’on pourrait aisément transposer de tels propos, sans risquer de créer un artefact travesti et erroné.
S’intéressant au mode de circulation des idées et des récits, et notamment ceux qui proviennent du monde populaire, par antagonisme avec la cour, l’historienne revient sur la circulation des nouvelles à la main, du nom de ces gazetins qui circulaient avant que les journaux en bonne et due forme ne viennent les remplacer. Les qualifiant de “maquis qui échappe aussi bien aux contemporains qu’aux historiens”, elle insiste notamment sur leurs dimensions “anonymes, lacunaires, éphémères” et souligne que “répandues à vive allure, écrites à la hâte, transmises entre ombre et lumière, elles inondent les grands et petits et sont par essence invérifiables”. Autant d’éléments qui mis bout à bout en viennent à constituer non pas tant l’esprit du siècle que l’atmosphère de l’époque, qui se caractérise par l’idée que “la légitimité de penser sur l’emporte sur son interdiction”, tandis que la transgression “génère, dans les circonstances culturelles et politiques du temps, une audace et une assurance qui sont un des faits politiques majeurs du siècle”.
Rumeurs, mensonges et violences créatrices (de l’opinion publique)
Autant d’éléments déjà en germe au siècle précédent, du temps de la Fronde et des mazarinades, du nom de cette littérature destinée à décrédibiliser le cardinal Mazarin. Dans un article publié en 2010, et intitulé quand l’imprimé devient une arme dans le combat politique : la France du XVIe au XXe siècle, l’historien Jean-Yves Mollier, spécialiste de l’histoire de l’édition, estime que les vers, pamphlets et autres libelles publiés à cette époque participent à la structuration d’une opinion publique en France[3]. Se référant aux travaux de l’historien dix-septièmiste Christian Jouhaud[4], ayant étudié pas moins de 5 000 mazarinades conservées dans les bibliothèques, Jean-Yves Mollier souligne qu’ “à partir du moment où la contestation de la personne du cardinal Mazarin dépasse le cercle des courtisans ou des familiers de la politique pour devenir une question nationale, la capacité de l’écrit, du texte imprimé, de la caricature, du placard, de la gravure à mobiliser les consciences se vérifie. Alors même que la majorité de la population demeure analphabète, une opinion publique semble voir le jour, prête à propager les nouvelles de Paris aux frontières, de la ville à la campagne et à transcender ainsi les conditions et les différences de statut”.
Pour l’historien, les mazarinades, dont plus de 1 000 exemplaires ont été comptabilisés pour les années 1649 et 1652, “contribuèrent à faire descendre la politique dans la rue”. Dans un article intitulé Déjà-vu et publié en 2017 dans la revue Médium, l’historienne, sociologue et médiologue Catherine Bertho-Lavenir souligne que les mazarinades, qui “saturent l’espace public en France à un moment où le pouvoir royal est en grand danger […] nourrissent des polémiques de toutes sortes, assaisonnées d’insultes et de propos diffamatoires”. Établissant un parallèle avec nos vecteurs de communication contemporains, elle souligne que les mazarinades “partagent bien des traits avec les polémiques entretenues par les médias sociaux contemporains et avec les informations mensongères qui ont émaillé les récentes élections américaines et françaises”[5]. Il est ainsi fort cocasse de constater que cette phase supposément embryonnaire de l’espace public, marquée en France, par la prolifération des mazarinades est celle qui, comme le souligne Catherine Bertho-Lavenir, à la suite de Michel de Certeau, se caractérise par la viralité, certes relative par rapport à notre époque mais considérable pour le XVIIe siècle, de contenus imprimés qui “ne développent pas une pensée dans un espace intellectuel mais visent à faire tomber, discréditer, disparaître leur cible”. Par ailleurs, ces textes qui sont, la plupart du temps de commande, dans une optique de brouiller les pistes, du moins autant que faire se peut, nous renseignent également sur la dimension proto-industrielle de la fabrication du faux. À croire qu’au berceau de l’opinion publique le faux et le vrai n’ont pas été apportés de manière harmonieuse et équilibrée, mais que le premier s’est chargé de baptiser cette opinion publique naissante du feu du faux, de la violence, de la haine et de la fureur.
[1] Pinker, Roy. Fake news & viralité avant Internet: les lapins du Père-Lachaise et autres légendes médiatiques. CNRS éditions, 2020.
[2] Farge, Arlette. Dire et mal dire: l’opinion publique au XVIIIe siècle. Seuil, 1992.
[3] Presse, nations et mondialisation au xixe siècle, sous la direction de Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant, Paris, Nouveau Monde éditions, 2010, 512 pp.
[4] Christian Jouhaud, Mazarinades : la Fronde des mots, Paris, Aubier, 1985
[5] Lavenir, C. (2017). Déjà-vu. Médium, 52-53(3-4), 85-100. https://doi-org.accesdistant.sorbonne-universite.fr/10.3917/mediu.052.0085
Nous avons un quart de siècle de recul à la fois pour mesurer l’efficacité d’une intention et juger de sa cohérence. Ce qui pourrait se formuler ainsi : comment a-t-on « scientifiquement » défini la valeur universelle pour en faire une catégorie juridique ? Plus malicieusement : comment des représentants d’États ont-ils parlé au nom de l’humanité ou des générations futures et oublié leurs intérêts nationaux ou leurs revendications identitaires ? Plus médiologiquement : comment une organisation matérialisée (le Comité qui établit la liste, des ONG, des experts qui le conseillent…) a-t-elle transformé une croyance générale en fait pratique ? Comment est-on passé de l’hyperbole au règlement ? De l’idéal à la subvention ?
En venant briser la réputation et l’autorité d’un candidat, en venant saper les fondements du discours officiel et légitime d’un État, les fake news et autres logiques de désinformation, viennent mettre au jour l’idée d’un espace public souverain potentiellement sous influence d’acteurs exogènes.
Nos sociétés de l'information exaltent volontiers la transparence. En politique, elle doit favoriser la gouvernance : plus d'ententes clandestines, de manoeuvres antidémocratiques obscures, d'intérêts occultes, de crimes enfouis. En économie, on voit en elle une garantie contre les défauts cachés, les erreurs et les tricheries, donc un facteur de sécurité et de progrès. Et, moralement, la transparence semble garantir la confiance entre ceux qui n'ont rien à se reprocher. Dans ces conditions, il est difficile de plaider pour le secret. Ou au moins pour sa persistance, voire sa croissance. Et pourtant...
L’image de citadelle assiégée renvoyée par Madrid au moment de la crise catalane soulève de nombreuses questions, et interroge sur la propension que peuvent avoir certains acteurs politiques à tendre vers des logiques d’exception au nom d’une lutte contre une menace informationnelle et/ou pour défendre un système démocratique en proie à de prétendues attaques exogènes.